28/07/2008
Edgar Poe
Les Histoires extraordinaires.
par
Jules Barbey d’Aurévilly
Le Réveil, 1865
I
 C’est le roi des Bohêmes ! Edgar Poe est bien le premier et le meilleur, à sa manière, de cette littérature effrénée et solitaire, sans tradition et sans ancêtres... prolem sine matre creatam, qui s’est timbrée elle-même de ce nom de Bohême qui lui restera comme sa punition ! Edgar Poe, le poète et le conteur américain, est à nos yeux le Bohême accompli, le Bohême élevé à sa plus haute puissance. Né dans ce tourbillon de poussière que l’on appelle, par une dérision de l’histoire, les États-Unis* ; revenu, après l’avoir quittée, dans cette auberge des nations, qui sera demain un coupe-gorge, et où, bon an mal an, tombent cinq cent mille drôles plus ou moins bâtards, plus ou moins chassés de leur pays, qu’ils menaçaient ou qu’ils ont troublé, Edgar Poe est certainement le plus beau produit littéraire de cette crème de l’écume du monde. Et c’était logique et justice que le plus fort de tous les Bohêmes contemporains naquît au sein de la Bohême du refuge et du sang-mêlé de toutes les révoltes !
C’est le roi des Bohêmes ! Edgar Poe est bien le premier et le meilleur, à sa manière, de cette littérature effrénée et solitaire, sans tradition et sans ancêtres... prolem sine matre creatam, qui s’est timbrée elle-même de ce nom de Bohême qui lui restera comme sa punition ! Edgar Poe, le poète et le conteur américain, est à nos yeux le Bohême accompli, le Bohême élevé à sa plus haute puissance. Né dans ce tourbillon de poussière que l’on appelle, par une dérision de l’histoire, les États-Unis* ; revenu, après l’avoir quittée, dans cette auberge des nations, qui sera demain un coupe-gorge, et où, bon an mal an, tombent cinq cent mille drôles plus ou moins bâtards, plus ou moins chassés de leur pays, qu’ils menaçaient ou qu’ils ont troublé, Edgar Poe est certainement le plus beau produit littéraire de cette crème de l’écume du monde. Et c’était logique et justice que le plus fort de tous les Bohêmes contemporains naquît au sein de la Bohême du refuge et du sang-mêlé de toutes les révoltes !
* Depuis que ceci est écrit, on a vu s’ils l’étaient. Les États-Unis ! On peut les appeler maintenant les États-Déchirés.
Individuel comme un Américain, n’ayant jamais vu que le moi par lequel il a péri, comme ils périront eux aussi, Edgar Poe fut. parmi ses compatriotes démocrates, le Bohême de l’esprit aristocratique. Dans le pays de la plus cynique utilité, il ne vit que la beauté, la beauté par elle-même, la beauté oisive, inféconde, l’art pour l’art. Rien ne peut se comparer à l’amour violent qu’il eut pour elle. M. Victor Hugo, traître à cet art pour l’art qui ne fut jamais pour lui qu’une religion de préface, et qui, en vieillissant, a livré sa Muse à de bien autres préoccupations ; M. Victor Hugo, même aux plus chaudes années de sa jeunesse, est bien tiède et bien transi dans son amour fanfaron de la forme et de la beauté, en comparaison d’Edgar Poe, de ce poëte et de cet inventeur qui a la frénésie patiente, quand il s’agit de donner à son œuvre le fini... qui est son seul infini, hélas ! A coup sûr, jamais les doctrines, ou plutôt l’absence de doctrines que nous combattons : l’égoïsme sensuel, orgueilleux et profond, l’immoralité par le fait, quand elle n’est pas dans la peinture et dans l’indécence du détail, le mépris réfléchi de tout enseignement, la recherche de l’émotion à outrance et à tout prix, et le pourlèchement presque bestial de la forme seule, n’ont eu dans aucun homme de notre temps, où que vous le preniez, une expression plus concentrée et plus éclatante à la fois que dans Edgar Poe et ses œuvres.
Étudier la Bohême sur cet homme, ses livres et ses procédés, c’est donc étudier la maladie sur le plus puissant organisme qu’elle ait ruiné en quelques jours. Que nous servirait de l’étudier sur quelque impuissant ou quelque noué ? Prenons-la où elle fit vraiment un ravage. Pour mieux montrer l’abjection de la Bohême littéraire, nous choisirons son plus beau cadavre. On verra plus nettement la cause de la ruine sur cette noble chose démolie. C’est là presque un deuil, en vérité, car Edgar Poe pouvait être quelque chose de grand et il ne sera qu’une chose curieuse. Il y a plus triste que le talent foudroyé, c’est le talent qui se fourvoie, et qui meurt de s’être fourvoyé.
II
Il était né poëte, Edgar Poe. Tels qu’ils sont, violemment manqués, mais portant la trace à toute page d’une force inouïe, les livres que la traduction de M. Baudelaire nous a fait connaître, ne permettent pas d’en douter. C’était, de nature, un vrai poëte, une incontestable supériorité d’imagination, faite pour aller ravir l’inspiration aux plus grandes sources ; mais il n’est pas bon que l’homme soit seul, a dit le saint Livre, et Poe, ce Byron-Bohême, vécut seul toute sa vie et mourut comme il avait vécu, — ivre et seul ! L’ivrognerie de ce malheureux était devenue le vice de sa solitude. Quoique marié (son biographe ne nous dit pas à quel autel) quoique marié à une femme qu’il aima, prétend-on, — mais nous savons trop comment aiment les poëtes, — la famille ne créa point autour de lui d’atmosphère préservatrice. Or, comme le talent, ne nous lassons point de le répéter, est toujours moulé par la vie et la réverbère, Edgar Poe, l’isolé, exploita pendant toute la sienne les abominables drames de l’isolement. Sous toutes les formes que l’art — cette comédie qu’on se joue à soi-même, — cherche à varier, mais qu’en définitive il ne varie point, Edgar Poe, l’auteur des Histoires extraordinaires, ne fut jamais, en tous ses ouvrages, que le paraboliste acharné de l’enfer qu’il avait dans le cœur, car l’Amérique n’était pour lui qu’un effroyable cauchemar spirituel, dont il sentait le vide et qui le tuait.
Au milieu des intérêts haletants de ce pays de la matière, Poe, ce Robinson de la poésie, perdu, naufragé dans ce vaste désert d’hommes, rêvait éveillé, tout en délibérant sur la dose d’opium à prendre pour avoir au moins de vrais rêves, d’honnêtes mensonges, une supportable irréalité ; et toute l’énergie de son talent, comme sa vie, s’absorba dans une analyse enragée, et qu’il recommençait toujours, des tortures de sa solitude. Évidemment, s’il avait été un autre homme, il aurait pu combler, avec des affections fortes ou des vertus domestiques, cette solitude qui a fait pis que de dévorer son génie, car elle l’a dépravé. Seulement, pour cela, il lui eût fallu le bénéfice et le soutien d’une éducation morale quelconque, et l’on se demande avec pitié ce que fut la sienne, à lui, le fils d’une actrice et de l’aventure, dans une société qui a trouvé, un beau matin, les Mormons, au fond de ses mœurs !
On se le demande, sans pouvoir y répondre. Le biographe d’Edgar Poe ne le dit pas et peut-être ne s’en soucie guère ; mais le silence de sa notice sur l’éducation morale, nécessaire même au génie pour qu’il soit vraiment le génie, genre d’éducation qui manqua sans doute à Edgar Poe ; et d’un autre côté, le peu de place que tiennent le cœur humain et ses sentiments dans l’ensemble des œuvres de ce singulier poëte et de ce singulier conteur, renseignent suffisamment, — n’est-il pas vrai ? — sur la moralité sensible ou réfléchie d’un homme qui, après tout, avec une organisation superbe, ne fut accessible qu’à des émotions inférieures, et dont la pensée, dans les plus compliquées de ses inventions, n’a jamais que deux mouvements convulsifs, — la curiosité et la peur.
III
Était-ce donc la peine d’avoir tant de facultés en puissance ? La curiosité et la peur ? Quoi ! dans ces Histoires extraordinaires, qui le sont bien moins par le fond des choses que par le procédé d’art du conteur, sur lequel nous reviendrons, et qui est, à la vérité, extraordinaire, il n’y a rien de plus élevé, de plus profond et de plus beau, en sentiment humain, que la curiosité et la peur, — ces deux choses vulgaires ! — La curiosité de l’incertain qui veut savoir et qui rôde toujours sur la limite de deux mondes, le naturel et le surnaturel, s’éloignant de l’un pour frapper incessamment à la porte de l’autre, qu’elle n’ouvrira jamais, car elle n’en a pas la clef ; et la peur, terreur blême de ce surnaturel qui attire, et qui effraye autant qu’il attire ; car, depuis Pascal peut-être, il n’y eut jamais de génie plus épouvanté, plus livré aux affres de l’effroi et à ses mortelles agonies, que le génie panique d’Edgar Poe !
Tel est le double caractère du talent, de l’homme et de l’œuvre que la traduction française, qui est très-bien faite, nous a mis à même de juger : la peur et ses transes, la curiosité et ses soifs, la peur et la curiosité du surnaturel dont on doute, et, pour l’expliquer, toutes les folies d’une époque et d’un pays matérialiste qui effraye autant qu’il attire. Tout cela est agité, orageux, terrible, presque fou, et peut faire passer un frisson sur la peau et sur l’âme, mais n’y entre pas, si l’on a une croyance solide, une foi religieuse, une certitude. Tout cela, — des contes d’ogre pour des enfants qui se croient des hommes, — n’a qu’une prise d’un moment sur l’imagination du lecteur, et manque, comme impression d’art, de profondeur et de vraie beauté. Ce n’est point là la peur, la peur cabrée, renversée, glacée de Pascal. La peur de Pascal ne déshonore point cet épouvanté sublime. Elle vient d’une grande chose, de la foi qui lui montre l’enfer à œil nu et de l’indignité sentie, qui lui dit qu’il y peut tomber, tandis que la peur d’Edgar Poe est la peur de l’enfant ou du lâche d’esprit, fasciné par ce que la mort, qui garde le secret de l’autre monde, quand la religion ne nous le dit pas, a d’inconnu, de ténébreux, de froid. C’est l’application du mot de Bacon : " les hommes ont peur de la mort comme les enfants ont peur de l’ombre. "
Cette peur des sens soulevés prend mille formes dans les Histoires de Poe ; mais soit qu’elle se traduise et se spécifie par l’horreur qu’il a d’être enterré vivant, ou par le désir immense de tomber, ou par quelque autre hallucination du même genre, c’est toujours la même peur nerveuse du matérialiste halluciné. Edgar Poe excelle à créer ces hallucinations, et il les savoure et les réfléchit, tout en en frémissant ou se pâmant d’effroi. Sans aucun doute, dans ce jeu bizarre où l’auteur devient de bonne foi, et, comme l’acteur, se fascine soi-même, il y a (et la Critique doit l’y voir) un naturel de poëte dramatique qui, tiré de toutes ces données, sujets habituels des contes d’Edgar Poe : le somnambulisme, le magnétisme, la métempsycose, — le déplacement et la transposition de la vie, — aurait pu être formidable. Mais il y a aussi, — il faut bien le dire, — le Perrault. Il y est caché au fond du grand poëte ; et parce qu’il y est, faute de sujets moraux et grands, faute d’idées, faute de grandes croyances, faute d’imposantes certitudes, on peut dire hardiment que c’est le Bohême qui l’y a mis !
IV
Ainsi, en plein cœur de son propre talent, pour le diminuer et le piquer de sa tache, voilà que nous rencontrons le Bohême, c’est-à-dire l’homme qui vit intellectuellement au hasard de sa pensée, de sa sensation ou de son rêve, comme il a vécu socialement dans cette cohue d’individualités solitaires, qui ressemble à un pénitentiaire immense, le pénitentiaire du travail et de l’égoïsme américain ! Edgar Poe, le fils de l’aventure et de l’aventure infortunée, est aussi le plus souvent un aventurier d’inventions malheureuses, quoiqu’il y ait quelques-uns de ses contes qui, le genre admis de cette littérature matérialiste et fébrile, semblent réussis. Au lieu de se placer au-dessus d’elles, comme les penseurs originaux, il pille les idées de son temps, et ce qu’il en flibuste ne méritait guère d’être flibusté. Doué de la force de cette race de puritains qui se sont abattus d’Angleterre comme une bande de cormorans affamés, ce qu’il prend aux préoccupations contemporaines ne vaut pas la force qu’il déploie pour se servir de ce qu’il a pris ; et ici nous arrivons à ce qui l’emporte, selon nous, dans Edgar Poe, sur les résultats obtenus de sa manière, — c’est-à-dire l’application de son procédé.
V
Et, en effet, l’originalité vraie d’Edgar Poe, ce qui lui gardera une place visible dans l’Histoire littéraire du dix-neuvième siècle, c’est le procédé qu’on retrouve partout dans ses œuvres ; aussi bien dans son roman d’Arthur Gordon Pym que dans ses Histoires extraordinaires, et qui fait du poëte et du conteur américain ce qu’il est, c’est-à-dire le plus énergique des artistes volontaires, la volonté la plus étonnamment acharnée, froidissant l’inspiration pour y ajouter. Ce procédé d’Edgar Poe est l’analyse, que jamais personne peut-être ne mania comme lui. Nous l’avons indiqué : maigre d’invention, exploitant seulement deux ou trois situations (pas plus !) de la même série excentrique, Poe fait son drame avec presque rien, et c’est tout.
Mais pour le faire, ce drame, pour grossir cet atome en le décomposant, il se sert d’une analyse inouïe et qu’il pousse à la fatigue suprême, à l’aide d’on ne sait quel prodigieux microscope, sur la pulpe même du cerveau. Positivement, le lecteur assiste à l’opération du chirurgien ; positivement il entend crier l’acier de l’instrument et sent les douleurs. Edgar Poe applique ce quelque chose, qu’on peut nommer l’impatience dans la curiosité, le procédé du travail en matière d’horlogerie. Il établit le tour du cadran de l’analyse sur le pivot de son mouvement interne. Il a une patience qui attaque les nerfs, une patience furieuse qui se met des freins à elle-même, et qui a dû sacrifier souvent tout un mois en simples préparatifs pour faire bouillir son public une heure. Machiavélique côté de son génie, qui touche ici à la rouerie profonde du jongleur, et où le poëte, le poëte, ce Spontané divin, expire dans les exhibitions affreuses du charlatan et du travailleur américain !
VI
Car il est Américain, quoi qu’il fasse, cet homme qui détestait l’Amérique, et que l’Amérique, mère de ses vices et de sa misère, a poussé au suicide contre elle. Fatalité de l’origine et de la race ! On n’efface jamais à son front sa nationalité ou sa naissance. Edgar Poe, le Bohême de génie, n’est après tout ni plus ni moins qu’un Américain, l’énergique produit et l’antithèse du monde américain des États-Unis ! Il y aurait quelque chose de plus à faire que ses Contes, ce serait sa propre analyse, mais pour cela, il faudrait son genre de talent... Quand on résume cette curieuse et excentrique individualité littéraire, ce fantastique, en ronde bosse, de la réalité cruelle, près duquel Hoffmann n’est que la silhouette vague de la fumée d’une pipe sur un mur de tabagie, il est évident qu’Edgar Poe a le spleen dans des proportions désespérées, et qu’il en décrit férocement les phases, la montre à la main, dans des romans qui sont son histoire.
Ce spleenétique colossal, en comparaison de qui lord Byron, ce beau lymphatique, ne nous apparaît plus que comme une vaporeuse petite maîtresse ; ce spleenétique colossal, malgré l’infiltration morbide de son regard d’aliéné, a les lucidités flegmatiques et transperçantes du condamné qui se sait sur son échafaud. Il n’a pas que le spleen de la vie, il a aussi celui de la mort ! Spirituellement parlant, la question de l’autre monde a toujours étrangement pesé sur cet homme de l’autre monde, comme nous disons géographiquement. Elle revient de toutes parts dans ses livres. Revanche de la pensée, cette force spirituelle contre l’immoralité fangeuse de la vie, ce fut sa grande anxiété, à cet Hamlet américain ! Ce fut la seule chose vraie de ces livres, construits comme des mensonges immenses ; la seule émotion dont il n’aurait pas trafiqué ! Tout le reste est voulu, arrangé, menti dans ses œuvres, qui ne sont probablement que les pamphlets de son esprit, des pamphlets atroces, des vengeances contre la vie. Il empoisonnait ses empoisonneurs.
Historiquement, il finit par s’empoisonner lui-même. Le suicide, un suicide préparé depuis longtemps, dit très-bien M. Baudelaire, un suicide, la mort bohême, finit la vie bohême d’Edgar Poe. " Un malin, dans les ténèbres du petit jour, raconte amèrement M. Baudelaire, un cadavre fut trouvé sur la voie, est-ce ainsi qu’il faut dire ? non, un corps vivant encore, mais que la mort avait marqué de sa royale estampille. Sur ce corps, dont on ignorait le nom, on ne trouva ni papier ni argent, et on le porta dans un hôpital. C’est là que Poe mourut, le 7 octobre 1849, à l’âge de trente-sept ans, vaincu par le delirium tremens, ce terrible visiteur qui avait déjà hanté son cerveau une ou deux fois... " Hélas ! une ou deux fois, ce n’est pas assez dire. Poe ne mourut pas seulement du delirium tremens, il en avait vécu ! Sa vie tout entière, à ce robuste et malade génie, fut, jusqu’à sa dernière heure, un délire et un tremblement !
VII
Cruelle et lamentable histoire ! Le traducteur qui l’a racontée dans la passion ou la pitié qu’il a pour son poëte, a fait de l’histoire et de cette mort d’Edgar Poe une accusation terrible, une imprécation contre l’Amérique toute entière ! C’est la vieille thèse, la thèse individuelle, et il faut bien le dire, puisque c’est la même chose, la thèse bohême contre les sociétés. Nous eussions de M. Baudelaire, d’une tête qui a parfois la froide lucidité de Poe, attendu une thèse plus virile.
Il pouvait être le frère de charité, l’ensevelisseur des restes d’un homme de génie, sans les jeter à la tête de tout un pays qui, en définitive, ne l’a point volontairement assassiné. Edgar Poe s’est chargé seul de cette besogne : il s’est assassiné lui-même... Moralement, l’Amérique et Edgar Poe se valent; ils n’ont point de reproche à se faire ; ils ont tous les deux le même mal, monstrueux et mortel dans l’un comme dans l’autre, le mal de l’individualité. Edgar Poe répond donc seul à l’histoire de sa destinée, et le poids qu’il porte devant elle ne peut être allégé par rien. Dieu lui avait donné des facultés singulièrement belles, puissantes et rares ; il n’en tira point le parti qu’il en eût pu tirer. Nous l’avons dit, il se fourvoya avec l’effort qui ferait monter un homme aux astres.
A nos yeux, à nous qui ne croyons pas que l’Art soit le but principal de la vie et que l’esthétique doive un jour gouverner le monde, ce n’est pas là une si grande perte qu’un homme de génie; mais nul n’est dispensé d’être une créature morale et bienfaisante, un homme du devoir social; c’est là une perte qu’on ne rachète point ! Or, Edgar Poe ne le fut pas. Pour lui donner force à l’être pourtant, Dieu, après le génie qui est aussi une lumière pour le cœur, lui avait donné des affections domestiques. Le Robinson de la poésie, dans son île d’Amérique, eut mieux que Vendredi, pour supporter et partager la vie. Il épousa une femme qui lui apporta en dot une mère*.Eh bien, cette dernière affection d’une mère, qui ne lui manqua jamais et qui lui survécut, ne l’arrêta point dans la consommation de ce long suicide par l’alcool qu’il accomplit sur sa personne. Voilà ce qui le rend plus coupable qu’un autre de cette Bohême sinistre et funèbre, dont, par la supériorité de ses facultés et de ses fautes, il est actuellement le roi !
* Mme Clemm, la belle-mère de Poe.
10:27 Publié dans Reversibilité | Lien permanent | Commentaires (0)
27/07/2008
Qui est juif? par Gershom Scholem
 Ce discours fut prononcé lors de la 81e convention de la Conférence Centrale des Rabbins américains, tenue à Jérusalem du 6 au 10 mars 1970. Il a été publié dans le Central Conference of American Rabbis Yearbook, 80 (1970), p. 134-139. La version en hébreu a été publiée dans Devarim bego, p. 591-598. La question " Qui est Juif ? " fit l’objet de débats houleux au parlement israélien les 9 et 10 février de la même année, sous le gouvernement de Mme Golda Meïr, qui aboutirent au vote d’un amendement de la loi du retour de 1950, définissant un juif comme " étant né de mère juive, ou converti au judaïsme et ne pratiquant pas une autre religion ", et renouvelant ainsi le statu quo d’un ancien accord politique entre Ben-Gourion et les partis religieux à la veille de la création de l’État d’Israël. Sur cette question de l’identité juive, Scholem est revenu dans son entretien avec Ehud Ben Ezer dans le volume Unease in Zion, p. 281-286 : " Le gouvernement [israélien] - écrit-il - n’est pas en droit de trancher par une loi une question qui relève du processus naturel d’évolution de la conscience historique du peuple, qui est au centre de la pensée sioniste et du conflit qui oppose ses deux courants antagonistes ; au centre de cette dialectique de la continuité et de la révolte, issue de sources inconnues et qui contribuent toutes deux à l’élaboration de notre identité collective. C’est une erreur fatale que de trancher aujourd’hui par une loi le cours d’un processus d’évolution de la conscience historique de la nation qui devrait pouvoir s’élaborer de lui-même. " (trad. fr. de Sionismes, p. 773 sq.) [Bibliographie 497].
Ce discours fut prononcé lors de la 81e convention de la Conférence Centrale des Rabbins américains, tenue à Jérusalem du 6 au 10 mars 1970. Il a été publié dans le Central Conference of American Rabbis Yearbook, 80 (1970), p. 134-139. La version en hébreu a été publiée dans Devarim bego, p. 591-598. La question " Qui est Juif ? " fit l’objet de débats houleux au parlement israélien les 9 et 10 février de la même année, sous le gouvernement de Mme Golda Meïr, qui aboutirent au vote d’un amendement de la loi du retour de 1950, définissant un juif comme " étant né de mère juive, ou converti au judaïsme et ne pratiquant pas une autre religion ", et renouvelant ainsi le statu quo d’un ancien accord politique entre Ben-Gourion et les partis religieux à la veille de la création de l’État d’Israël. Sur cette question de l’identité juive, Scholem est revenu dans son entretien avec Ehud Ben Ezer dans le volume Unease in Zion, p. 281-286 : " Le gouvernement [israélien] - écrit-il - n’est pas en droit de trancher par une loi une question qui relève du processus naturel d’évolution de la conscience historique du peuple, qui est au centre de la pensée sioniste et du conflit qui oppose ses deux courants antagonistes ; au centre de cette dialectique de la continuité et de la révolte, issue de sources inconnues et qui contribuent toutes deux à l’élaboration de notre identité collective. C’est une erreur fatale que de trancher aujourd’hui par une loi le cours d’un processus d’évolution de la conscience historique de la nation qui devrait pouvoir s’élaborer de lui-même. " (trad. fr. de Sionismes, p. 773 sq.) [Bibliographie 497].
En abordant la question : " Qui est Juif ? ", je ne m’exprimerai pas en tant qu’homme d’État ou en tant que politicien. Je ne suis ni juriste, ni rabbin. Je parle en tant qu’historien. Et je pense qu’il ne s’agit pas seulement d’une question strictement philosophique, mais d’une question historique ou, si vous préférez, historio-sophique. Je parle en tant que Juif persuadé que le judaïsme est un phénomène spirituel, un organisme vivant.
Il semble évident pour beaucoup de gens, y compris quelques savants, que le judaïsme est un système fermé de concepts définis, mais, à mon avis, cette conception n’est plus valable. Avec le retour du peuple juif à sa propre histoire et à sa propre terre, le judaïsme est devenu pour la majorité d’entre nous un organisme ouvert, vivant et non défini. C’est un phénomène qui change, qui se transforme au cours de sa propre histoire. Les recherches érudites de notre génération ont permis de découvrir des dimensions nouvelles de profondeur et de vie en mouvement dans ce que nous appelons le judaïsme ou la judéité.
L’identification totale entre l’appartenance juive et le fait d’être un Juif religieux de tel ou tel mouvement, dont parlent les défenseurs du judaïsme traditionnel, a été un phénomène historique, résultant de développements historiques, et soumis au changement historique. Elle s’est cristallisée dans ses grandes lignes après la destruction du Temple et a prévalu dans la galout avant l’ère de l’Émancipation.
C’est un fait largement négligé aujourd’hui, particulièrement parmi les défenseurs de cette identification, qu’il était possible d’imposer cette conformité aux normes de la Halakhah, et que celle-ci l’a été effectivement, en faisant usage du herem (l’interdit ou l’excommunication), lequel était une arme très puissante, contraignant les individus à choisir entre la conformité à certaines normes ou l’abandon de leur communauté. Lorsqu’à la fin du dix-huitième siècle, le pouvoir rabbinique du h5erem fut rompu, une certaine diversité vit le jour. Et nous pouvons nous demander aujourd’hui si ce pouvoir de l’excommunication, en dépit de son côté positif qui permit de faire respecter une certaine conformité, n’eut pas aussi des conséquences assez désastreuses et ne fut pas l’un des aspects les plus désolants de notre histoire.
Avec l’ère de l’Émancipation, un processus nouveau fut lancé sous l’effet de forces internes et externes. Extérieurement, afin d’obtenir l’émancipation, Juifs et non-Juifs s’efforcèrent de séparer le judaïsme en tant que religion de sa spécificité ethnique, bouleversant ainsi la conception ethnico-religieuse unifiée, que tous les Juifs - même en Occident - avaient soutenue avant 1820. Intérieurement, du fait de l’effort de certains groupes au sein du judaïsme, qui cherchèrent une expression légitime pour différentes hétérodoxies.
Les porte-parole officiels du judaïsme - aussi bien chez les orthodoxes que dans le camp de la Réforme - mirent exclusivement l’accent sur les définitions religieuses. Ceux qui insistèrent sur un concept unitaire du peuple et de la religion étaient marginaux et embarrassaient à la fois les orthodoxes et les Juifs libéraux et assimilationnistes. Le combat contre l’autorité rabbinique existante, de quelque tendance qu’elle soit, mené par ceux qui cherchèrent à rétablir notre identité nationale et notre dignité en tant que peuple, était soutenu par des forces pour lesquelles le problème de l’identité juive, telle que la définissaient les orthodoxes, n’existait pas. Ceux qui œuvraient pour la régénération et la renaissance du peuple juif et qui étaient les principaux porteurs du message sioniste ne s’intéressaient pas aux définitions des rabbins. Ils ne s’en préoccupaient tout simplement pas.
Au cours des cent dernières années, qui suivirent le plein accomplissement de l’Émancipation dans le monde occidental, aux alentours de 1860, s’est développé un nouveau processus historique, qui a profondément modifié notre définition de nous-mêmes par rapport à celle de la Halakhah. Jusqu’à cette époque, les définitions halakhiques de l’identité juive étaient acceptées. Et ceci pour une raison toute simple. Jadis, les mariages mixtes étaient un phénomène très rare. Ceux qui envisageaient de faire un mariage mixte, ou de se convertir à une autre religion, étaient ceux qui voulaient abandonner l’identité juive, et ne se préoccupaient pas de ce que l’on pouvait dire à leur sujet. Personne ne posait de questions à propos de ces cas marginaux ; le problème de leurs relations avec les autres Juifs se posait à peine.
Les difficultés commencèrent aux alentours de 1870, lorsqu’un nombre toujours plus grand parmi ces individus voulut conserver des liens avec la communauté juive. La question est de savoir si les définitions données dans les livres sacrés sont réellement décisives pour la plupart des Juifs, concernant la détermination de l’appartenance à la communauté juive. À mon avis, elles ne le sont plus, sauf pour les plus orthodoxes, avec lesquels il est inutile de discuter, puisqu’ils ont une conception arrêtée de ce qu’ils croient être l’essence du judaïsme et de ses lois, immuables et intemporelles, et qu’ils utilisent des catégories très différentes de celles auxquelles ont recours les historiens. Le problème concerne ceux qui ne partagent pas les idées des orthodoxes, et qui constituent peut-être la grande majorité des Juifs aujourd’hui : que pensent-ils de leur propre conscience juive et de sa définition ?
Parmi ceux qui prirent la plus grande part dans la construction d’Israël, seule une très petite minorité adhérait aux vieilles définitions de l’identité juive. La plupart de ceux qui vinrent ici avec des motivations sionistes ne se préoccupaient pas de la halakhah. Ils s’attendaient à ce que leur communauté fonctionne sur la base de lois promulguées dans un pays libre pour un peuple libre, pouvant y prendre ses propres décisions, tout en restant à l’intérieur des limites de la conscience historique de ce peuple.
Jadis, si quelqu’un se trouvait en désaccord avec l’autorité rabbinique, il abandonnait le judaïsme. Il n’avait pas le choix ! Il devait se conformer ou partir. Plus tard, à l’époque de l’Émancipation, ce départ s’amorçait à travers l’assimilation. Mais, peu à peu, il devint très fréquent que des individus, faisant partie de la communauté, se marient en dehors d’elle.
La définition traditionnelle dans le cadre de la loi juive - pour laquelle la société juive était construite depuis les temps anciens sur des bases patriarcales - avait paradoxalement recours à des critères matriarcaux pour définir l’identité juive. Pour moi-même et pour beaucoup de gens qui vivent dans ce pays, cette définition halakhique, qui s’est maintenue pendant si longtemps, a perdu toute signification et toute pertinence psychologique.
Dans le cas d’un mariage mixte, nous sommes bien plus enclins à considérer le fils d’un père juif et d’une mère non juive comme étant juif que le contraire. En général, je dirais que la définition rabbinique n’a plus beaucoup de pertinence pour la majeure partie des Juifs en Europe ou en Amérique. Il est certain qu’au cours des quarante dernières années, si le fils d’un Juif voulait être reconnu comme Juif, que ce soit par la religion ou par l’appartenance nationale, il était accepté comme tel d’un commun accord. Personne n’aurait même posé de questions. Ainsi, lorsque la fille de mon frère, qui avait épousé une non-juive, revint dans la communauté juive berlinoise après le génocide et déclara : " Je veux faire partie de la communauté juive ", elle ne fut pas rejetée. Ils l’acceptèrent parmi eux. Elle était la fille d’un Juif bien connu, et ils ne tinrent pas compte des complications halakhiques.
D’ailleurs, la question ne s’applique pas seulement au fait d’intégrer une synagogue ou une communauté. C’est le problème de la réaction publique générale, et je ne perçois aucun signe indiquant que l’ancienne définition rabbinique du Judaïsme fasse l’objet d’une préférence ou d’une insistance particulière. Il y a eu un changement psychologique important, et cela détermine la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui. Autrefois, quatre-vingt-quinze pour cent ou plus des individus qui contractaient des mariages mixtes, ou en étaient issus, ne cherchaient pas à conserver une identité juive, encore moins à la souligner. Au cours des quarante dernières années, nous avons assisté à un renversement complet. À travers les vicissitudes de l’histoire, à travers le destin tragique qui fut celui de notre peuple, ils prirent la ferme décision de se compter au nombre des Juifs. Et quand quelqu’un disait : " Je veux être admis comme juif ", chacun était heureux de pouvoir l’accueillir comme tel, et personne ne rétorquait : " Vous n’êtes pas l’un des nôtres. " À mon avis, il est très important que nous prenions connaissance de tels faits historiques et psychologiques .
Le processus d’émancipation, et plus tard le combat, et la nécessité de ce combat, pour la reconstruction d’une vie nationale qui nous soit propre, ont mené à ce changement d’attitude, qui ne dépend plus des catégories de la halakhah. Il y a un accord général pour considérer comme Juifs un certain nombre d’individus qui ne sont pas reconnus comme tels par la loi rabbinique. Et c’est d’autant plus vrai dans le cas de ceux qui sont venus en Israël pour vivre ici en tant que juifs.
À notre époque, la conscience juive a été soumise à une rupture bien définie, dont nous devons reconnaître l’existence : à savoir, la rupture entre une vision religieuse du judaïsme et une vision laïque. Le sionisme les a accueillies toutes deux en son sein. Les gens étaient libres de décider s’ils voulaient une identification laïque avec le peuple juif, une identification religieuse, ou les deux à la fois. C’était une lutte d’idées, une lutte pour l’organisation, mais personne ne disait que vous ne pouviez pas venir ici à moins d’accepter les contraintes halakhiques.
C’est un aspect du problème. L’autre aspect est que certaines personnes conservaient des opinions religieuses avec une conviction passionnée - ce qui est un droit légitime. Il nous est impossible, à la lumière de l’histoire juive du dix-neuvième et du vingtième siècle, de parler du judaïsme comme d’un phénomène unilatéral.
Les deux définitions, laïque et religieuse, existent. Elles peuvent et elles doivent être développées. Je dis cela en tant qu’historien. Je dis cela en tant que Juif qui s’identifie avec l’ensemble du judaïsme comme phénomène historique, un phénomène qui pourrait atteindre un niveau religieux nouveau, avec une inspiration nouvelle, et se développer en quelque chose que nous ne pouvons pas encore définir. Nous avons appelé les gens à participer dans ce pays à une entreprise créatrice, qui n’est pas définie par les livres de loi, mais par une expérience historique vivante - et cette expérience historique vivante doit être décisive.
Il fut un temps où, pour les gens dont l’identité était douteuse d’un point de vue halakhique, le judaïsme était un fardeau et non un privilège. Il était facile, et c’est parfois encore le cas aujourd’hui, de se débarrasser de ce fardeau. Il y a aujourd’hui un grand nombre de gens qui veulent partager la destinée juive et qui veulent être comptés au nombre des Juifs. C’est un phénomène dont nous sommes tous conscients, et que nous ne devons pas traiter à la légère.
Il y a beaucoup de définitions sensées de ce qu’est un Juif. Il y a la définition orthodoxe et, pour une communauté orthodoxe, elle est parfaitement pertinente et elle conserve son importance. Il y a la définition selon laquelle un Juif est quelqu’un que les autres considèrent comme juif. Nous ne pensons pas que cette définition, très à la mode, soit la meilleure pour ce qui nous concerne, puisque nous voulons autre chose que des gens qu’on nous impose simplement parce que les autres les considèrent comme Juifs. Nous ne pensons pas que ce soit le type le plus désirable de Juif, et je ne pense pas non plus que nous devions y attacher une grande importance.
Il y a des gens qui pensent qu’est juif quiconque se considère lui-même comme Juif1. Et il y a la définition selon laquelle est juif celui qui est né d’un parent juif et se considère lui-même comme juif en assumant le fardeau et le privilège d’être juif. C’est la définition à laquelle je voudrais souscrire, et qui est, selon moi, la conception partagée par la plupart des Juifs d’Europe et d’Amérique.
Il y a de célèbres exemples qui illustrent le paradoxe des définitions traditionnelles. Léopold Bloom, le héros de l’Ulysse de James Joyce, est considéré comme juif par l’auteur, par lui-même, et par tous les autres, mais pas par la halakhah.
Il y a les exemples des enfants de mariages mixtes. Je me souviens du cas d’un physicien célèbre. À la fin de sa vie, il fut en proie à une violente crise de conscience et il découvrit son origine juive. Il était le fils d’un père juif et d’une mère non juive. Il ressemblait à vingt-huit juifs à lui tout seul et se comportait comme deux mille. Il avait l’esprit d’un juif. Sa manière de penser était celle d’un rabbin du Talmud. Cependant, selon la halakhah, il n’était pas juif, et cela le perturbait considérablement. Il avait coutume de nous demander à Mme Scholem et à moi-même : " Que suis je ? " On aurait pu lui répondre : " Vous n’êtes rien ; vous avez découvert que vous n’êtes pas allemand, vous n’êtes pas un autrichien ; vous vous considérez comme juif, mais vous n’êtes pas un juif religieux dans le sens de la halakhah, puisque votre mère n’est pas juive et que vous-même avez été baptisé. " De tels cas sont légion à notre époque. Ces gens devraient-ils être exclus ?
Je ne pense pas que l’origine juive soit le seul élément. Le prosélytisme sera toujours, et devra être, un phénomène marginal. Si quelqu’un veut s’identifier à nous par un acte rituel, je ne vois aucune objection à cela. S’il ressent quelque doute à ce sujet, c’est qu’il ne doit pas le faire. Nous avons émis des critiques envers les Juifs qui se faisaient baptiser dans l’intérêt de leur carrière ; nous avons considéré cela comme de l’hypocrisie. Nous devons être suffisamment honnêtes pour dire que cela s’applique également à notre cas, et que nous ne devrions pas forcer des individus à faire quelque chose qu’ils considèrent comme hypocrite.
Je pense que la menace de division du peuple juif, dont nous entendons tellement parler, est largement exagérée. Il pourrait même en être tout autrement : à savoir que cette division pourrait être le fait de l’autre bord. Au dix-neuvième siècle, en Hongrie, il y avait deux formes différentes de judaïsme officiellement reconnues - le judaïsme réformé, ou néologue, et le judaïsme orthodoxe. Je recommande à chacun de lire la triste histoire du schisme hongrois, provoqué par les orthodoxes, qui déclarèrent qu’ils considéraient les Juifs réformés comme non-Juifs.
Je pense que le gouvernement israélien a commis une grave et malheureuse erreur de jugement en soumettant la présente proposition de loi au Parlement. Je pense qu’elle est malheureuse, parce qu’ils essayent d’imposer des conditions qui sont rejetées par l’opinion publique. C’est une démarche que je déplore profondément et qui ne peut avoir que de fâcheuses conséquences pour la communauté tout entière. Il me semble qu’en donnant le pouvoir aux rabbins, il y a plusieurs années et pour des raisons de commodité politique, M. Ben-Gourion porte une grande part de responsabilité. Ce n’est pas le gouvernement de Golda Meïr qui a commis ce péché originel, mais celui de Ben-Gourion, qui n’aurait d’abord jamais dû accepter de présenter devant la Knesset [le parlement israélien] ?un pun projet de loi imposant la loi rabbinique aux Juifs qui n’en veulent pas, créant, dans un état démocratique comme Israël, une situation qui ne permet pas le mariage civil et n’admet pas que les mariages entre Juifs puissent être célébrés par des rabbins non orthodoxes.
Je ne pense pas que ce que certains appellent des considérations politiques, et que je préfère appeler des compromis politiques, doivent constituer un facteur décisif dans des affaires d’une telle importance. Je ne pense pas que l’État d’Israël, ou toute autre entité juive où que ce soit dans le monde, ait un litige avec les Juifs orthodoxes qui prennent leur tradition au sérieux, en tant qu’héritage sacré, et souhaitent y adhérer ; ils doivent être absolument libres de le faire. Aucune démarche ne peut être entreprise par le peuple juif, que ce soit ici ou ailleurs, qui pourrait de quelque manière leur imposer quelque chose contre leur volonté. Mais je ne peux pas comprendre pourquoi notre peuple doit être soumis, dans sa grande majorité, à une loi qui n’a aucune racine dans notre conscience historique et juive.
Enfin, si vous me demandez de vous donner un conseil, je vous dirais : gardons nos cœurs et nos esprits ouverts aux nouvelles forces qui cherchent à s’exprimer dans notre histoire ; en tant qu’individus juifs, soyons conscients du caractère éphémère de toutes les métamorphoses présentes de la vie juive ; et écoutons la voix qui pourrait bien concevoir et chercher une articulation - cette voix dans laquelle, si nous croyons en Dieu, comme j’y crois moi-même, nous pourrions reconnaître la continuité de ce que nous appelons la voix du Sinaï.
Je définis le sionisme comme un retour utopique des Juifs à leur propre histoire. Avec la réalisation du sionisme, des sources ont jailli du plus profond de notre être historique, libérant de nouvelles forces en nous. Dans l’acceptation de notre propre histoire comme un domaine à l’intérieur duquel poussent nos racines, s’insinue la conviction que les Juifs, après la terrible catastrophe de notre siècle, sont en droit de se définir eux-mêmes en accord avec leurs propres besoins et motivations ; et que l’identité juive est quelque chose non pas de fixe et de statique, mais de dynamique et même de dialectique, puisque dans ses aspects spirituels, non moins que dans ses aspects sociaux et politiques, elle implique un organisme vivant et créateur d’individus qui se nomment eux-mêmes Juifs.
05:46 Publié dans Judaïca | Lien permanent | Commentaires (0)
18/07/2008
Le droit des enfants de voter
 Qu'est-ce que le suffrage universel? La question a été régulièrement posée depuis que le principe et sa différance, forment l'horizon de notre démocratie. Au nom du peuple, oui, mais lequel? Condorcet avait déjà fait ce rêve, fou, de vouloir reconnaître le droit de suffrage aux femmes et de préparer les enfants, ce véritable dauphin démocratique, à leurs charges futures. Au nom du droit des génération future, cette anticipation de la souveraineté populaire, à la pointe de la flêche du temps, un groupe de députés allemands. Intitulée "Donner une voix à l'avenir Pour le droit de vote dès la naissance", a introduit une motion introduite au Bundestag proposant le droit de vote des nouveaux-nés. Les 46 élus sociaux-démocrates (SPD), conservateurs (CDU-CSU) et libéraux (FDP) demandent que le gouvernement soumette une proposition de loi pour mettre fin à une situation où "14 millions de citoyens allemands sont exclus du droit de vote, et ce en raison de leur âge uniquement". Il appartiendrait aux parents de l'exercer en leur nom jusqu'à ce que les jeunes se sentent assez "mûrs".
Qu'est-ce que le suffrage universel? La question a été régulièrement posée depuis que le principe et sa différance, forment l'horizon de notre démocratie. Au nom du peuple, oui, mais lequel? Condorcet avait déjà fait ce rêve, fou, de vouloir reconnaître le droit de suffrage aux femmes et de préparer les enfants, ce véritable dauphin démocratique, à leurs charges futures. Au nom du droit des génération future, cette anticipation de la souveraineté populaire, à la pointe de la flêche du temps, un groupe de députés allemands. Intitulée "Donner une voix à l'avenir Pour le droit de vote dès la naissance", a introduit une motion introduite au Bundestag proposant le droit de vote des nouveaux-nés. Les 46 élus sociaux-démocrates (SPD), conservateurs (CDU-CSU) et libéraux (FDP) demandent que le gouvernement soumette une proposition de loi pour mettre fin à une situation où "14 millions de citoyens allemands sont exclus du droit de vote, et ce en raison de leur âge uniquement". Il appartiendrait aux parents de l'exercer en leur nom jusqu'à ce que les jeunes se sentent assez "mûrs".
L'idée n'est pas nouvelle. Elle a pour la première fois été esquissée par Carl Friedrich Goerdeler (un résistant antinazi décapité en février 1945), dans un manifeste sur l'avenir politique de l'Allemagne rédigé en prison. Elle participe d'une volonté d'émancipation des enfants qui va de l'abaissement de la majorité sexuelle, au droit des enfants d'avoir des relations sexuelles avec des adultes (Pays-Bas) ou du droit pour les enfants malades en stade terminal de décider de leur euthanasie (Pays-Bas encore). Bref, elle participe d'une émancipation des enfants et d'une relativisation de leur minorité (en l'occurence, il n'y en aurait plus).
Mais en Allemagne cette revendication des enfants pour l'exercice des droits civiques complet a fait l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle. En 1995, Benjamin Kiesewetter et Rainer Kintzel, qui avaient alors 15 et 12 ans, ont saisi la Cour constitutionnelle d'une plainte dans laquelle ils faisaient valoir que la limitation de l'âge du droit de vote à "dix-huit ans révolus" dans l'article 38 de la loi fondamentale contredisait l'article 20, de portée plus générale, aux termes duquel "tout pouvoir d'État émane du peuple", en arguant qu'ils étaient aussi "du peuple". La discrimination contre les jeunes de leur naissance à leur majorité était ici mise en cause. Les juges de Karlsruhe avaient refusé d'examiner leur plainte, mais pour des raisons de forme, la contestation d'une loi devant intervenir au plus tard un an après son adoption.
Nouvel essai en 1998, avant les législatives. Robert Rostoski, avant ses 18 ans, essaie de se faire inscrire sur les listes électorales à Berlin. Il fait appel du refus et, cette fois-ci, la Cour constitutionnelle le déboute sur le fond.
Le Bundestag entre en jeu en 2003 lorsque 47 députés dont le président Wolfgang Thierse (SPD) relancent l'idée. Ils font notamment valoir l'inéluctable vieillissement démographique de la population qui, disent-ils, conduira les responsables politiques à délaisser les intérêts des jeunes pour satisfaire les desiderata d'un électorat vieux de plus en plus important. "Il y a deux cents ans, relevait alors le député FDP Klaus Haupt, personne ne pouvait imaginer que tout citoyen mâle aurait le droit de vote, il y a cent ans personne ne pensait que les femmes allaient l'obtenir."
La discussion au Bundestag qui a suivi cette initiative, tout comme l'introduction d'un projet de loi en 2005 par le même groupe n'ont cependant pas fait avancer la cause de ceux que l'hebdomadaire Der Spiegel a appelés les "électeurs en Pampers". Sauf miracle, ce sera encore le cas cette fois-ci.
Si le droit de vote était un jour reconnu aux enfants, plusieurs conséquences paradoxales en découleraient. D'abord, l'exercice de ce vote, du moins pour les plus petits, serait assuré par les parents ou par le titulaire de l'autorité parentale. On ressuciterait l suffrage plural, en vigueur en Belgique en 1899, et permettant au chef de famille de voter plusieurs fois, selon un coéficient qui égalerait le nombre de ses enfants. Dans l'hypothèse d'un divorce, la femme étant le plus souvent titulaire du droit de garde, exercerait le droit de vote, de sorte que l'on aboutirait à une féminisation du vote contraire au principe de la parité. Mais surtout, ne serait-on pas ammené à étendre le droit de vote aux embryons, en application de l'adage bien connu et ici même rappelé il y a quelques semaines: infans conceptus pro nato habetur, l'enfant conçu est présumé né (chaque fois qu'il y va de son intérêt). Ainsi, ce ne sont plus les morts que l'on ferait voter, comme autrefois Barrès, ce ventriloque des tombeaux, ou, avec moins de talent, Tiberi, mais des âmes sans corps, de purs esprits invoqués le jour du suffrage, des idées d'enfants. Isoloirs, isoloirs, avez-vous donc une âme? La fiction de la démocratie apparait enfin au grand jours...
14:45 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
16/07/2008
Le droit de porter la burqa
 "La burqa est-elle incompatible avec la nationalité française ?" Posée ainsi, comme le fait Le Monde dans son édition du jour, la question est polémique. Mais ainsi: "une certaine pratique de la religion est-elle incompatible avec les principes de la République ?" La réponse est évidente. Pas besoin d'être bon républicain ou militant laïcard pour y répondre. Une Marocaine de 32 ans, mariée à un Français et mère de trois enfants nés en France, s'est récemment heurtée à cette barrière conceptuelle et s'est vue refuser la nationalité au motif qu'elle "a adopté, au nom d'une pratique radicale de sa religion, un comportement en société incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment le principe d'égalité des sexes". Ce n'est pas la première fois que le degré de pratique religieuse est pris en compte pour se prononcer sur la capacité d'assimilation d'une personne étrangère, mais c'est la première fois qu'une pratique purement privée, sans menace de trouble à l'ordre public, est prise en compte de manière aussi caractérisée. Jusqu'à présent seules des personnes jugées proches de mouvements fondamentalistes ou ayant publiquement tenu des propos relevant de l'islam radical se sont vu refuser la nationalité française. Mais dans le cas de Faiza M., ce sont sa tenue vestimentaire et sa vie privée qui sont seules prises en considération pour lui refuser la nationalité française. Alors que depuis son arrivée en France elle n'a jamais "jamais cherché à remettre en cause les valeurs fondamentales de la République ", qu'elle n'a pris aucune position publique, qu'elle ne s'est pas non plus refusé à être examinée par un gynécologue homme lors de ses deux grossesses, mais sur le seul fait objectif de son adhésion aux principes de l'islam radical, M. M. se voit refuser l'acquisition de la nationalité française alors que, par ailleurs, elle remplit toutes les autres conditions, y compris de maîtrise de la langue française. La liberté de conscience trouve ici sa limite dans un défaut d'assimilation qui lui est reproché.
"La burqa est-elle incompatible avec la nationalité française ?" Posée ainsi, comme le fait Le Monde dans son édition du jour, la question est polémique. Mais ainsi: "une certaine pratique de la religion est-elle incompatible avec les principes de la République ?" La réponse est évidente. Pas besoin d'être bon républicain ou militant laïcard pour y répondre. Une Marocaine de 32 ans, mariée à un Français et mère de trois enfants nés en France, s'est récemment heurtée à cette barrière conceptuelle et s'est vue refuser la nationalité au motif qu'elle "a adopté, au nom d'une pratique radicale de sa religion, un comportement en société incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment le principe d'égalité des sexes". Ce n'est pas la première fois que le degré de pratique religieuse est pris en compte pour se prononcer sur la capacité d'assimilation d'une personne étrangère, mais c'est la première fois qu'une pratique purement privée, sans menace de trouble à l'ordre public, est prise en compte de manière aussi caractérisée. Jusqu'à présent seules des personnes jugées proches de mouvements fondamentalistes ou ayant publiquement tenu des propos relevant de l'islam radical se sont vu refuser la nationalité française. Mais dans le cas de Faiza M., ce sont sa tenue vestimentaire et sa vie privée qui sont seules prises en considération pour lui refuser la nationalité française. Alors que depuis son arrivée en France elle n'a jamais "jamais cherché à remettre en cause les valeurs fondamentales de la République ", qu'elle n'a pris aucune position publique, qu'elle ne s'est pas non plus refusé à être examinée par un gynécologue homme lors de ses deux grossesses, mais sur le seul fait objectif de son adhésion aux principes de l'islam radical, M. M. se voit refuser l'acquisition de la nationalité française alors que, par ailleurs, elle remplit toutes les autres conditions, y compris de maîtrise de la langue française. La liberté de conscience trouve ici sa limite dans un défaut d'assimilation qui lui est reproché.
Quels sont les éléments constitutifs de ce défaut d'assimilation? D'après le commissaire du gouvernement, Emmanuelle Prada-Bordenave, la tenue de Faiza M est un premier élément. A trois reprises, Faiza M. se serait présentée "recouverte du vêtement des femmes de la péninsule arabique, longue robe tombant jusqu'aux pieds, voile masquant les cheveux, le front et le menton et une pièce de tissu masquant le visage et ne laissant voir les yeux que par une fente". Par ailleurs, le couple reconnaît "spontanément" son appartenance au salafisme. Mais c'est peut être l'évolution même de Faiza M. qui a retenu l'attention du commissaire du gouvernement, une évolution personnelle qui ne va pas dans le sens d'une adhésion aux principes de la République. Faiza M. a en effet reconnu qu'elle n'était pas voilée quand elle vivait au Maroc et a indiqué "qu'elle n'a adopté ce costume qu'après son arrivée en France à la demande de son mari et qu'elle le porte plus par habitude que par conviction". Enfin "D'après ses propres déclarations, a souligné la commissaire du gouvernement, elle mène une vie presque recluse et retranchée de la société française. Elle n'a aucune idée sur la laïcité ou le droit de vote. Elle vit dans la soumission totale aux hommes de sa famille ." Faiza M. semble "trouver cela normal et l'idée même de contester cette soumission ne l'effleure même pas", a ajouté Mme Prada-Bordenave, estimant que ces déclarations sont "révélatrices de l'absence d'adhésion à certaines valeurs fondamentales de la société française".
Cette décision montre bien que la liberté de conscience, comme l'ensemble des libertés, que l'on présente généralement comme des droits fondamentaux, inaliénables, naturels, intangibles, irrévocables, etc, ne sont que des permissions de l'Etat. D'un Etat plus ou moins tolérant, certes, plus ou moins libéral, mais qui n'accorde de libertés qu'autant qu'elles sont compatibles avec l'ordre public, lequel ne s'entend pas seulement comme un ordre matériel mais comme un ordre spirituel. La brave Faiza M. ne fait de tort à personne en vivant chez elle recluse et soumise, mais elle porte atteinte aux consciences et à l'ordre public spirituel qui découle de nos principes républicains et cette seule interférence avec le monde des idées suffit à justifier son exclusion de la communauté nationale.
On ajoutera que dans la présente affaire, la nationalité française a été refusée à Faiza M. mais que rien, absolument rien ne s'opposerait demain à ce que la nationalité française soit retirée à une personne portant un tel trouble à l'ordre public spirituel et aux consciences. Toute communauté, pour se définir comme communauté, génère ses propres limites et trace une frontière spirituelle qui réfute tous les cosmopolitismes. Le Conseil d'Etat vient de retrouver ainsi, dans les méandre d'une jurisprudence compliquée mais en pleine évolution, le vieux principe de la constitution des solidarités: Mme Faiza n'est pas des nôtres. Il n'en a pas tiré les conclusions qu'il aurait pu en tirer parce que la velléité succède à la décision: "sa vie n'est pas ici". Mais, dans la stupeur de notre déclin, il a rappelé le vieux principe de l'amitié et de l'inimitié.
17:08 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
27/06/2008
Le droit de porter des armes
 La Cour suprême des Etats-Unis a pour la première fois confirmé le droit de chaque citoyen américain à disposer d'une arme pour son usage personnel et invalidé une loi qui en limite le port dans la capitale fédérale.
La Cour suprême des Etats-Unis a pour la première fois confirmé le droit de chaque citoyen américain à disposer d'une arme pour son usage personnel et invalidé une loi qui en limite le port dans la capitale fédérale.
La municipalité de Washington a interdit la détention d'armes de poing et exige que les propriétaires de fusil conservent leurs armes déchargées, démontées ou neutralisées.
La plus haute juridiction du pays ne s'était pas penchée depuis 1939 sur le deuxième amendement de la Constitution, qui donne lieu à des lectures totalement divergentes. Elle n'avait pu alors trancher le débat constitutionnel.
Certains y voient la reconnaissance du droit de chaque individu à détenir une arme; les autres estiment qu'il s'agit d'un droit collectif qui ne peut être reconnu qu'en relation avec une affectation dans un service de police ou de garde.
Par cinq voix contre quatre, les magistrats ont estimé que le deuxième amendement protégeait le droit de chaque individu à posséder une arme et à en faire usage dans le cadre prévu par la loi.
Un individu peut ainsi utiliser son arme en cas de légitime défense dans sa maison, a expliqué le juge Antonin Scalia.
Il a toutefois précisé que ce droit, bien qu'étant constitutionnel, comportait certaines limites et a souligné que la décision de la Cour suprême ne remettait pas en cause les réglementations qui encadrent depuis longtemps la détention et le port d'arme.
C'est la première fois que la Cour suprême invalide une législation sur le port et la détention d'armes au motif qu'elle est contraire au deuxième amendement. Sa décision pourrait donner lieu à une série de recours contre les lois locales sur le contrôle des armes adoptées pour lutter contre la criminalité.
Sur cette question très sensible aux Etats-Unis, la majorité des magistrats, dont les deux juges nommés par le président George Bush, John Roberts et Samuel Alito, ont tranché en faveur de la ligne défendue par les libéraux-conservateurs.
"Nous sommes heureux que la Cour suprême ait affirmé que le deuxième amendement protège le droit des Américains à posséder et porter une arme", a déclaré le porte-parole de la Maison blanche Tony Fratto.
En revanche, l'un des quatre magistrats de la Cour suprême qui avait exprimé un avis contraire, a estimé que cette décision "menace de remettre en question la constitutionnalité des lois sur les armes dans tous les Etats-Unis".
Le candidat du Parti républicain à l'élection présidentielle, John McCain, s'est réjoui de la décision de la Cour suprême.
"A la différence d'une certaine conception élitiste qui considère que les Américains s'accrochent aux armes par amertume, ce jugement reconnaît que posséder une arme est un droit fondamental, sacré, toute comme la liberté d'expression et de réunion", a déclaré le sénateur de l'Arizona, faisant référence aux propos tenus par son rival démocrate Barack Obama. Pendant la campagne des primaires, le sénateur de l'Illinois a déclaré que les habitants des petites villes, amers, se raccrochaient aux armes et à la religion.
Les Etats-Unis détiennent le record du nombre d'habitants possédant une arme à feu. Les armes à feu font chaque jour 80 morts en moyenne aux Etats-Unis, selon les statistiques des Centers for Disease Control. Sur les 80 décès, il s'agit dans 34 cas d'un homicide.
Ecrit il y a plus de 200 ans, le deuxième amendement de la constitution américaine déclare: "Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un Etat libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé".
Reuters, jeudi 26 juin 2008, Jeremy Pelofsky, version française Jean-Philippe Lefief et Gwénaëlle Barzic
06:44 Publié dans Justice | Lien permanent | Commentaires (4)
26/06/2008
infans conceptus pro nato habetur
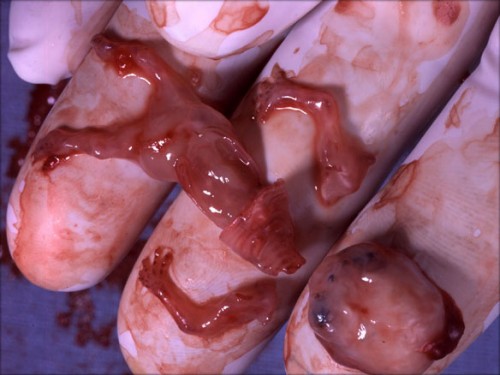 Quotidien du médecin, 18 janv. 2008
Quotidien du médecin, 18 janv. 2008
Le droit de la famille n'en finit plus de (se ?) nourrir (de) la rubrique des faits divers ! Et comme toujours en la matière, les pays anglo-saxons sont le plus souvent à la pointe de l'actualité, nous laissant entrevoir un futur possible aux accents d'une dangereuse réalité (V. P. Murat, Droit de la famille 2030 : Dr. famille 2008, repère 1). L'histoire débute aux États-Unis en 1990 avec le mariage d'un couple qui ne parvient pas à avoir d'enfants et qui recourt à la procréation médicale assistée. Par fécondation in vitro, plusieurs embryons sont créés en juin 2001 mais les deux tentatives d'implantation des embryons échouent. Au décès du mari un mois plus tard, restent deux embryons congelés. En juin 2002, la veuve décide d'une grossesse en « utilisant » ces embryons congelés. Un enfant naît dont le lien de filiation est établi à l'égard des deux parents. Confrontée à des difficultés financières, la mère effectue une demande de versement auprès de l'assurance sociale de son mari, à son profit et à celui de l'enfant. Les services sociaux opposent un refus arguant du fait que la loi ne considère comme héritiers que les enfants conçus avant le décès du père. Se pose alors la question de savoir si la date de conception de l'embryon est celle de la fécondation in vitro ou bien seulement celle du début de la grossesse de la mère. À cette question, la Cour suprême de l'Arkansas refuse de répondre estimant que c'est au Parlement de l'État de se prononcer. La Cour souligne cependant le vide législatif en la matière, aucun texte ne prévoyant explicitement de « permettre à un enfant créé par fécondation in vitro et implanté après le décès du père d'hériter ».
L'application classique de la maxime infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodies ejus agitur, dont l'arrêt Héranval demeure l'exemple traditionnel, conduirait ici à tenir pour né un embryon congelé parce qu'il irait de son avantage de le faire bénéficier d'un droit patrimonial. Alors certes, le législateur français a pris soin d'écarter en 1994 comme en 2004, la poursuite d'une procréation médicale assistée post mortem. Le fait divers américain ne doit toutefois pas manquer d'inviter à la prudence ceux qui réfléchissent à la loi bioéthique de demain et qui seraient tentés d'admettre, en 2009 au nom d'une certaine mondialisation du droit de la famille, une technique qui devient périlleuse si elle peut être utilisée post mortem (V. déjà, pour un couple séparé, CEDH, 7 mars 2006, Evans c/ Royaume-Uni).
Le péril est d'autant plus important que dans le même temps, on apprend d'une part qu'au Royaume-Uni, près de 1 200 000 embryons n'ont pas été utilisés sur les 2 137 924 créés dans le cadre d'un processus de procréation médicale assistée entre 1991 et 2005 et d'autre part, que la société californienne Stemagen a annoncé, le jeudi 17 janvier dernier, avoir créé cinq blastocystes (embryons âgés de cinq à sept jours) humains par clonage à partir de cellules de peau d'adultes et de vingt-cinq ovocytes prélevés sur des donneuses.
Ce sont donc des millions d'embryons congelés dans le monde qui pourraient être bénéficiaires de la maxime infans conceptus (à condition rappelons le, qu'ils finissent par naître vivants et viables). Il est toujours particulièrement intéressant de constater l'utilisation de techniques juridiques (ici une fiction) à des fins qui ne pouvaient être imaginées par ceux qui ont conçu ces techniques. On notera que jusqu'à une date récente, la médecine ne permettait pas une détermination scientifique de la date de la conception et que cette détermination demeure encore parfois aujourd'hui quelque peu approximative. C'est la raison d'être de l'article 311 du Code civil, dont la rédaction est bien évidemment antérieure aux prouesses de la procréation médicale assistée et qui énonce que l'enfant est présumé avoir été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La présomption contenue dans le texte qui demeure simple, pourrait être ainsi balayée en cas de procréation médicale assistée : on retrouve l'inadaptation souvent dénoncée du droit commun de la filiation en matière de PMA. La date de la conception, scientifiquement établie si la procréation n'est pas naturelle, pourrait alors devenir le point de départ de la maxime infans conceptus.
Au-delà des principes du droit de la filiation, au-delà des valeurs et des symboles, ce sont les aspects techniques patrimoniaux et plus particulièrement successoraux qui sont aussi en jeu. Imaginons que l'ensemble des embryons non utilisés lors du décès du père puisse potentiellement être utilisé par la mère pour mener à terme une grossesse et ce sont toutes les liquidations de successions qui sont désormais soumises à une condition potestative. Sauf à exiger de la mère une renonciation à la possibilité de recourir à une PMA post mortem (renonciation à un droit subjectif ?) ou bien encore à requérir la production lors du règlement de la succession d'un extrait des registres des PMA attestant l'absence d'héritiers potentiels du défunt (une sorte de conservation des hypothèques pour embryons congelés...), la pratique notariale devrait alors appliquer un principe de précaution face à ce qui deviendrait un « risque procréatif ». Car à n'en pas douter, si la procréation post mortem devient une réalité en France, la date de la conception devra être retenue pour l'application de la maxime infans conceptus, en fonction bien évidemment de l'intérêt supérieur de l'enfant !
14:13 Publié dans Bioéthique | Lien permanent | Commentaires (5)
18/05/2008
Vivre en troupeau en se pensant libres
L’individualisme n’est pas la maladie de notre époque, c’est l’égoïsme, ce self love, cher à Adam Smith, chanté par toute la pensée libérale. L’époque est à la promotion de l’égoïsme, la production d’ego d’autant plus aveugles ou aveuglés qu’ils ne s’aperçoivent pas combien ils peuvent être enrôlés dans des ensembles massifiés. Et c’est bien d’ego qu’il s’agit, puisque les gens se croient égaux alors qu’en réalité ils sont passés sous le contrôle de ce qu’il faut bien appeler le « troupeau ». Celui des consommateurs, en l’occurrence.
Vivre en troupeau en affectant d’être libre ne témoigne de rien d’autre que d’un rapport à soi catastrophiquement aliéné, dans la mesure où cela suppose d’avoir érigé en règle de vie un rapport mensonger à soi-même. Et, de là, à autrui. Ainsi ment-on effrontément aux autres, ceux qui vivent hors des démocraties libérales, lorsqu’on leur dit qu’on vient – avec quelques gadgets en guise de cadeaux, ou les armes à la main en cas de refus – leur apporter la liberté individuelle alors qu’on vise avant tout à les faire entrer dans le grand troupeau des consommateurs.
Mais quelle est la nécessité de ce mensonge ? La réponse est simple. Il faut que chacun se dirige librement vers les marchandises que le bon système de production capitaliste fabrique pour lui. « Librement » car, forcé, il résisterait. La contrainte permanente à consommer doit être constamment accompagnée d’un discours de liberté, fausse liberté bien sûr, entendue comme permettant de faire « tout ce qu’on veut ».
Notre société est en train d’inventer un nouveau type d’agrégat social mettant en jeu une étrange combinaison d’égoïsme et de grégarité que j’épinglerai du nom d’« égo-grégaire ». Il témoigne du fait que les individus vivent séparés les uns des autres, ce qui flatte leur égoïsme, tout en étant reliés sous un mode virtuel pour être conduits vers des sources d’abondance. Les industries culturelles (1) jouent ici un grand rôle : la télévision, Internet, une bonne partie du cinéma grand public, les réseaux de la téléphonie portable saturés d’offres « personnelles »...
La télévision est avant tout un média domestique, et c’est dans une famille déjà en crise qu’elle est venue s’installer. On a parlé de l’« individualisation », de la « privatisation » et de la « pluralisation » de la famille, issues de la désarticulation inédite des liens de conjugalité et des liens de filiation. Certains auteurs évoquent même une « désinstitutionnalisation » qui serait à rattacher à la chute des relations d’autorité et à la montée de relations d’égalité. De groupe structuré par des pôles et des rôles, la famille devient un simple groupement fonctionnel d’intérêts économico-affectifs : chacun peut vaquer à ses occupations propres, sans qu’il s’ensuive des droits et des devoirs spécifiques pour personne. Par exemple, chacun – père, mère ou enfants – ira grappiller dans le réfrigérateur de quoi se sustenter aux heures où il lui faudra apaiser sa faim avant de retourner dans sa chambre devant la télé ou la vidéo sans en passer par le rituel commun du repas.
Ces aspects sont connus. Ce qui l’est moins, ce sont les modifications introduites par l’usage de la télévision. Celle-ci change en effet les contours de l’espace domestique en affaiblissant encore le rôle déjà réduit de la famille réelle et en créant une sorte de famille virtuelle venue s’adjoindre à la précédente. Certaines études nord-américaines l’appellent depuis longtemps déjà le « troisième parent » (2). On devrait prendre cette expression au pied de la lettre et non pas la considérer comme une simple métaphore, tant ce troisième parent occupe souvent une place plus importante que les deux premiers.
Ce nouveau parent amène avec lui, dans l’espace désormais désinstitutionnalisé de l’ancienne famille, la sienne propre, qui, pour être virtuelle, n’en est pas moins envahissante. Ce troisième parent pour les enfants, qui est en même temps le meilleur ami de la famille pour les vrais parents, constitue en somme le vecteur qui permet d’abouter aux restes de la famille réelle une nouvelle famille virtuelle. Cette extension s’est d’autant plus facilement imposée que la propagation des postes de télévision s’est répandue dans tout l’espace privé : en plus du poste trônant au centre du foyer, dans le salon, comme il y a une génération, on en trouve désormais jusque dans les chambres des enfants (3).
Cette extension virtuelle de la famille permise par le troisième parent a été peu perçue par les sciences sociales. Elle avait pourtant été parfaitement repérée par la littérature, dès les débuts du règne de la télévision. En 1953, dans son saisissant roman d’anticipation Fahrenheit 451, l’auteur américain Ray Bradbury montrait plusieurs aspects du problème dont on n’a souvent retenu qu’un seul : une société où la télévision a pris la place du livre (4). Un film, réalisé par François Truffaut en 1966, en a été tiré : l’action se situe dans un avenir proche où la société juge les livres dangereux, les considère comme un obstacle à l’épanouissement des gens.
Si la question du rapport télévision/livre a bien été perçue, on a peu pris en compte la seconde question décisive que posait cette histoire : la télévision comme nouvelle famille. Cet aspect est pourtant très présent au travers du grand rôle joué dans le récit par l’épouse de Montag. Mildred (Linda, dans le film) est complètement assujettie au système de vie aseptisée et obligatoirement heureuse instauré par le « Gouvernement ». Elle consomme autant de pilules qu’il en faut pour éviter toute anxiété. Et, surtout, elle vit avec la télévision, qui se trouve dans toutes les pièces du foyer et qui couvre toute la surface du mur (le récit a un peu d’avance sur notre technologie, mais heureusement nous avons déjà des écrans plats de plus en plus grands).
Ces « murs parlants », comme le narrateur les nomme, représentent ce qu’elle appelle sa « famille », dont les personnages virtuels vivent tous les jours dans le salon de Mildred. L’ambition la plus significative de l’héroïne est même de se payer un jour un quatrième mur-écran pour améliorer... la vie de famille.
La force du roman est d’avoir su, très tôt, révéler ce trait : cependant que la famille réelle – avec ses codes, ses lieux et ses hiérarchies – disparaissait lentement, elle se trouvait remplacée par une nouvelle communauté immense et volatile, amenée par la télévision. Dès 1953, Bradbury avait saisi que, désertant les anciens rapports sociaux réels, les téléspectateurs se mettaient à appartenir à une même « famille » en ayant soudain les mêmes « oncles » raconteurs d’histoires drôles, les mêmes « tantes » gouailleuses, les mêmes « cousins » dévoilant leurs vies.
Ainsi, les très nombreux talk-shows et autres émissions de divertissement diffusés aujourd’hui par les chaînes généralistes fournissent toute une galerie de portraits de famille : du timide impénitent au hâbleur incorrigible, en passant par le râleur patenté, l’ex-militant recyclé en paillettes, le prof idiot, l’écolo de la bonne bouffe, le cynique un peu gaulois, la blonde pétulante à anatomie renforcée, l’éternelle idole des jeunes, le crooner du troisième âge, la star du porno en défenseur des droits de l’homme, l’homosexuel dans toutes ses déclinaisons, le handicapé rigolo, la drag-queen tout-terrain, le penseur attitré, le beur volubile, les acteurs avec leurs lubies, les sportifs au grand cœur, le défenseur des bonnes causes perdues d’avance, et même le psychanalyste plein de sous-entendus freudo-lacaniens... Soit une centaine de personnes circulant sans cesse d’une chaîne à l’autre et valant de l’or, bref, ceux qu’on appelle aujourd’hui les people, derrière lesquels courent les responsables politiques en mal d’audience.
On trouve désormais ses cousins, ses oncles et ses tantes en zappant et, en plus, ils sont drôles ou du moins supposés tels. Ce que les histoires de famille (les petites et les grandes, les comiques et les tragiques) n’apportent plus, c’est désormais la « famille » de la télévision qui est appelée à le fournir. C’est elle qui console les esseulés et anime les groupes en manque de verve. Non seulement la « télé » fournit une « famille », mais elle constitue ceux qui la regardent en grande famille. Chacun se confie à tous dans un idéal de transparence où l’on ne peut plus rien se cacher. A longueur d’émissions, les « secrets de famille » les mieux gardés sont tous éventés ; aucun ne résiste aux grands déballages. Sous le soleil de Big Brother, chacun doit tout dire à tous. Même les adolescents et les jeunes adultes en passent par le confessionnal de « Loft Story » ou de « Star Academy » (5). La nouveauté de ces émissions, c’est que cette « famille », le téléspectateur peut désormais la composer à son gré – par exemple en tapant 1 s’il veut soutenir Cyril ou 2 s’il veut éloigner Elodie...
On pourrait se demander : après tout, pourquoi pas cette virtualisation des rapports familiaux ? N’est-ce pas là le cours même de l’histoire ? De sorte qu’il n’y aurait aucune raison de porter un jugement dépréciatif sur la période actuelle, surtout si c’est pour mieux valoriser celle qui n’existe plus. D’ailleurs, le temps où l’on étouffait dans les familles réelles n’est pas si loin. Le fameux : « Famille, je vous hais » d’André Gide, repris par les étudiants de 1968, ne remonte qu’à une ou deux générations. En ce sens, ne faut-il pas mieux une « famille » virtuelle qu’une vraie famille sachant que, quand on en est vraiment fatigué, il suffit de tourner le bouton sans avoir, comme autrefois, à « tuer le père » ?
La réponse est simple : le téléspectateur qui aime les personnages de cette « famille » ne peut évidemment pas être payé de retour car ceux-ci, étant virtuels, ne peuvent qu’être parfaitement indifférents à son sort. Sauf, évidemment, si celui-ci devient médiatisable. Dans ce cas, on fera entrer le personnage malheureux « dans » le poste, et des surdémonstrations d’amour lui seront données, comme pour faire oublier la non-réciprocité fondamentale du média.
De là s’ensuivent une autre question et une nouvelle réponse. Pourquoi y a-t-il lieu de faire toute cette dépense en technologie (des caméras, des techniciens, des grilles de programmes, des satellites, des réseaux, etc.) et en investissements divers (financiers, libidinaux, etc.) si c’est pour ne pas faire vraiment exister les sujets qui regardent la télévision en y passant tant de temps ? La « famille » serait-elle le règne du pur divertissement pascalien ? On le sait, il était autrefois concentré sur le roi dans la mesure où ce dernier soutenait tout le monde cependant que personne ne le soutenait. Ainsi, pour échapper au risque majeur de mélancolisation du roi, il n’y avait d’autres moyens que de le divertir en permanence. Nous serions dans une situation similaire aujourd’hui, à la différence près que tout le monde, dans les démocraties de marché, devrait être diverti.
Mais divertir le sujet ne suffit pas. Loin s’en faut. On peut mieux faire. Si ce n’est pas au premier chef l’existence subjective de l’autre qui préoccupe cette « famille », c’est tout simplement parce que rien ne la préoccupe, dans la mesure où elle n’est elle-même qu’un leurre. Derrière se cache la seule réalité consistante, l’audience (une audience fidélisée par le simulacre), qui se mesure, se découpe en parts afin de pouvoir se vendre et s’acheter sur le marché des industries culturelles.
S’il reste un esprit assez naïf pour croire que la qualité des émissions entre en ligne de compte dans la programmation, il risque fort de déchanter dès la première investigation. Seule compte l’audience, car c’est uniquement elle qui influe sur les affaires sérieuses : le prix des espaces publicitaires. Règle qu’un directeur des programmes de TF1, par ailleurs enseignant à Dauphine et à la Sorbonne, a énoncée à l’usage des apprentis programmateurs : « Il est inutile d’augmenter les coûts pour provoquer un programme meilleur que celui qu’on diffuse si vous avez déjà la meilleure audience (6). »
On connaît désormais les propos tenus à l’origine en petit comité par M. Patrick Le Lay, président de TF1 : « Nos émissions ont pour vocation de rendre [le cerveau du téléspectateur] disponible : c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible. Rien n’est plus difficile que d’obtenir cette disponibilité (7). »
C’est donc bien cela qu’il faut élucider : la façon précise dont est obtenue cette disponibilité. Or, s’il n’existe aucune autre activité sociale qui soit plus évaluée que la consommation télévisuelle, ces mesures ne disent quasiment rien sur la subjectivité des publics. C’est pourquoi il convient d’inventorier cette vaste zone d’ombre où de l’énergie psychique est captée pour être convertie en audience. Je forme donc ici l’hypothèse que ce qui permet à cette audience de se constituer comme fidèle s’explique par le fonctionnement de la télévision comme famille virtuelle de substitution.
Prendre en considération cette « famille » est indispensable à qui veut vraiment décrire et penser notre monde et ses sujets. Cela permet d’en percer la vraie nature. Ainsi Bernard Stiegler, dans un vif petit livre à propos de la télévision et de la misère symbolique, indique que « [l’audiovisuel] engendre des comportements grégaires et non, contrairement à une légende, des comportements individuels. Dire que nous vivons dans une société individualiste est un mensonge patent, un leurre extraordinairement faux (...). Nous vivons dans une société-troupeau, comme le comprit et l’anticipa Nietzsche (8) ».
La famille en question serait donc en fait un « troupeau », qu’il ne s’agirait plus que de conduire là où l’on veut qu’il aille s’abreuver et se nourrir, c’est-à-dire vers des sources et des ressources clairement désignées. Ce n’est pas à Friedrich Nietzsche, dont les qualités de grand démocrate restent à démontrer, que je me référerai, mais à Emmanuel Kant et à Alexis de Tocqueville.
Kant développe le thème de la mise en troupeau des hommes dans Qu’est-ce que les Lumières ? (1784). Elle intervient, pour lui, dès lors que les hommes renoncent à penser par eux-mêmes et qu’ils se placent sous la protection de « gardiens qui, par “bonté”, se proposent de veiller sur eux. Après avoir rendu tout d’abord stupide leur troupeau [Hausvieh, littéralement « bétail domestique »], et soigneusement pris garde que ces paisibles créatures ne puissent oser faire le moindre pas hors du parc où ils sont enfermés, ils leur montrent ensuite le danger qu’il y aurait de marcher tout seul ». A la liste des gardiens du troupeau avancée par Kant – le mauvais prince, l’officier, le percepteur, le prêtre, qui disent : « Ne pensez pas ! Obéissez ! Payez ! Croyez ! » –, il convient évidemment d’ajouter aujourd’hui le marchand, aidé du publicitaire ordonnant au troupeau de consommateurs : « Ne pensez pas ! Dépensez ! »
Quant à Tocqueville, il est remarquable que cet éminent penseur de la démocratie ait envisagé la possibilité de la mise en troupeau des populations lorsqu’il s’interrogeait sur le type de despotisme que les nations démocratiques devaient craindre. La notion de « troupeau » apparaît justement, en 1840, lorsqu’il indique que la passion démocratique de l’égalité peut « réduire chaque nation à n’être plus qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux » délivrés du « trouble de penser » (9). Et de fait, c’est vrai : dans le troupeau, nous sommes tous vraiment égaux.
Après la prolétarisation des ouvriers, le capitalisme a procédé à la « prolétarisation des consommateurs ». Pour absorber la surproduction, les industriels ont développé des techniques de marketing visant à capter le désir des individus afin de les inciter à acheter toujours davantage (10). Les théories de Sigmund Freud ont alors été mises à profit, via leur adaptation au monde de l’industrie qu’a réalisée... son neveu américain Edward Bernays. Ce dernier a exploité (d’abord pour le fabricant de cigarettes Philip Morris) les immenses possibilités d’incitation à la consommation de ce que son oncle appelait l’« économie libidinale (11) ».
Le génie de Bernays, c’est d’avoir vu très tôt le parti qu’il pouvait tirer des idées de Freud. En effet, dès 1923, dans Crystallizing Public Opinion, il explique que les gouvernements et les annonceurs peuvent « enrégimenter l’esprit comme les militaires le font du corps ». Cette discipline peut être imposée en raison « de la flexibilité inhérente à la nature humaine individuelle ». Bernays indique que « la solitude physique est une vraie terreur pour l’animal grégaire [gregarious animal], et que la mise en troupeau lui cause un sentiment de sécurité. Chez l’homme, cette crainte de la solitude suscite un désir d’identification avec le troupeau et avec ses opinions ».
Mais, une fois dans le « troupeau », l’« animal grégaire » souhaite toujours exprimer son avis. Par conséquent, les communicateurs doivent « faire appel à son individualisme [qui] va étroitement de pair avec d’autres instincts, comme son égotisme ». C’est pourquoi Bernays recommande de toujours lui parler de « son » désir. Cette mise en troupeau a pour objet d’homogénéiser les comportements de façon à conquérir des marchés et par là même de maximiser la rentabilité, en s’appuyant notamment sur les médias audiovisuels de masse, dont la radio et le cinéma, puis la télévision inventée peu après, utilisés pour fonctionnaliser la dimension esthétique de l’individu.
Ce qui est remarquable, c’est que parler d’une société-troupeau de consommateurs prolétarisés n’est nullement incompatible avec le déploiement d’une culture de l’égoïsme érigé en règle de vie – bien au contraire : ces notions s’appellent et se soutiennent l’une l’autre. Cette vie dans un troupeau virtuel incessamment mené vers des sources providentielles pleines de sirènes et de naïades suppose en effet un égoïsme hypertrophié présenté comme accomplissement démocratique. « Sois toujours plus toi-même en participant toujours plus à la famille », « Avec nous, tu seras au centre du système » ou « au centre de la banque, du réseau et de tout ce que tu veux » – on pourrait aligner mille « pubs » fonctionnant sur le même registre, car les publicitaires sont spécialisés dans l’utilisation de ce truc (grossier, mais imparable) consistant à flatter, sous toutes ses formes possibles, l’égoïsme des individus.
Avec cet « égoïsme grégaire » (rappelons que « grégaire » vient du latin gregarius, de grex, gregis, « troupeau »), nous sommes sans doute devant un type d’« agrégat » assez nouveau qu’il conviendrait d’inventorier d’autant plus vite que son versant égoïste lui interdit à jamais de se découvrir lui-même en être collectif. Nous sommes avec ces formations égo-grégaires comme devant des monstres sécrétés par la démocratie. Des monstres, car ces formations sont profondément antidémocratiques : elles fonctionnent à l’omission volontaire et au procédé artificieux constamment répétés, à l’achat des consciences, au coup d’esbroufe gagneur, au profit rapide et maximal et, de surcroît, elles contaminent de plus en plus le fonctionnement démocratique réel subsistant en contribuant notamment à la « peoplelisation » du politique.
La vie en troupeau virtuel fonctionne à partir d’une sérialisation des individus exposés à de multiples possibilités de satisfaction de convoitises égoïstes, constamment excitées et relancées. Par sérialisation, j’entends une perte du sentiment d’appartenance à une (ou à la) collectivité humaine, le surgissement d’une anomie conduisant les membres d’un groupe à vivre chacun pour soi et dans l’hostilité envers les autres. Cette sérialisation contribue à faire en sorte que chaque membre du troupeau virtuel se place librement sous le faisceau des offres de satisfaction.
Pour l’y inciter, une offre à regarder suffit, qui peut en principe être déclinée ou acceptée (« en principe », car les enfants sont en fait souvent placés quasiment de force devant le téléviseur par les parents afin qu’ils se tiennent tranquilles). S’il accepte cette offre, presque forcée, à regarder, le membre du troupeau sera « pris » car il regardera en croyant qu’il regarde librement la télévision. C’est alors qu’est mobilisée une des particularités de la pulsion scopique : l’inversion du sens du regard permettant qu’à la fin ce ne soit plus tant le spectateur qui regarde la télévision, mais que ce soit, de facto, la télévision qui regarde le spectateur. Ce renversement doit bien sûr être aussi indolore que possible.
Tout part d’un contrat mensonger selon lequel le spectateur croit pouvoir regarder sans être vu. De là naît ce sentiment de toute-puissance égoïste qui atteint celui qui croit « faire ce qu’il veut » en regardant ce qu’il veut bien regarder. La preuve ultime étant qu’il peut zapper à sa guise. En réalité, ce spectateur n’est pas tout-puissant, loin s’en faut : il est regardé et même scruté sûrement plus qu’il ne regarde. N’oublions pas qu’aucune autre activité sociale n’est plus mesurée que celle qui a trait aux pratiques télévisuelles.
Le même phénomène vaut d’ailleurs pour tous ces nouveaux ensembles égo-grégaires. En effet, de même qu’avec Internet de multiples programmes-espions résidents ou à distance enregistrent le regard du l’internaute par l’intermédiaire de ses clics de souris, de façon à dresser de lui un portrait-robot qui rendra possible de le regarder sous toutes ses coutures et sous toutes ses habitudes, de multiples boîtes noires enregistrent les moindres réactions du téléspectateur. De sorte que, quand il regarde, il est aussi regardé.
La télévision, c’est un œil dardé en direction de chaque membre ou groupe de membres du troupeau. L’habituel : « Je vais me détendre un moment en regardant la télévision » est donc bien fallacieux. Car, alors, c’est l’Autre qui vous regarde, vous, mais pas seulement vous puisqu’il regarde en même temps chaque membre du troupeau. Et, bien sûr, tous ces yeux aveugles de la télévision, dardés vers les membres du troupeau virtuel, sont interconnectés. Ce qui compose un immense réseau où chacun est constamment exposé et regardé par ce qu’il regarde. Et directement conduit vers les sources où cet Autre veut qu’il aille se nourrir et se désaltérer avec ses congénères du troupeau (et l’on sait que, pour le président-directeur général de la principale chaîne française de télévision, dont l’offre fut retenue au titre du « mieux-disant culturel », ce sont préférentiellement des sources de Coca-Cola).
La télévision fonctionne comme une sorte de panoptique de Bentham à l’envers. Dans celui-ci, comme Foucault l’a montré, « [chacun] est vu, mais ne voit pas », de façon à « induire chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir (12) ». Ici, raffinement supplémentaire (c’est ça le progrès) : personne n’est vu, mais chacun est regardé par ce grand Autre aveugle qu’il regarde. Il ne s’agit plus en effet pour lui de voir chacun des membres depuis un seul point de vue central, mais de faire regarder chacun dans certaines directions très précises, celles qui promettent le bonheur par la satisfaction généralisée et automatique de besoins, évidemment dûment répertoriés et... pré-visibles.
Dany-Robert Dufour.
Dany-Robert Dufour
Philosophe, professeur en sciences de l’éducation à l’université Paris-VIII, directeur de programme au Collège international de philosophie ; auteur de Le Divin Marché. La révolution culturelle libérale, Denoël, Paris, 2007, et de On achève bien les hommes, Denoël, Paris, 2005.
(1) On doit le concept d’« industrie culturelle » à Theodor W. Adorno, dont l’analyse critique de la Kulturindustrie demeure d’une grande actualité. Cf., par exemple, Philosophie de la nouvelle musique (1962), Gallimard, Paris 1985, p. 15-17.
(2) L’expression figure dans le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur « La délinquance des mineurs » (26 juin 2002) : « La télévision a pénétré à un tel point la vie des familles et joue un tel rôle dans le quotidien des enfants qu’on peut, sans exagérer, parler de “troisième parent” pour la désigner ».
(3) En Europe, entre un et deux tiers des enfants ont désormais la télévision dans leur chambre. Cf. Sonia Livingstone et Moira Bovill, Children and Young People in a Changing Media Environment, Lawrence Erlbaum, Londres, 2001.
(4) Ray Bradbury, Fahrenheit 451, Denoël, Paris, 1966.
(5) Le fait que les promoteurs de la première émission de ce type l’ait appelée « Big Brother » (aux Pays-Bas, en 2000) indique combien la virulente critique politique présente dans le roman de George Orwell, 1984, est désormais déniée.
(6) Cf. Laurent Fonnet, La Programmation d’une chaîne de télévision, Dixit - DESS, communication audiovisuelle université Paris-I, Paris, 2003.
(7) Collectif, Les Dirigeants face au changement, Editions du huitième jour, Paris, 2004.
(8) Bernard Stiegler, Aimer, s’aimer, nous aimer. Du 11 septembre au 21 avril, Galilée, Paris, 2003, p. 30.
(9) Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique. Œuvres II, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Paris, 1992.
(10) Cf. Bernard Stiegler, Mécréance et discrédit 1, 2 et 3, Galilée, Paris, 2004-2006.
(11) Bernays, neveu de Freud, faisait de son oncle le destinataire de ses livres. Il est resté en contact régulier avec lui pour la traduction des travaux de ce dernier et leur publication aux Etats-Unis.
(12) Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975, p. 234. Une construction pénitentiaire panoptique est celle où le gardien se tient dans une guérite maintenue dans l’obscurité, édifiée au point central d’une vaste élévation en cercle où sont distribuées sur plusieurs étages des cellules à barreaux, violemment éclairées. Ainsi, un grand nombre de prisonniers peuvent être vus par un seul gardien, sans qu’aucun ne sache si on le regarde.
Édition imprimée — janvier 2008 — Pages 20 et 21
06:48 | Lien permanent | Commentaires (0)
28/01/2008
La vie philosohique
Emmanuel Picavet
Un regard en arrière sur le contexte de mes travaux publiés.
Si l'on oublie mes textes dans des publications étudiantes, mes travaux publiés les plus anciens remontent à 1993. La plupart des textes publiés depuis cette époque concernent la théorie politique, certains articles relèvent des sciences économiques, d'autres encore concernent des questions de méthode et d'épistémologie. Ce qui suit est un regard en arrière très rapide sur les circonstances de la rédaction de ces textes. Mon travail a été très souvent le résultat de rencontres, de discussions, de sollicitations amicales ; je voulais que cette invitation à commenter mon parcours soit surtout l'occasion d'en porter témoignage.
Courants d'idées au temps de mes études
On peut dire que j'appartiens à une génération marquée par l'espoir né de l'effondrement des dictatures des pays de l'Est et par l'horizon d'un règne effectif des droits de l'homme. C'était l'idéal de ma génération et c'est encore le mien. Par contraste, je me sentais plus éloigné des principes du néolibéralisme d'inspiration hayékienne - l'autre pilier des idées politiques au temps de mes études. Hayek m'intéressait, mais Marx également.
Personnellement, il m'a toujours semblé important de maintenir l'attachement à des idéaux de droits personnels, de satisfaction des besoins par une organisation efficace, de développement individuel, de participation de tous à la marche des idées, de la culture et de la connaissance ; je pense avoir choisi des voies de recherche qui privilégient ces éléments - probablement d'une manière indirecte et épurée. Mes sympathies personnelles et aussi ma curiosité intellectuelle penchent de ce côté, plutôt que du côté des idées élitistes, corporatistes, culturalistes, populistes, néo-conservatrices ou ultra-libérales - présentes les unes et les autres à droite comme à gauche - que j'ai appris à connaître sans grand plaisir et dont je suis avec une certaine inquiétude les effets sur la société française.
Peu engagé en politique, au temps de mes études, j'étais cependant spécialement intéressé par les questions politiques et économiques. D'une manière générale, j'avais en horreur la violence politique, qui était pour moi un sujet de réflexion central. Vivement impressionné par la lecture du Zéro et l'infini d'Arthur Koestler, je m'intéressais aussi beaucoup à la guerre, à la paix - suivant par exemple avec une passion toute particulière les étapes des processus de désarmement ou de contrôle des armements entre les Etats-Unis et l'Union soviétique. Certaines de mes curiosités en théorie politique viennent de là : l'observation des dernières phases de la guerre froide et de la dernière vague du « pacifisme » européen. De très bonne heure, les problèmes de l'action collective, les difficultés de la concertation entre pouvoirs et l'aspect stratégique des décisions retinrent mon attention. Les questions géostratégiques m'intéressaient, et je devais avoir ensuite l'occasion, en tant qu'appelé du contingent, de travailler sur des questions d'économie de la défense. Ce fut la source de mes travaux conjoints avec Jean-François Jacques, qui nous conduisirent à utiliser des tests de causalité conçus pour les séries chronologiques, et à étudier ensemble les problèmes épistémologiques de la détection de la causalité (dans le cadre de l'équipe de macro-économie de l'Université Paris-I).
La formation de ma réflexion politique a aussi été marquée, je pense, par les étapes de l'interaction israélo-palestinienne, par les échos de la résistance aux régimes autoritaires d'Amérique Latine, par le drame du Cambodge, par de très nombreux autres problèmes politiques. Très tôt, la politique m'a semblé être un théâtre d'oppression et de violence autant que d'aspirations à la paix et à la prospérité - et l'étude de l'histoire renforçait en moi ce sentiment, comme devaient le faire aussi, plus tard, mes conversations avec Bertrand Saint-Sernin.
Lorsque j'ai abordé l'étude professionnelle de la chose politique, je n'ai jamais perdu de vue cette certitude qu'il s'agit d'une chose utile, mais fondamentalement dangereuse. Au fond, je n'ai jamais eu envie d'y projeter des rêves ou d'en traiter sur le mode utopique. Je l'étudie comme j'étudierais, j'imagine, les procédures de sécurité dans une centrale nucléaire. Aussi n'étais-je pas spécialement attiré par l'espèce de nostalgie des utopies des années 1960 qui était encore perceptible au quartier latin au temps de mes études. C'est seulement plus tard que certains aspects de ces utopies ont rejoint mes centres d'intérêt, par des voies indirectes. Dans le domaine des sciences humaines, le centre de la vie intellectuelle à Paris au temps de mes études (la seconde moitié des années 1980 et la première moitié des années 1990) était naturellement la Sorbonne, lieu de confluence de plusieurs grandes universités. A Paris-1, où je faisais mes études, l'atmosphère était particulièrement studieuse et ne laissait guère de place à l'activisme politique, tandis que la réflexion politique et les débats culturels, moraux, politiques et religieux avaient toute leur place dans la vie estudiantine en dehors du cursus universitaire.
Le département de philosophie était encore auréolé du prestige de la Résistance, associée aux noms de certains maîtres. L'histoire de la philosophie y était cultivée avec rigueur, mais on aurait tort de réduire l'enseignement de la philosophie à la Sorbonne, vers cette époque, à cette seule dimension. Les tendances les plus diverses étaient présentes, à l'exception - assez curieusement - de celles qui, à l'étranger, sont aujourd'hui considérées comme typiques de la « philosophie continentale ».
L'enseignement de François Dagognet et celui de Louis Sallas-Molins, comme plus tard la présence de Jean-Pierre Séris (qui accompagna mes premiers pas dans l'enseignement conjointement avec François Rivenc, Michel Fichant et Etienne Balibar) et d'Anne Fagot-Largeault, devaient imprimer un tournant « appliqué » aux travaux philosophiques, les ouvrant très largement sur les métiers, les pratiques et la confrontation aux réalités historiques ou sociales. Rétrospectivement, cela me semble avoir eu un effet déterminant sur le progrès ultérieur de mes travaux.
Depuis ce temps, j'ai concentré mon attention surtout sur les problèmes (nés des efforts de compréhension) et sur les aspirations (révélées dans les pratiques ou les conflits). Un peu moins sur les doctrines, bien qu'elles m'intéressent aussi. Après une maîtrise dans le champ de l'histoire de la philosophie, j'avais aussi pris le parti de séparer assez rigoureusement les entreprises proprement philosophiques et les travaux historiques ou rétrospectifs (sans renoncer tout à fait à écrire sur les auteurs, d'ailleurs). Plus tard, dans la continuité des leçons reçues de Paulette Carrive notamment, je devais m'intéresser à nouveau aux rapports entre théorie et histoire des doctrines, surtout dans le champ de la pensée politique. Yves-Charles Zarka et Franck Lessay, Tom Sorell et Luc Foisneau ont contribué à jeter des ponts, que j'apprécie beaucoup, entre les entreprises théoriques et le regard rétrospectif sur l'histoire des doctrines. Je me suis associé plusieurs fois, modestement, à leurs efforts ; ce fut notamment le cas dans le programme de recherche franco-britannique sur Hobbes et la théorie politique du XXème siècle. Cela se voit dans mes textes sur Hobbes, Kant et Pareto.
Ce que je voulais absolument éviter, c'était de concevoir mon travail comme articulé à des époques ou à des sphères culturelles particulières. Je voulais éviter aussi le culte irrationnel du « grand auteur » et toute manière de faire de la philosophie qui consisterait en un « retour à… » ou une « reprise de… ». Je trouvais incompréhensible la fascination comme le rejet dont l'école américaine en philosophie était tour à tour l'objet.
J'ai conservé, je crois, cet état d'esprit : la philosophie est pour moi une activité théorique ou argumentative, souvent collective, à prétention universelle, très faiblement liée aux idées de personnages particuliers. Je constate sans déplaisir que les étudiants, aujourd'hui, ne semblent plus du tout embarrassés par le maniement simultané de thèses, de méthodes et d'arguments issus de plusieurs courants ou traditions. J'encourage autant que je le peux la défiance à l'endroit du « grand auteur », du « courant dominant » ou des « traditions ».
En sciences économiques, à Paris-1, certaines évolutions étaient sensibles au temps de mes études parallèles dans ce domaine. Le reflux des aspirations collectivistes ou planistes était perceptible à vu d'œil, au moment même où s'écroulait le mur de Berlin (au beau milieu d'un cours sur les méthodes de la planification socialiste !). Les étudiants semblaient séduits par les thèses néolibérales, admiraient le courant des nouveaux classiques et désertaient les cours d'économie publique (si bien que la licence d'économie publique, qui avait permis à plusieurs d'entre nous de se familiariser avec le droit, cessa bientôt d'exister).
Dans le contexte de l'Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales, où je préparais ensuite un diplôme d'études approfondies en économie, la période de transition dans les pays de l'Est était aussi au centre des préoccupations et suggérait de nombreuses pistes de recherche dans le milieu des chercheurs du DELTA, proche des centres de décision internationaux. Comme dans le pôle rival de Paris-1, les étudiants avancés étaient formés dans le voisinage direct de la recherche. Au contact de Richard Portes, qui faisait des recherches très perspicaces sur la transition à l'Est et à propos des institutions financières, je cherchais la confirmation d'une orientation méthodologique plutôt inductiviste et d'un institutionnalisme bien tempéré. C'était aussi le lieu de discussions stimulantes, tantôt théoriques, tantôt politiques, notamment avec Francisco Huanacune-Rosas (qui devait fonder plus tard, au Pérou, le magazine Generaccion).
Les intérêts, les pouvoirs et la philosophie
Aujourd'hui, l'horizon des droits de l'homme semble activement contesté, principalement parce qu'il est identifié à ce qui est perçu comme l'impérialisme américain. Egalement, parce que les idéaux de respect dignité humaine sont perçus comme des menaces pour les carrières et pour la rentabilité financière dans certains secteurs (étroitement circonscrits mais influents) de la recherche biomédicale et des biotechnologies. Enfin, les droits de l'homme gênent les relations entre Etats, notamment celles qui impliquent la Chine populaire. Ils sont devenus subversifs.
Mon parcours en philosophie m'a permis de constater que le discours philosophique, comme les autres discours d'experts, constitue un enjeu parce qu'il peut être utile à certains intérêts et en contrarier d'autres. Au fil des années, il m'est apparu absolument essentiel de chercher à comprendre cela avec rigueur, pour mettre à distance du travail proprement philosophique (même lorsqu'il concerne la société ou la politique) les enjeux pragmatiques propres à certains segments de la population, en particulier dans les milieux dirigeants. Pierre Bourdieu, lors d'une visite dans notre université, nous avait dit qu'il jugeait utile aux philosophes de chercher à « objectiver » les conditions de la production de leur discours. J'interprète cela comme voulant dire à peu près : n'oubliez pas que vous pouvez être utilisés, que vous l'êtes certainement déjà ; sachez à quoi vous devez les compliments qu'on vous envoie… Il m'est arrivé d'avoir des échanges (parfois même un travail commun) avec des responsables politiques ou avec d'anciens responsables. Ainsi, Anne Fagot-Largeault m'avait fait participer aux Etats généraux de la santé. J'accomplis un travail commun avec Nicole Questiaux lorsque je fus invité à participer aux travaux de la commission « Progrès technique et modèle de société » au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences biomédicales. J'eus aussi l'occasion de participer à une rencontre organisée par Jack Lang autour de l'enseignement de l'économie et des rapports de cette discipline avec les disciplines voisines. Je dois participer en janvier 2006 au séminaire du CERC placé sous la présidence de Jacques Delors.
J'apprécie beaucoup ces rencontres et je trouve heureux que les responsables français consultent régulièrement les milieux universitaires, mais je ne pense pas que la philosophie politique doive s'adresser prioritairement aux responsables politiques (à la manière des anciens « miroirs des princes »). Je n'éprouve aucune fascination personnelle pour le pouvoir, qui est pour moi un objet d'étude. Ce qui reste fascinant pour moi, c'est l'architecture des pouvoirs, non pas la détention du pouvoir par tel ou tel. Je suis intéressé par la contribution de la philosophie à la clarification des choix possibles, à la pleine compréhension des revendications, des conflits de valeurs et des désaccords qui existent dans la société. De plus, je tiens beaucoup à ce que mes contributions ne portent la marque d'aucune orientation idéologique identifiable dans les termes du débat public familier. Cela ne me demande pas d'effort particulier : la recherche d'une meilleure compréhension des choses est par nature distincte de l'engagement militant, même lorsque l'objet d'enquête est sociétal ou politique. J'utilise volontiers mes propres convictions comme révélateurs de conflits de valeurs intéressants et persistants, et comme source d'idées politiques, mais je ne crois pas écrire, en règle générale, pour promouvoir les causes que je crois justes. Au reste, je crois utiliser à peu près de la même manière, à titre de révélateurs de problèmes et d'aspirations, les convictions que je trouve en moi et celles qui me sont étrangères. Je m'intéresse aux convictions ; je ne cherche pas à les neutraliser.
Si les choses sont claires d'un point de vue personnel, elles sont indéniablement plus compliquées dans le travail collectif. Il existe plusieurs manières légitimes d'articuler recherche, analyse et convictions dans le champ des études politiques. Plusieurs manières personnelles de placer le curseur indiquant où finit la recherche, où commence l'engagement militant. J'eus plusieurs fois l'occasion de m'en apercevoir dans les débats au sein et autour de la revue Cités et dans les controverses passionnées qui agitent de loin en loin le microcosme des enseignants de philosophie (à propos de Martin Heidegger et de Carl Schmitt, par exemple, ou encore à propos de l'Islam et de la laïcité à la française). N'étant pas personnellement un fervent de la neutralité, je pense qu'il faut vivre avec ces débats, au lieu d'essayer d'y mettre fin. L'orientation partisane des textes que je lis ne me met pas mal à l'aise en général et ne m'empêche pas de trouver intérêt à ce que je lis, même si je tiens, en ce qui concerne mes propres travaux, à distinguer rigoureusement doctrine et théorie. La neutralité politique ne me paraît pas un idéal mobilisateur : au lecteur de trier ce qui l'intéresse et ce qui ne l'intéresse pas dans ce qu'il lit. On s'instruit d'ailleurs toujours, me semble-t-il, en considérant la manière dont les auteurs défendent leurs idées personnelles.
Le séminaire interuniversitaire de philosophie des sciences
Inscrit en doctorat de philosophie à l'Université de Paris-Nanterre (avant de terminer ma thèse à l'Université Paris-IV), sous la direction de Bertrand Saint-Sernin, je devenais par là même un participant régulier au séminaire de philosophie des sciences, que mon directeur de thèse animait avec Anne Fagot-Largeault. J'avais lu un peu plus tôt, avec passion, les Mathématiques de la décision de Bertrand Saint-Sernin Daniel Andler devant se joignit ultérieurement à cette équipe, dont les travaux sont assez fidèlement reflétés dans les volumes de Philosophie des sciences récemment parus. Je retrouvais là mon ami Nicolas Aumonier et je fis la connaissance de Paul-Antoine Miquel, d'Alain Leplège et d'autres jeunes philosophes avec qui je devais continuer ensuite à collaborer (je retrouvai certains membres du séminaire plus tard au sein de la Société française de philosophie).
L'atmosphère était ouverte et internationale ; nous avions le sentiment que si nous avions des choses à présenter, nous pouvions les présenter, et que toute cette machinerie interuniversitaire était destinée à nous permettre de progresser rapidement et d'aller aussi loin que possible dans nos travaux. La collaboration entre enseignants et entre établissements (les universités Panthéon-Sorbonne, Paris-Sorbonne, Paris-Nanterre et l'Ecole normale supérieure) autour de la préparation de diplômes universitaires préfigurait, comme la liaison visible entre enseignement et recherche, le système européen, à dominante universitaire, finalement rejoint par la France.
L'organisation très méthodique des séances, les synthèses minutieuses d'acquis et de problèmes, ainsi que l'ouverture très large aux sciences de la nature et aux sciences sociales, faisaient notre admiration. C'était aussi le lieu d'une confrontation systématique avec les enjeux sociétaux des sciences et des techniques, dans le prolongement des activités d'Anne Fagot-Largeault en éthique médicale et de celles de Bertrand Saint-Sernin dans le domaine des politiques de la recherche. Ce fut enfin un lieu de tensions largement non dites, mais intenses, autour d'enjeux éthiques. J'observai qu'elles ne compromettaient pas les rapports d'amitié ou de reconnaissance de disciple à maître (ce qui me suggérait, dès cette époque, quelques idées anti-consensualistes en matière politique).
Progressivement, la question des rapports entre l'anthropologie philosophique et les approches naturalistes (volontiers réductionnistes) avait pris de l'importance dans les travaux de ce séminaire. A l'occasion de réunions avec Nicolas Aumonier et Antoine Danchin dans un laboratoire de l'Institut Pasteur, je m'étais aperçu de la réalité des transferts de méthodes entre sciences de la nature et sciences humaines, surtout autour de la théorie de l'information et de la théorie des jeux. J'en avais déjà eu un aperçu en suivant l'enseignement d'André Orléan aux Hautes-études. Le tabou entourant la sociobiologie et ses errements de jeunesse était tombé depuis longtemps.
Mon intérêt pour le travail d'Allan Gibbard, la lecture de certains travaux de Gordon Tullock et de nombreux échanges avec des collègues de plusieurs disciplines devaient aussi éveiller en moi le sentiment d'une collaboration possible sans réductionnisme entre sciences de la vie et sciences de la nature. Si l'on admet que le rapport critique à des normes fait partie de la réalité anthropologique, il n'y a aucun inconvénient à mettre en communication, d'un domaine à l'autre, les concepts d'information, de coordination, de coopération et de répartition des rôles. Mes références occasionnelles à des recherches qui se situent à la croisée des sciences sociales et de la biologie proviennent plutôt de cet intérêt pour des méthodes partagées que d'une quelconque idéologie « naturaliste » - ou, pour employer le terme classique, matérialiste. Il me semble qu'il y a un aspect libérateur dans la prise de conscience des servitudes de l'organisation sociale telles qu'elles peuvent exister à la fois, et sous des formes voisines, dans les sociétés animales et dans les sociétés humaines. Enfin, certaines performances remarquables de certaines sociétés animales - en particulier, en ce qui concerne la limitation des conflits - peuvent être un objet de méditation. Toutefois, mes travaux personnels laissent peu de place à l'importation directe de méthodes issues de la biologie, parce qu'ils se concentrent sur des interactions politiques dans lesquelles la part de la délibération, de la discussion, du rapport réflexif aux normes est prédominante.
Je n'ai jamais eu d'attirance pour le projet - qui me paraît se profiler logiquement à l'horizon des approches naturalistes les plus cohérentes - consistant à chercher à remplacer une partie des études philosophiques (comprises dans le périmètre actuel de la philosophie) par des études relevant des sciences de la nature. Plus généralement, je n'ai jamais partagé ces rêves de dissolution des problèmes philosophiques qui, curieusement, sont surtout l'apanage des philosophes eux-mêmes (fascinés tour à tour par la biologie, les mathématiques ou la psychologie). S'il y a des problèmes à étudier en philosophie et s'ils peuvent servir de fil conducteur à une certaine forme d'investigation de la réalité, il ne me semble pas approprié de déserter ce terrain, qui est celui de certaines questions, de certaines recherches d'explications. J'ai sur ce point des vues très classiques, qui peuvent passer aujourd'hui pour conservatrices. Outre une certaine habitude de l'interdisciplinarité, le séminaire de philosophie des sciences me donna l'exemple d'une liaison forte entre enseignement et recherche. Mes travaux ont toujours été liés à l'enseignement - l'enseignement reçu, puis l'enseignement dispensé et aussi le dialogue avec les étudiants. Ainsi, mes Approches du concret (Ellipses, 1995, préface par J.-P. Séris) provenaient dans une large mesure de mes cours d'épistémologie en Deug lorsque j'étais jeune moniteur à l'université Paris-1 ; on y trouvait aussi la trace de questions d'épistémologie générale avec lesquelles je m'étais familiarisé dans mes premiers travaux sous la direction d'Yves Michaud et aussi dans le séminaire « Méthodologie de la science empirique » qu'animaient avec passion Philippe Mongin et Alain Boyer à l'Ecole normale supérieure, dans un esprit nettement poppérien.
Plus tard, les étudiants ont largement partagé ma curiosité pour le positivisme juridique et pour la théorie morale et politique fondamentale. Ils ont du faire face à mes prétentions systématiques en théorie politique, ainsi qu'à mes hésitations théoriques concernant la conceptualisation des droits et des pouvoirs. Ils ont partagé ou contesté mes interprétations de nombreux auteurs classiques et contemporains (notamment Hobbes et Kant chez les classiques, Kelsen, Hart et Rawls du côté des contemporains). Tout cela se reflète assez fidèlement, je crois, dans mes publications.
L'individualisme méthodologique et la théorie du choix rationnel
Ma thèse de doctorat (publiée ensuite aux PUF dans une version remaniée et plus brève - Choix Rationnel et vie publique, 1996) était très largement une enquête sur la norme de rationalité, saisie en particulier dans la transition de l'échelon individuel à l'échelon collectif. Reprendre la question de la rationalité pratique et ses prolongements politiques à la lumière de la théorie de la décision pouvait sembler ambitieux. A tout le moins, cela illustrait une posture franchement théorique en philosophie, aujourd'hui banale, mais qui avait tendance à passer au second plan dans les travaux de l'époque au profit de plusieurs autres tendances : l'enquête de type historique ou « archéologique », l'insertion directe dans les « débats de société » ou le « débat éthique », ou encore la « philosophie analytique » qui devait s'infléchir progressivement (dans le contexte français tout au moins) en « philosophie exacte », tournée vers les systèmes formels considérés pour eux-mêmes à la faveur d'une sorte de fusion entre philosophie et mathématiques. Pour ma part, je voulais reprendre l'analyse proprement philosophique de problèmes intéressant la pratique et l'organisation collective, au moyen de méthodes suffisamment complexes, et en réfléchissant sur ces méthodes.
La fin de ma période de doctorat, à l'Université Paris-IV, m'avait naturellement amené à fréquenter le milieu de l'individualisme méthodologique français, qui gravitait autour de Jean Baechler, François Chazel et Raymond Boudon. Je fis la connaissance de ce dernier lors de ma soutenance de thèse (qu'il présidait). Raymond Boudon était déjà très engagé dans la critique de la méthodologie du choix rationnel, dont il trouvait dans ma thèse une sorte de célébration. Je pense que mon intérêt spécifique pour des formes argumentées et calculées d'interaction politique et politico-économique me rend moins sensible que les sociologues (fussent-ils individualistes) aux questions d'opinion publique, de normes socio-culturelles et de conformité à des « valeurs » diffuses dans la société. Mais je voulus prendre au sérieux les réticences de Raymond Boudon, qui privilégie lui aussi jusqu'à un certain point une perspective critique et réflexive des agents sociaux eux-mêmes sur les normes sociales ou éthiques.
Je ne voulais pas prendre la tangente en immunisant d'emblée les approches en termes de choix rationnel contre toute critique, comme on le fait lorsqu'on veut les réduire à une approche formelle ou mathématique. Je devais donc revenir à une étude des raisons de l'action et des raisons dans le rapport critique aux normes, ce qui fut le thème dominant d'une large part de ma production dans les années qui suivirent. Ce type d'investigation devait croiser notamment les thèmes de recherche développés à l'Université de Franche-Comté, dans le laboratoire de recherches philosophiques sur les logiques de l'agir, autour de la rationalité, de la décision collective et de l'expertise.
Cette attention renouvelée aux raisons des acteurs de la décision dans des contextes sociaux prolongeait mes lectures, mais aussi de longues discussions avec Renaud Fillieule et Pierre Demeulenaere, qui étaient également doctorants à Paris-IV, au sein d'une nouvelle Ecole doctorale qui favorisait une collaboration effective entre philosophie et sciences sociales (concrétisée notamment par une impressionnante série de colloques associant les deux branches disciplinaires). Nous avions les uns et les autres le souci de ne pas nous laisser impressionner par les effets d'annonce des programmes théoriques ou par l'appareil de modélisation mobilisé dans certains secteurs de la recherche. J'étais toutefois, probablement, le plus impressionnable des trois, à cause de ma quête de structures décisionnelles invariantes, qui me rendait réceptif, en quelque sorte par principe, aux tentatives théoriques les plus abstraites.
Mes co-équipiers sociologues (avec qui je devais éditer en 1998, conjointement avec B. Saint-Sernin, le recueil Les Modèles de l'action aux PUF) avaient un point de vue plus critique que moi sur ce qu'ils percevaient comme la dérive formaliste de la méthodologie du choix rationnel et sur l'évolution des sciences économiques et d'une partie des sciences politiques et de la philosophie politique. Mais c'est seulement en lisant attentivement la thèse de doctorat de P. Demeulenaere (publiée ensuite aux PUF - Homo oeconomicus. Enquête sur la constitution d'un paradigme, 1996) que je pris véritablement la mesure des efforts à développer pour rapprocher les modèles généraux de la rationalité des raisons accessibles aux agents dans des contextes particuliers et évolutifs d'imbrication des intérêts, de conflits et de rapprochements entre les valeurs, d'inégalités de pouvoir.
La prise de connaissance des progrès importants obtenus dans les sciences sociales et l'analyse politique à partir de perspectives institutionnalistes, notamment dans les écoles allemandes et d'Europe du Nord, devait par la suite me rendre sensible l'intérêt d'un enrichissement du paradigme du choix rationnel par une attention fine au fonctionnement des interactions inscrites dans des contextes institutionnels. Mes échanges approfondis avec des chercheuses telles que Bénédicte Reynaud, Maria Bonnafous-Boucher et Laurence Brunet, ainsi que ma collaboration régulière avec Sandra Laugier, me suggéraient aussi que c'était dans le rapport critique et réflexif aux normes que se situaient les éléments critiques à rechercher pour fournir des explications satisfaisantes des rapports d'autorité, des conflits ou des modalités de coopération.
J'avais d'ailleurs depuis longtemps acquis la conviction que l'échelon des normes publiques ne devait pas être abordé simplement comme le lieu de concrétisation de valeurs morales et politiques ; il a son épaisseur propre, sa logique et même une certaine complexité stratégique à cause de l'élément calculé dans le rapport individuel et institutionnel aux règles. Dire que l'on trouve que quelque chose est juste, cela est très éloignéde tout jugement sur les manières de faire ou les manières de s'organiser, même si les deux problématiques doivent être mises en relation. Je m'en suis souvent renducompte en participant à des débats, ou même à de simples conversations, sur des sujets éthiques.
Economie normative et éthique sociale
Pendant plusieurs années, mon enseignement à Paris-1 s'est adossé aux discussions et aux thèmes de recherche qui traversaient le séminaire d'éthique sociale et d'économie normative qui, sous divers noms et dans plusieurs configurations successives, était la suite logique, pour plusieurs de ses anciens étudiants, du séminaire de Serge-Christophe Kolm à l'Ecole des hautes études en sciences sociales. Lieu de passage des plus grands noms de l'éthique sociale, de l'économie normative et de la théorie des choix collectifs, le séminaire accompagna la spécialisation dans ce domaine du département d'économie de l'Université de Cergy-Pontoise, où Philippe Mongin et moi avions eu l'initiative d'un éphémère Centre « économie et philosophie » qui, d'une certaine manière, s'inscrivait dans le courant d'idées qui devait mener plus tard en France à l'organisation du secteur de recherche et d'enseignement aujourd'hui connu sous le label de la « philosophie économique ». Serge-Christophe Kolm était évidemment la figure centrale de ce groupe, au sein duquel je côtoyais plusieurs économistes de grand talent.
Le séminaire, qui se tint successivement à l'Institut international de Paris-La Défense, à l'université Paris-Dauphine et à l'Université de Cergy-Pontoise, constitua pendant plusieurs années une sorte de contrepartie parisienne à l'important pôle de recherche de l'Université de Caen sur les choix collectifs (avec lequel des échanges réguliers existaient). Parmi les philosophes, Sandra Laugier, Bertrand Saint-Sernin et Jean-François Kervégan firent partie des orateurs.
A la différence de certains membres du groupe, je n'étais pas venu à ces questions à partir de préoccupations égalitaristes. De plus, il me semblait assez difficile de séparer les intuitions éthiques de l'étude des mécanismes de concrétisation institutionnelle - ce qui est pourtant la manière de faire habituelle en théorie des choix collectifs. Je m'intéresse à ce domaine d'étude surtout à cause de ce qu'il révèle sur la manière de faire coexister différentes conceptions dans le cadre de procédures s'imposant à un groupe ou une société. Tout n'est pas possible ; il y a des raisons tantôt logiques, tantôt liées aux contraintes de la vie en société, qui limitent le domaine de ce qu'il est possible de vouloir et de choisir démocratiquement. C'est cela qui m'intéressait et qui m'intéresse encore, bien davantage que le vieux rêve de l'articulation par une élite pensante de règles « éthiques » susceptibles de régir l'ensemble de la vie sociale et « concrétisables » ensuite par des mécanismes sociaux.
C'est ce qui explique aussi mon attention spécifique, dans plusieurs articles (tour à tour historiques et théoriques) au « principe de Pareto » de l'éthique sociale et de l'économie normative - un principe qui ramène justement l'évaluation collective au constat de l'accord des jugements, lorsqu'il intervient. Dès cette époque, j'inclinais fortement en faveur d'une approche pluraliste de l'évaluation sociale - une approche privilégiant l'étude des modalités de convergence éventuelle (ou de recoupement partiel) des points de vue, plutôt que l'identification du bon modèle de la société. J'appelais cela une approche « multilatérale » ; je n'hésite plus aujourd'hui à parler d'un relativisme de méthode, permettant de renforcer (pour les rendre plus crédibles, plus conformes à la nature des choses) les hypothèses pluralistes de la philosophie politique contemporaine.
Une collaboration se noua avec Nicolas Gravel, qui déboucha sur un article commun dans L'Année sociologique, visant à doter de fondements conséquentialistes certaines thèses répandues sur la spécificité de la rationalité axiologique, qui avaient déjà donné lieu à des tentatives de systématisation, en particulier dans les travaux de Raymond Boudon. Je pense que cet article, peut-être par notre faute, n'a pas toujours été parfaitement compris. En appliquant aux exemples privilégiés de conflit entre une « rationalité instrumentale » et une « rationalité axiologique » la logique d'universalisation des raisons dans des contextes de coopération problématique (une logique préalablement éprouvée dans des travaux de Bordignon, Bilodeau et N.Gravel lui-même), nous ne voulions pas sous-estimer en quoi que ce soit l'importance du problème du passager clandestin. Nous ne voulions pas dire sur le mode prédictif que des agents confrontés à des problèmes de sous-optimalité de leurs comportements « rationnels » conjoints allaient choisir spontanément un comportement « moral » conforme à l'intérêt commun.
Ce que nous cherchions à caractériser - et nous avions le sentiment d'y être parvenus dans des cas limités - c'était la manière dont des agents rationnels pouvaient utiliser les propriétés de symétrie et leur propre connaissance de la situation d'interaction pour identifier les comportements qu'ils pourraient vraiment vouloir, sous l'hypothèse d'une identité des raisons de l'action chez les uns et les autres (au point de vue près). Mais identifier ce qui est rationnel en un certain sens est une chose, s'engager à agir de cette manière en est une autre. Il nous semblait important de caractériser en termes suffisamment généraux ce type spécial de rationalité, qui systématise ce qui est à l'œuvre dans des raisonnements courants qui jouent en effet un rôle dans l'action (par exemple : « si chacun faisait… », « si personne ne faisait… », « se croit-il différent des autres, pour s'autoriser à agir ainsi ?… »). Nous cherchions dans cette direction quelque chose d'utile pour l'instruction civique.
Mes investigations parallèles avec Nicolas Gravel dans le champ de la théorie des droits - qui utilisaient les développements de la théorie des formes de jeu, développée notamment par Bezalel Peleg et par mon collègue mathématicien de Paris-1, Joseph Abdou - demeurèrent inachevées et nous eûmes le sentiment de ne pas parvenir - pour le moment au moins - à résorber l'écart subsistant entre les méthodes des économistes et les efforts argumentatifs de la philosophie politique à ce sujet. Je poursuivais de mon côté des recherches sur la logique des droits et des pouvoirs, notamment à partir du fameux « paradoxe libéral » de Sen, et en liaison avec une reprise (motivée par les besoins de mon enseignement) des analyses classiques d'Hohfeld et de son école.
Avec Nicolas Gravel, nous avions d'abord essayé sans succès de traduire dans les termes de la théorie des choix collectifs et dans la théorie des formes de jeu ma perspective initiale - celle d'une justification rationnelle axiologiquement neutre des droits individuels à partir de conditions de compatibilité et d'absence de déploiement arbitraire de la contrainte (telle que je l'avais exposée dans mes articles des années 1995-1997). J'avais cherché dans cette direction une voie d'argumentation plus convaincante que l'appel dogmatique à une sphère privée des individus. Mais au cours de cette collaboration, nous découvrîmes que, dans les termes de la théorie formelle de la décision, il y avait en fait une très grande symétrie entre des choses que l'argumentation politique distingue vigoureusement : l'action et l'empêchement de l'action d'autrui ; la jouissance de garanties quant au résultat de nos propres actions et la possession d'assurances concernant ce qui pourrait résulter de l'action des autres. Dès lors, il m'était difficile de prétendre inscrire dans une purement formelle ou fonctionnelle le type d'argument que j'avais d'abord avancé, qui reposait réellement sur une certaine catégorisation traditionnelle de l'action imputable à un agent, et susceptible de faire face à des empêchements causés par autrui.
Ces difficultés m'amenèrent par la suite à étudier de plus près la manière dont se construit, à la faveur de controverses et de conflits, la délimitation concrète des aspects de la vie sociale qui sont considérés à la fois comme le résultat d'actes imputables aux agents (et susceptibles de rencontrer des obstacles suscités par autrui) et comme l'objet possible d'assurances données par l'organisation politique. Mes travaux sur ces questions ne sont pas achevés et me conduiront sans doute à une nouvelle formulation de mes propositions initiales, qui avaient suscité tour à tour l'enthousiasme et le scepticisme.
Contrairement à ce que l'on semble parfois avoir cru, ces propositions n'étaient d'ailleurs pas destinées à amener la théorie des droits de l'homme avec l'étude technique de l'évitement des conflits au moyen de normes pacificatrices. J'avais pu donner cette impression, je pense, parce que je partais du constat que les normes règlent des conflits en séparant le domaine des intentions qui peuvent être suivies d'effet et celui des intentions qui doivent être frustrées. Mais c'était pour moi une manière de partir d'un constat : c'est ce que font les normes. Je ne prétendais pas qu'il y eût là une fonction ou une destination des normes. J'étudiais cette opération et j'observais ce que l'on pouvait tirer de certaines conditions a priori sur la manière d'encadrer le système des normes par des principes d'arrière-plan (typiquement, des principes moraux ou politiques). Je retrouvai par mes propres moyens ce qui m'avait au demeurant semblé important de longue date : le principe universel du droit de Kant, et la logique kantienne de la dissymétrie entre le fait de consacrer une faculté d'action et le fait de réprimer un empêchement à l'action. Mais le fait troublant demeure la difficulté de donner corps aux arguments formulés en termes d'intentions ou de maximes d'action dans le contexte des analyses formelles actuelles des droits et des pouvoirs.
Mes travaux avec Alain Leplège - philosophe et médecin - sur l'efficacité et la qualité de vie reflétaient aussi le souci de l'usage des méthodes d'analyse décisionnelles et normatives pour aborder des questions d'éthique sociale. J'ai retrouvé plus tard certains de mes co-équipiers du séminaire d'éthique sociale dans le cadre du programme de philosophie économique de l'Université d'Aix-Marseille et au bureau de la Revue de philosophie économique. Le comité de rédaction de Theory and Decision m'a également donné l'occasion de collaborer avec les économistes, de même que le Cercle d'épistémologie économique de Paris-1 et nos rencontres entre philosophes et économistes lors de la conception des nouveaux « masters » s'inscrivant dans la rénovation européenne de l'enseignement supérieur.
Règles, normes, organisation et rationalité
Au cours de mes travaux à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques (IHPST - Université Paris-1 et Cnrs, plus tard également rattaché à l'Ecole normale supérieure) sur les règles et les organisations avec Sandra Laugier et Otto Pfersmann en particulier (et la participation régulière de nombreux collègues des universités françaises ou étrangères et d'autres institutions), le travail prit assez vite la forme d'un effort organisé d'une recherche « lourde » de type cumulatif, internationale, orientée vers les réalisations collectives. Antérieurement, l'intérêt de plusieurs membres de l'équipe pour la théorie de la décision (qui avait une histoire en ces lieux) et le séminaire « Le mental et le social » coordonné par Christiane Chauviré et Sandra Laugier avaient donné une impulsion à la philosophie des sciences sociales dans ce contexte. Etant devenu enseignant-chercheur en philosophie politique, je tenais par ailleurs à ne pas me désintéresser d'une réflexion critique sur les méthodes d'analyse. Sous l'influence d'auteurs tels que James Buchanan, James Coleman et Raymond Boudon, je ne voyais pas de raison de séparer par principe (i.e. abstraction faite des besoins propres à différents programmes de recherche) les méthodes des sciences sociales et celles de la théorie politique (je suis d'ailleurs largement resté fidèle à ce point de vue). De plus, l'invitation à l'Université Paris-I de conférenciers ou professeurs invités tels que Jürgen Habermas, Jules Coleman, Hans-Jorg Sandkühler, Michael Sandel et Thomas Scanlon était un puissant stimulant du mouvement des idées autour de la théorie des normes.
De nombreux projets apparaissaient et disparaissaient ; certains prenaient figure dans nos travaux respectifs. Le projet « Dynamique des normes et rapport aux institutions », retenu au titre de la politique scientifique de l'Université Paris-1, illustra cette dynamique collective, orientée vers la construction de schèmes explicatifs ou descriptifs systématiques, dans le souci de l'identification des méthodes adaptées à un champ de recherche spécifique. La collaboration maintenue avec de nombreux sociologues et économistes ainsi que les apports de la philosophie wittgensteinienne donnaient à nos rencontres une vitalité particulière. Le projet franco-canadien sur la rationalité, dont je m'occupais avec Jacques Dubucs, et auquel prit part également le philosophe américain John Vickers, permit par ailleurs de resserrer les liens entre les approches logiques, décisionnelles et probabilistes de la rationalité. L'apport de nos collègues d'Outre-Atlantique fut déterminant surtout autour des thèmes de philosophie générale ; sur le vieux continent, il me semble que la plupart des contributions tiraient leur intérêt du dialogue entre philosophie et sciences sociales autour de questions de modélisation et de méthode.
Le mot d'ordre de la réorientation des travaux de l'IHPST vers l'étude directe des objets scientifiques, saisis au niveau des principes et des questions de méthode, avait eu un effet d'entraînement sur nos travaux. Cela avait certainement brouillé, pendant un certain temps au moins, la distinction entre science et philosophie et conduisait à pratiquer la philosophie des sciences d'une manière essentiellement « interne », dans le but d'être directement utile au progrès des sciences spécialisées. Comme nous avions choisi comme objets d'étude les règles et les organisations, cela nous conduisit - fort logiquement - dans le voisinage de l'étude directe de ces objets telle qu'elle est pratiquée en philosophie politique ou en philosophie sociale.
L'apport le plus important de cette période est certainement, pour moi, l'habitude prise d'une collaboration régulière et substantielle entre philosophes et checheurs des sciences sociales autour d'enjeux réellement partagés et tolérant une diversité d'approches. Cela nous permit de réaliser plus profondément que par le passé l'imbrication des apports de la philosophie et des sciences sociales dans les domaines de l'ontologie sociale et de l'étude des processus sociaux, économiques ou politiques. La dernière phase de mon travail à l'IHPST en tant que responsable du pôle de philosophie des sciences sociales (je suis désormais membre associé de l'équipe) se superposait à l'implication dans le programme européen Applied Global Justice (dirigé par Jean-Christophe Merle), dans lequel prit véritablement forme, me semble-t-il, une communauté de recherche en philosophie politique à l'échelle européenne.
Un rapprochement avec la pensée sociale critique
En tant qu'individu, je suis vivement ému par la pauvreté évitable, par les situations de famine et l'absence de soins aux enfants et aux malades dans certains pays, par la condition des personnes privées de domicile, et par d'autres aspects dramatiques de l'existence. Pour autant, je ne peux pas me présenter comme un critique de longue date de la société capitaliste, même si l'inaptitude de nos mécanismes institutionnels (nationaux et internationaux) à gérer ce type de problème saute aux yeux. Je n'ai jamais éprouvé devant la « société de consommation » l'espèce de fatigue mêlée de réprobation que l'on rencontre souvent dans les milieux contestataires. J'ai tendance à rechercher dans les faiblesses de l'organisation politique et politico-économique, plutôt que dans l'économie de marché en tant que telle, la racine de nos plus grands maux. Je dois confesser que mon attitude typique est plutôt une admiration très réelle pour les mécanismes institutionnels et économiques complexes qui ont permis un développement économique remarquable et une prospérité largement partagée dans nos démocraties occidentales depuis la période d'après-guerre.
Pourtant, à mesure que je voyais se durcir un discours néolibéral manifestement dirigé contre de nombreux droits sociaux et contre les formes élémentaires de l'égalité des chances, je me suis incontestablement rapproché des voix critiques qui se font aujourd'hui entendre. N'étant pas hostile par principe à l'économie de marché, mon cheminement personnel vers une pensée critique a essentiellement pris la forme d'une réaffirmation des droits de la pluralité démocratique face aux discours officiels qui se prévalent du soutien souvent fort ambigu de l' »éthique » ou de la « théorie économique », ou encore (aujourd'hui comme hier) du « progrès ». Mes longues discussions avec Cyrille Michon et Jocelyn Benoist et les écrits de ce dernier sur la politique, comme aussi les travaux de Sandra Laugier sur la logique sociale et politique de la revendication et ceux de Christian Arnsperger, avaient fait évoluer mon point de vue sur la critique sociale, dans le sens d'une appréciation plus positive. J'en vins à considérer comme tout à fait naturel que nos sociétés soient le lieu de coexistence de points de vue mutuellement incompatibles et qui n'ont pas vocation à se fondre dans un consensus « éthique » décrété par les instances dirigeantes de la société ou dans les salons philosophiques. Face au réquisit rawlsien de rassemblement de la société autour d'une conception partagée de la justice, et devant l'évidence de la coexistence prolongée de conceptions antithétiques de la justice, j'en vins à formuler en mon for intérieur, à propos de nos sociétés pluralistes, quelque chose comme un : « Et pourtant, elles sont stables… ». Parallèlement, je reconsidérais avec un intérêt renouvelé les thèses de certains auteurs de la tradition marxiste au sujet de l'idéologie et de l'appareil d'Etat, alors même que le « marxisme analytique », qui évoluait en direction d'une théorie normative du mérite, en laquelle je ne croyais pas (j'avais été convaincu par la critique du mérite développée par Rawls) m'intéressait finalement assez peu.
Mon indignation au spectacle de la « bioéthique » et mes doutes grandissants sur le sérieux des constructions intellectuelles inspirées par le néolibéralisme furent les sources d'une sympathie nouvelle, vers la fin des années 1990, pour les formes critiques d'examen du discours idéologique et du comportement stratégique des institutions d'Etat. Par ailleurs, mes travaux sur le positivisme juridique (sur Kelsen, Hart et Eisenmann en particulier) m'avaient fait comprendre l'intérêt d'un relativisme de méthode dans l'examen des rapports entre normes publiques et convictions éthiques. En bref, à partir de plusieurs séries de raisons, j'étais mal disposé à l'endroit des approches « consensualistes » dominantes.
Je devais développer cette piste dans des conférences, à Varsovie et à Graz notamment, et aussi, dans une collaboration avec Christian Arnsperger, visant à réévaluer les chances du « compromis » en théorie politique, situé à égale distance du consensus éthique et du simple modus vivendi. Christian Arnsperger s'était lui-même rapproché de cette zone d'investigation à partir d'une relecture des maîtres de l'école de Francfort et d'une réflexion sur la coexistence de groupes animés de convictions éthiques irréductiblement distinctes au sein des sociétés libérales. Après la publication de notre article conjoint dans Social Science Information, nous avons acquis une meilleure perception des liens existant entre notre approche et celle d'autres auteurs, en particulier Bernard Dauenhauer et Richard Bellamy dans la sphère anglophone. Ce travail sur le compromis devait orienter mes travaux vers une prise en compte plus explicite de l'évolution des interprétations de normes et des rapports d'autorité dans la vie publique.
Les projets collectifs dans le cadre de NoSoPhi
Mes travaux se concentrent sur l'étude des normes et des institutions, dans le contexte de l'équipe NoSoPhi de la Sorbonne (Paris-1), en liaison avec des institutions françaises et étrangères. Notre programme collectif « Delicom », lancé sous les auspices de la nouvelle Agence nationale de la recherche, concerne la manière dont se délimite concrètement le pouvoir légitime des institutions politiques dans des processus d'interaction et de communication entre les institutions. Des processus qui, pensons-nous, sont à la fois stratégiques et argumentatifs, et doivent être étudiés (aussi bien philosophiquement qu'empiriquement) en tenant compte simultanément de ces deux aspects et de leur imbrication. Les institutions communiquent entre elles, selon des modalités complexes qui engagent aussi le pouvoir effectif des institutions elles-mêmes - ce que nous étudions dans le prolongement de quelques aperçus remarquables d'études théoriques et empiriques antérieures à nos travaux.
Par ailleurs, la collaboration avec l'université de Strasbourg autour de la philosophie du libéralisme confirme l'intérêt d'une collaboration entre philosophes et économistes autour de la question des droits et des libertés. Nous reprenons aussi dans ce contexte le projet, conçu jadis à l'IHPST en liaison avec Caroline Guibet-Lafaye et Antoinette Baujard, d'un répertoire analytique des normes d'éthique sociale devant offrir une clarification des repères éthiques disponibles dans différents champs d'interaction, et susceptibles d'être mobilisés pour orienter de telle ou telle façon l'organisation collective. Nous développons tout d'abord ce type d'approche dans le champ de l'analyse des droits, pouvoirs et libertés - autrement dit, autour des notions que nous trouvons par ailleurs mobilisées, avec un rôle structurant, dans des interactions politiques ou sociales que nous étudions et dont nous cherchons à nous instruire pour mieux comprendre ce qu'est en réalité la délimitation des pouvoirs et des droits.
11:50 Publié dans La vie des idées | Lien permanent | Commentaires (0)
27/01/2008
Rapport Attali
Inutile de l'acheter, il est ici en ligne:
19:49 | Lien permanent | Commentaires (0)
La démocratie malade de son triomphe
Jean-François Gautier, le 25-01-2008
Deux penseurs d’horizons différents, l’Américain Fredric Jameson et le Français Marcel Gauchet, concluent tous deux au désenchantement et à l’épuisement du modèle démocratique.
Les diagnostics des désenchantés concordent. En voici deux qui viennent de la gauche extrême, et dont les réflexions se croisent. Le premier, Fredric Jameson, appartient à la catégorie très particulière des néomarxistes américains : dans un pays qui n’a jamais connu de parti communiste institutionnel, ce terme désigne des intellectuels dont les travaux mêlent littérature, économie et sociologie (Cultural Studies), avec une pointe d’hommage à ce qu’on nomme là-bas French Theory, à savoir le Collège de France d’il y a trente ans (Michel Foucault et Roland Barthes) rehaussé d’emprunts à Deleuze et à Sartre.
Jameson a 73 ans. Il n’a pas pris sa retraite et enseigne la théorie critique à l’université de Duke (Caroline du Nord). La récente traduction de ses Archéologies du futur, ouvrage paru aux États-Unis en 2005, est la meilleure des introductions en français à ses écrits. Il constate que, depuis la fin de la guerre froide (Berlin, 1989), il n’existe plus de représentation d’une alternative au capitalisme financier de son pays. Dès lors, un paysage mercantile et cauchemardesque s’installe, un monde plein, total, sans bords, dans lequel la pacotille et le kitsch se généralisent et stérilisent toute « puissance d’agir ».
Si toute alternative politique ou pratique a disparu – symptôme, selon Jameson, de la véritable « révolution culturelle postmoderne » –, comment ne pas désespérer ? Pour Jameson, la seule manière de rompre avec un monde-sangsue devenu insupportable, et de retrouver une altérité, c’est de cultiver l’utopie. Par ce biais, selon lui, émergeront le désir partagé de se débarrasser d’un carcan invivable, et les idées pro pres à en finir avec lui.
Même bilan chez un autre analyste de la modernité, français celui-là, enseignant à l’École des hautes études en sciences sociales et cofondateur de la revue le Débat. Marcel Gauchet, Nor mand de naissance, agitateur à Caen et boîte aux lettres du gauchisme soixante-huitard, est re venu des utopies de sa jeunesse. Dans le Dé senchantement du monde (1985), notion reprise du sociologue allemand Max Weber, il avait constaté la disparition progressive de tout horizon dépassant le quotidien, tant du point de vue religieux que politique.
Dans une longue étude consacrée à l’Avènement de la démocratie, dont deux volumes viennent de paraître, il montre combien ce qui a fondé les démocraties mo dernes (l’État, garantie des libertés) se retourne contre elles : l’État et la collectivité sont devenus des monstres honnis, au nom de la singularité et de l’autonomie des individus, elles-mêmes pourtant assurées par l’État.
Gauchet décrit comme « l’immense dilemme du premier XXe siècle » cette balance entre, d’une part, l’émergence d’un sujet juridique sans partage, revendiquant sa différence propre, et, d’autre part, le droit de l’État sans lequel il n’existe plus de nation, ni de forme politique stable offerte à cette nation. Les totalitarismes modernes ont exacerbé le second terme de l’alternative, la suprématie du collectif ; ils ont fondu au soleil de l’Un et exaspéré les valorisations de la différence singulière et de la souveraineté de l’individu, elles-mêmes devenues la norme. Mais cette norme doit bien être cautionnée quelque part. Et par quoi le serait-elle, sinon par l’État ?
Ainsi sont apparues des démocraties considérées comme modèle unique, incontestées quand elles existent, revendiquées quand elles sont absentes, mais auxquelles il est demandé d’avaliser leur exact contraire : la perte de toute efficacité pratique, aux fins de laisser ouvertes les expressions de la liberté individuelle. Les démocraties n’ont plus d’ennemi, ni interne, ni externe, et il est inimaginable de conspirer contre elles. Comme l’avait de longue date noté le situationniste Guy Debord, on ne peut plus se révolter contre le système dominant, seulement en sa faveur.
Pratiquement, la situation est intenable. « L’affaiblissement des démocraties marche au même pas que leur approfondissement », constate Gauchet. Devenues un horizon indépassable, elles s’effondrent face au marché souverain de la finance qui lamine les indépendances collectives, et rabote les illusions de libertés individuelles. Julien Freund, qui fut l’un des maîtres majeurs de la pensée politique dans la seconde moitié du XXe siècle, avait annoncé voilà vingt ans que la fin du communisme ouvrirait sans frein les portes de la finance internationale, et donc sa domination. Voilà qui est fait. Mais que lui opposer ? « Si loin que nous nous efforcions de porter le regard, écrit Gauchet, nous nous découvrons bel et bien prisonniers en pensée de ce qui s’impose à nous sous la figure d’une fin. »
Est-ce si sûr ? L’idée d’une “fin de l’Histoire” a été développée en 1992 par l’essayiste nippo-américain Francis Fukuyama, dans un grand scandale pour les bons esprits qui y lisaient une thèse néomarxiste. Ce n’était que la description pertinente d’un état social et mental actuel, bien évidemment transitoire : tant qu’il y aura des hommes, ils fabriqueront leur aventure. Le diagnostic de Gauchet est nonobstant justifié : même transitoirement, l’horizon a disparu ; il n’y a plus de figures de l’avenir disponibles pour les imaginations. Il ne reste qu’un monde vétuste et sans joie.
Sans doute est-il possible d’enrichir son constat. Dans la Fin de la Renaissance (1980), Julien Freund avait fait remonter plus haut les sources de notre moment présent de l’histoire européenne, et montré le basculement opéré à la Renaissance : l’égalité eschatologique des âmes, assurée par la ré demption à venir, s’était muée en projet de conquête de l’égalité juridique des individus, ici et maintenant, conquête à la quelle de nouveaux moyens de transport, maritimes et ter restres, avaient donné des horizons nouveaux, vers des terres alors inconnues. Mais la planète est ronde, et l’objectif a été réalisé. Dès lors, que faire ?
Marcel Gauchet ne parie pas, comme Jameson, sur quelque nouvelle utopie du sens de l’Histoire (les désastres des communismes ont vacciné les plus lucides) ; il appelle de ses vœux une manière nouvelle d’habiter le présent et de le fabriquer, dont il pense qu’elle s’épanouira à l’abri des erreurs du XXe siècle puisque les idées démocratiques ont partout absorbé celles de leurs adversaires. « À nous supposer retombés sous l’oppression, assure-t-il, nous n’aurions que cet idéal pour guider notre libération. » L’avenir se construira donc, selon lui, au-dedans de la démocratie, quoi qu’il en soit des contradictions qui l’assaillent.
Est-ce certain ? Pour reprendre une catégorie essentielle du politique, développée par Carl Schmitt et par Julien Freund, les États modernes ont deux ennemis. Le premier les désigne comme tels. Il s’agit du terrorisme. Mais la difficulté pratique avec les groupes terroristes c’est que, contrairement aux ennemis classiques, ils n’ont ni terre ni État. Dès lors, à qui s’en prendre, et comment ? S’ils ne disposent pas de tactiques capables de répondre à ce défi, les États modernes disparaîtront. Et la fermeté pour la fermeté, telle que le commandement américain la développe en Irak, a montré ses limites : sans ennemi clairement cerné, il n’y a pas de victoire possible sur lui ni, surtout, de paix à construire avec lui. La menace, latente, souligne l’impuissance des États à se déterminer.
Le second ennemi, lui aussi sans terre ni État, n’est pas partout désigné. Il est pourtant connu de longue date. Philippe IV le Bel l’avait en son temps identifié et avait résolu, contre le Temple et les banquiers lombards, le problème posé : un État qui ne contrôle pas sa monnaie a déjà perdu son indépendance. En d’autres termes, il n’y a pas de pouvoir faible ; il y a toujours du pouvoir quelque part, c’est-à-dire une faculté laissée à une institution, ou à des institutions, de décider en dernier ressort, quelle qu’en soit la modalité.
Autant dire qu’une institution de pouvoir affaiblie, comme Marcel Gau chet l’analyse dans les démocraties modernes, ne résulte pas seulement d’un dilemme interne. Elle est aussi le signe qu’un pouvoir effectif a été transféré ailleurs, sous d’autres formes. Les États européens ne contrôlent pas l’indépendance de leur monnaie. Quand le patron d’Airbus dit qu’il perd de l’argent à fabriquer des avions, à cause de questions de change, il ne pose pas un problème de technique financière mais bel et bien un problème politique, le quel ne peut être résolu que dans l’ordre politique, et selon une logique som maire : qui décide, en dernier ressort ?
Voilà un défi offert aux dirigeants européens. Seront-ils capables de le relever dans le cadre des institutions européennes ? Il n’est pas certain que vingt-sept pays puissent répondre ensemble, d’une seule voix. Il est dès lors acquis que d’au tres alliances plus serrées seront vitales.
La voie ouverte par de Gaulle et Adenauer, balisée par le traité de l’Élysée (1963), montrait un chemin : l’avenir politique européen passe par une armée franco-allemande, seul critère d’émergence d’une puissance européenne, laquelle serait alors capable d’imposer sa monnaie dans un concert planétaire en fin rééquilibré. Cet horizon-là déploierait une opportunité interne de dépassement du désenchantement, mais donnerait aussi l’occasion à ses opposants – ou à ses ennemis – de s’exprimer : retour du politique par la politique. Henry Kissinger semble être le seul dirigeant américain à l’avoir compris et écrit.
Reste que ce qui lie des individus entre eux ne s’exprime pas d’abord par des idées, mais aussi et surtout par des symboles. L’Arabie Saoudite n’existe pas d’elle-même ; le ressort de son histoire tient pour l’essentiel dans quelques centimètres cubes de matière minérale : la pierre noire de la Kaba. Qu’est-ce qui vaut, aujourd’hui en Europe, comme signe indubitable d’une destinée commune ? Le terrorisme islamique rappelle à chaque attentat suicide que ce que vaut une vie s’inscrit dans ce qui la dépasse. Où se logent, en ce début de siècle, les ressorts de ce que Georges Dumézil, résumant des traditions indo-européennes millénaires, nommait la fonction souveraine, mixte de juridique et de religieux ? Le bavardage culturel à la mode a estompé cette fonction majeure, au point d’en biffer les traces. En a-t-il fait, pour autant, disparaître la nécessité ? C’est, en creux, la question posée par les essais qui viennent de paraître.
11:25 Publié dans La vie des idées | Lien permanent | Commentaires (0)
Finkielkraut: «L'enfant gâté a succédé à l'homme cultivé»
Alain Finkielkraut juge que des menaces pèsent sur la civilisation et s'inquiète de l'appauvrissement de la langue, donc de l'être.
Recueilli par CATHERINE CALVET et BÉATRICE VALLAEYS
Libération : samedi 26 janvier 2008
Né en 1949 à Paris, Alain Finkielkraut est professeur au départemen humanités et sciences sociales de l’Ecole polytechnique. Il anime aussi l’émission Répliques sur France Culture. Parmi ses œuvres : le Juif imaginaire (Seuil, 1980) ; l’Avenir d’une négation (Seuil, 1982) ; l’Ingratitude (Gallimard, 1999) ; Nous autres modernes (Ellipses, 2005). On le dit inclassable, il l’admet, le cultive, et prétend simplement essayer de penser le monde sans œillères ni garde-fou.
Qualifié aussi de «vieux jeu» - Daniel Cohn-Bendit dit de lui qu’il arrive tout droit du XIXe siècle -, il assure n’avoir aucune nostalgie. Signes particuliers : pas de portable ni d’ordinateur.
Vous êtes un intellectuel. Comment vous définiriez-vous ?
Je ne sais pas qui je suis. Je sais que j’ai été un élève consciencieux et moins doué que voué, par l’angoisse, à faire de bonnes études. J’ai été admis en 1969 à l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, j’ai passé trois ans plus tard une agrégation de lettres modernes, j’ai enseigné le français pendant deux ans dans un lycée technique à Beauvais, puis aux Etats-Unis, à l’université de Berkeley. J’ai écrit mes premiers livres avec Pascal Bruckner, puis j’ai essayé d’unir, dans mon écriture et mon enseignement à l’Ecole polytechnique, la passion littéraire et, plus tardive, mais non moins intense, la passion philosophique. Il est dit de moi, depuis la Défaite de la pensée (Gallimard, 1987), que j’ai trahi la gauche et que je suis une «pleureuse réactionnaire». La Querelle de l’école (éditions Stock), qui vient de paraître, n’a pas arrangé les choses. C’est complètement idiot. Mais je ne cherche plus à me justifier ni à montrer patte blanche à qui que ce soit. Je prends acte de cette mauvaise nouvelle : la démocratie est sortie de son lit et elle envahit des espaces où elle n’a rien à faire, notamment l’éducation et la culture. Or refuser la dissymétrie institutionnelle de l’école pour en faire une communauté éducative, c’est tuer l’école. Refuser la hiérarchie des valeurs esthétiques, la distinction entre la culture et l’inculture, ou même entre la beauté et la trivialité, c’est tuer la culture. Ce meurtre est-il de gauche ?
Vous défendez l’idée qu’il doit y avoir de la sélection, qu’il faut mettre fin à la démagogie à l’école. Or, dans «la Querelle de l’école», il est dit que la France est l’un des pays occidentaux qui pratique le plus la sélection. Pourquoi déniez-vous le droit à la réussite pour tous ? Vous n’êtes pas d’accord avec cet autre slogan : «A chacun selon ses talents et ses mérites» ?
Le drame de notre temps, c’est la transformation de toutes choses matérielles ou spirituelles en droits de l’homme. Nous avons ainsi changé d’époque et d’idéal : l’enfant gâté succède à l’homme cultivé. Tout le monde, c’est vrai, n’est pas gâté - loin de là. Tout le monde n’est pas consommateur de tout, mais tout le monde veut l’être et le proclame. Le droit à la réussite constitue l’élève en client et en produit de la fabrique scolaire. Si le produit est défectueux, le client et ses parents sont fondés à se plaindre. Ce drôle de droit court-circuite la culture, c’est-à-dire l’effort, l’élévation que permet l’école mais qu’elle ne peut faire à la place de l’élève. La métaphore de l’ascenseur social procède du même infantilisme. Il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour connaître un destin meilleur. Et si la réussite est un droit, la sélection devient un sévice. Elle a donc disparu de l’enseignement secondaire. Ce qui fait que les universités sont des abattoirs et que les élèves nantis bénéficient soit des écoles privées, soit du soutien scolaire pour pallier, non leurs défaillances, mais celles de l’école publique elle-même ! L’idéal de l’enfant gâté détruit la culture sans réduire les inégalités. Comme vous le voyez, il a tout bon.
S’il y avait des classes de dix, quinze élèves dans les quartiers difficiles, les chances de transmettre le savoir seraient plus grandes qu’avec des classes de quarante. L’ascenseur social existerait bien, non pas en appuyant sur un bouton, mais par l’effort…
Il faut réintroduire l’émulation partout, et la création de classes préparatoires dans les zones dites sensibles va dans ce sens. Mais il faut savoir aussi que, comme l’a dit à Libération (1) Karen Montet-Toutain, enseignante à Etampes (Essonne), après l’agression dont elle a été victime, les professeurs ont d’autant plus de mal à imposer leur autorité qu’ils sont perçus comme des minables avec leurs 1 500 euros par mois.
Des professeurs méprisés, chahutés, ridiculisés par leurs élèves ont toujours existé. Certains sont même des figures de la littérature, comme le professeur Unrat de Heinrich Mann dans «l’Ange bleu». Qu’il s’agisse ici du salaire de l’enseignante mérite-t-il une analyse différente ?
Arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt bien-pensant : le chômage dans les banlieues n’est pas seulement imputable au racisme, il tient aussi à l’attrait exercé par les trafics de l’économie parallèle. Il est plus tentant, quand on rêve d’une consommation infinie, d’être dealer que plombier, maçon, avocat, médecin, sans parler de professeur, ce métier de pauvre ! Et il y a du nouveau sous le soleil. Le nouveau, en l’occurrence, c’est le règne sans partage d’une télévision sans complexes, c’est le rôle prescripteur des amuseurs, et c’est la transmission des normes sociales par les vedettes de la jet-set et du show-biz. L’écran, qui envahit tout, est lui-même envahi par une nouvelle caste dominante qui se croit libérée des préjugés bourgeois, alors qu’elle s’est affranchie de tout scrupule et dont les goûts, la langue, la connivence régressive, l’hilarité perpétuelle, l’obscénité tranquille et le barbotement dans la bassesse témoignent d’un mépris souverain pour l’expérience des belles choses que les professeurs ont la charge de transmettre. Il est toujours plus difficile de résister à ce déferlement.
Vous exonérez un peu vite les politiques. Giscard d’Estaing et Mitterrand sont sans doute les premiers à se pipoliser, de Gaulle et Pompidou n’autorisaient que rarement les micros. Quand Mitterrand intègre dans son gouvernement Tapie ou Charasse, qui empruntent au registre populaire, voire populiste, il le fait sciemment. Sarkozy, lui, n’a même plus besoin d’un Tapie ou d’un Charasse…
J’ai eu beau affirmer pendant toute la campagne électorale ma non-appartenance, on a voulu que je sois un rallié du sarkozysme. Pourtant, quand le Fouquet’s et le yacht aux sept écrans plasma ont remplacé la retraite annoncée, j’ai été le premier - je n’en tire aucune gloire - à signaler le risque d’une grimaldisation et d’une berlusconisation de la République. Mais je suis éberlué par l’aplomb des journalistes qui dénoncent vertueusement le grand déballage de la vie privée présidentielle tout en y prêtant complaisamment la main. Les mêmes qui s’indignent des frasques de Sarkozy vantent les qualités littéraires d’ouvrages qui ne sont que des ramassis de ragots et d’indiscrétions. A ces voyeurs antiexhibitionnistes, à ces tartuffes si curieux de ce qu’ils font profession de ne pas vouloir regarder, je demanderai, avec Soljenitsyne, qu’ils respectent, eux aussi, mon droit de ne pas savoir et de ne pas encombrer mon âme avec des cancans et des histoires d’alcôve. Journalistes, oubliez Carla ! Et si vous dites que Sarkozy vous instrumentalise en étalant sa vie sentimentale, soyez adultes ! Questionnez le Président sur le pouvoir d’achat, l’école, le contraste entre la politique de civilisation et la volonté non moins affichée de libérer la croissance, c’est-à-dire la consommation, de toute pesanteur civilisationnelle, l’effrayante idée d’introduire la diversité dans la Constitution pour mettre celle-ci au goût du jour, comme s’il n’importait pas plutôt de mettre le jour au goût de la République une et indivisible, et ne faites intervenir la vie privée que dans ce cadre : demandez-lui si la volonté politique de reciviliser l’être-ensemble est selon lui compatible avec une présence ostentatoire à Eurodisney.
Il n’est pas seulement question de la surexposition médiatique du Président, mais surtout de la langue employée par Sarkozy. Ceux qui l’ont précédé à l’Elysée étaient cultivés et parlaient un français parfait. Sarkozy cultive le parler vulgaire, en même temps qu’il lance sa politique de civilisation.
Vous avez raison : le destin de la civilisation est lié à celui de la langue. Si l’expression «politique de civilisation» a fait mouche, c’est parce qu’elle a rencontré et cristallisé une inquiétude diffuse aujourd’hui en France. La civilisation n’est plus la totalité qui nous enveloppe, c’est une lumière qui clignote et menace de s’éteindre. Nous sentons confusément qu’un trésor se défait. La politique de civilisation, c’est l’extension de la préoccupation écologique à l’art de vivre. Les exemples de dé-civilisation abondent.
N’est-ce pas plus grave quand ces exemples de dé-civilisation viennent d’en haut ?
Ils viennent de partout, c’est cela qui est grave. Moins vous avez de mots et moins vous avez de monde à contempler, à aimer, à penser, moins donc vous savez être seul et silencieux. La langue heureuse meuble le silence, la langue racornie conduit au vacarme. Alors que faire ? S’adapter, nager dans le sens du courant, comme le demandait mélancoliquement Jean-François Kahn dans le Monde, c’est-à-dire raccourcir les phrases, répéter le sujet, supprimer les références historiques car Yalta ne dit plus rien à personne ? Non, il faut planter ses talons dans le sol, exiger de tous les hommes publics qu’ils parlent avec soin, ne pas craindre de remettre dans la langue de la civilisation, c’est-à-dire du subjonctif, du futur antérieur, des qualités, du tremblement et des nuances. Mais les linguistes ne l’entendent pas de cette oreille, eux qui se targuent de chercher dans les cours de récréation les nouveaux mots du dictionnaire.
C’est plus compliqué que ça, l’entrée d’un mot dans le dictionnaire obéit à des règles très scrupuleuses…
Non elle obéit à une démagogie échevelée. Tous les ans, les journaux célèbrent les nouveaux entrants, surtout s’ils sont techniques ou s’ils sont dépenaillés. J’aimerais, pour ma part, que ces mêmes journaux mènent une enquête sur les pauvres et beaux mots éliminés chaque année du dictionnaire pour faire de la place. Ce serait tristement instructif.
L’introduction de mots anglais vous chagrine ?
Pas du tout. Certaines réalités humaines sont mieux cernées par l’anglais que par notre langue. Je pense par exemple à self-righteousness : un mot beaucoup plus percutant que notre «bonne conscience». En revanche, la consécration de «cool» n’est pas très heureuse car elle relève de la paresse et non du souci de précision, mais je n’aime pas d’avantage «super». Et il n’y avait pas urgence à introduire dans le Robert le mot «rebeu». Ceux qui ont eu cette idée voulaient être à la page, mais on est toujours le réactionnaire de quelqu’un. Pour avoir qualifié le mot «rebeu» de péjoratif, le dico sympatico s’est attiré les foudres des associations antiracistes.
Beaucoup de linguistes défendent l’idée qu’une langue meurt si elle n’est pas renouvelée par des mots qui apparaissent au fil du temps.
L’expérience du XXe siècle aurait dû nous guérir des illusions du progressisme. Tout mouvement n’est pas progrès, et la vie ne saurait être à elle-même son propre critère. La vie peut être bête, laide, brutale, meurtrière. Si, incapable de surmonter vos angoisses et vos obsessions, vous demandez conseil à un ami et que celui-ci vous suggère de consulter un psy de sa connaissance qui vous «renseignera sur comment gérer votre stress», vous n’avez aucune raison valable de vous réjouir, en l’écoutant, des capacités de renouvellement de la langue. Il parle comme on n’a jamais parlé, et c’est atroce. Et puis il y a les terribles serial killers de la langue, ces mots qui en effacent des centaines d’autres.
Par exemple ?
Sympa. Vous avez prêté Retour à Florence de Henry James à quelqu’un qui vous dit : «J’ai lu ce livre, c’était vraiment sympa.» S’il y a quelque chose que Henry James n’est pas, c’est «sympa».
Vous évoquez la culture de masse, née précisément avec les baby-boomers, c’est-à-dire votre génération.
Je n’ai aucun orgueil générationnel, mais je crois quand même, avec Olivier Rolin, que la révolte de 1968 contre le vieux monde avait ceci de touchant qu’elle était faite avec les ronéos, les livres, les instruments et la rhétorique du vieux monde. Mais les soixante-huitards ont une grande part de responsabilité dans le désastreux rapatriement de la grande idée critique de relativisme culturel à l’intérieur de nos sociétés. Ce qui était un défi salutaire à l’arrogance de l’Occident est devenu l’alibi du nivellement de toutes les pratiques humaines. Le cultivé se dissout ainsi dans le culturel. La culture n’est plus perçue ou pensée comme un travail de soi sur soi, comme un exercice, mais comme une identité que chacun trouve en lui-même et qu’il exprime comme il veut. Le malaise actuel dans la civilisation tient à ce remplacement de l’exercice par l’expression dans l’espace privé et dans la sphère publique, de la naissance à la mort.
Que pensez-vous de la BD ?
Si je vous en dis du mal, vous me répondrez, comme pour le rap ou la techno, «tu n’y connais rien, cette scène est d’une richesse et d’une variété extrêmes». Mais il y a tant de livres à lire, de toiles à admirer, que je n’ai pas de temps à perdre pour ce qu’on appelait autrefois les illustrés. La beauté des livres, c’est qu’ils sont sans images et qu’ils offrent ainsi libre carrière à l’imagination. Quand on me raconte une histoire, j’ai besoin qu’on me donne à penser, qu’on me donne l’envie d’interrompre ma lecture et de lever la tête, pas qu’on dessine pour moi les héros. Mais les enfants gâtés veulent rester des enfants.
Au fond, vous êtes terriblement irritant. A priori, on vous rangerait à gauche, mais vous prenez toujours tout le monde à contre-courant. Vous êtes d’ailleurs plus agaçant à l’écrit qu’à l’oral ; à l’écrit les propos apparaissent plus agressifs. Un penseur doit-il irriter pour rendre les gens intelligents ?
Pas du tout. Penser, c’est chercher à tâtons la vérité sans se laisser intimider par l’opinion majoritaire ni séduire par la tentation du paradoxe à tout prix. Il n’y a, par exemple, rien de paradoxal à approuver le projet de supprimer la publicité à la télévision : c’est peut-être le seul moyen de retrouver à une heure décente, des émissions ambitieuses ou simplement intéressantes. La gauche pourtant a fait front, elle a dénoncé comme un seul homme la manœuvre du Président et son cadeau au privé. Il faudra être très attentif, bien sûr, à la mise en œuvre de cette réforme ; mais s’y opposer, c’est signifier qu’on abandonne la promesse d’un accès de tous aux lumières humaines pour une promesse de consommation sans fin des produits. «Goinfres de tous les pays, lâchez-vous !», dit aujourd’hui la gauche. La seule réponse digne à cette invitation est : sans moi.
A propos des valeurs intellectuelles et morales, Régis Debray évoquait dans «le Monde» le fait que de Gaulle avait décrété des funérailles nationales en 1945 pour Paul Valéry, quand Sarkozy n’a pas dit un mot à la mort de Julien Gracq. Pensez-vous qu’il appartient au chef de l’Etat de célébrer ces «grands hommes» ?
Oui. J’aurais aimé aussi que le président de la République, qui aime l’Europe et les voyages, se rende aux obsèques d’Ingmar Bergman et que France 2 diffuse, à cette occasion, Fanny et Alexandre en version originale et en première partie de soirée. C’était la moindre des choses, et elle n’a pas eu lieu. Mais il faut aussi prendre acte du paradoxe où nous vivons. Sarkozy est le premier chef d’Etat de la société postculturelle, mais c’est lui qui veut supprimer la publicité à la télévision alors que François Mitterrand, ce président raffiné et bibliophile, dont Régis Debray a été un temps proche collaborateur, a fait entrer Berlusconi dans la télévision française. Ce qui m’inquiète, c’est la culture du résultat, introduite au moment même où l’on parle de politique de civilisation. Christine Albanel va être notée sur la part de marché des films français en France. Le ministère de la Culture se réjouit donc du succès à venir du nouvel Astérix. C’est à pleurer.
Le bon penseur doit aussi avoir le talent de la transmission. Croyez-vous l’avoir ? Exemple : dans les années 60, beaucoup ont hurlé contre Françoise Dolto qui «vulgarisait» la pédopsychiatrie lors d’un rendez-vous radiophonique hebdomadaire. Votre travail à France Culture s’apparente-t-il à l’esprit de l’émission de Françoise Dolto ? Vos émissions sont-elles votre moyen de transmission ?
Dans mes émissions, dans mes livres, dans mes cours, je ne cherche pas l’accessibilité à tout prix, je cherche l’exactitude. Et ce qui me garde de l’hermétisme, c’est cette réaction de l’avant-gardiste Gombrowicz aux coquetteries de l’avant-garde universitaire française : «Plus c’est savant, plus c’est bête.» Je dois dire aussi que quand j’ai commencé à écrire, je n’avais en tête que mes pairs ou mes professeurs, ou l’université. C’est la rencontre avec Pascal Bruckner et notre livre écrit ensemble - le Nouveau Désordre amoureux, en 1977 - qui m’a libéré de ce surmoi-là. Fort heureusement, j’en ai d’autres.
Pascal Bruckner vous a-t-il apporté la fantaisie ?
Non, je crois qu’elle était présente. Il m’a donné le goût et la liberté d’écrire dans la langue naturelle. Je me suis affranchi avec lui du carcan du jargon. Et puis j’ai eu la chance de ne pas faire un mariage intra-universitaire. J’ai épousé une avocate, j’écris aussi pour elle, c’est-à-dire sans clins d’œil et sans sous-entendus. Pour ce qui est de mes interventions orales, j’essaie de les préparer comme des exercices d’éloquence. La parole spontanée est informe, débraillée, et j’y reviens : ce qui rend les émissions de télévision si souvent pénibles, c’est le culte de la spontanéité.
Parler comme vous le faites au plus grand nombre vous range-t-il dans la «politique de civilisation» ?
Attention avec cette histoire du plus grand nombre.
Vous préférez que l’on dise que vous ne parlez qu’à l’élite ?
Non pas du tout. Mais si un mot rare ou difficile me paraît nécessaire, je l’emploie ; si une référence historique n’est pas connue de tous, je l’utilise aussi, en l’explicitant au maximum, mais j’essaie de ne jamais simplifier.
Il y a une récurrence chez vous, et Cohn-Bendit vous qualifie d’homme du XIXe siècle, c’est l’idée que «tout fout le camp», et qu’avant c’était sinon mieux, du moins différent. Or souvent vous citez d’illustres intellectuels de jadis faisant sur leur époque le constat que vous faites sur la vôtre.
Non. Je suis sensible aux différences. Je ne dis pas que tout fout le camp, je vois le monde changer. Et quand Daniel Pennac, dans Chagrin d’école, nous explique que depuis toujours il y a des cancres, depuis toujours les pauvres parlent fort, depuis toujours les professeurs se plaignent du niveau, il suscite un soulagement et un attendrissement général, mais au prix de la vérité. Le cancre appartient à l’époque «sergent-major» où le bon élève n’était pas un «intello» ou un «bouffon», et la violence du rap ou la langue des banlieues n’ont rien à voir avec l’argot de Casque d’or.
A vous entendre, on va tout droit au chaos.
Rien n’est sûr. L’avenir n’est pas écrit. Je pense à ce film diffusé récemment sur Canal + : l’Education nationale, un grand corps malade. Une professeure de français, dans un collège de banlieue, disait qu’elle persistait, sans tenir compte des nouveaux programmes, à enseigner le Cid à ses élèves car ils aiment le dépaysement de «Va, cours, vole et nous venge». Mais si notre société qui n’a que l’Autre à la bouche continue à tenir l’actualité, c’est-à-dire le proche, l’identique, le pareil au même, pour seule capable de susciter l’intérêt des élèves, on s’enfoncera un peu plus, non dans le chaos, mais dans l’uniformité rugissante.
Daniel Pennac, dans «Chagrin d’école», cite une phrase du «Jeu de l’amour et du hasard» de Marivaux : «Dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l’être assez.»
Il vaut toujours mieux ne pas être méchant, mais ce n’est pas la bonté, ce n’est pas l’amour des élèves qui résoudra le problème de la misère linguistique en milieu adolescent. C’est la responsabilité du monde et l’amour intraitable de la langue dans lesquels on veut les faire entrer. On a tellement sentimentalisé l’école qu’on en est venu à criminaliser les notes. Si vous ne faites pas la différence entre l’élève et l’enfant, donner une mauvaise note à l’élève, c’est insulter l’enfant.
Vous êtes souvent et sincèrement en colère, comme si ce que vous analysez vous agressait personnellement. N’êtes-vous pas finalement d’abord un moraliste ?
Non, mais je pense effectivement quand je pense affectivement. «Les idées, disait Proust, sont des succédanés des chagrins.»
(1) Libération du 11 janvier 2006. Karen Montet-Toutain avait été poignardée par un de ses élèves.
03:15 Publié dans La vie des idées | Lien permanent | Commentaires (0)
23/01/2008
Récession
Principales caractéristiques et conséquences de l'entrée en récession de l'économie américaine
- Extrait GEAB N°15 (15 mai 2007) -
Comme l'a souligné à maintes reprises l'équipe de LEAP/E2020 depuis plus d'un an, les évènements qui se déroulent actuellement s'intègrent dans le contexte de la première crise systémique globale de l'Histoire, et chacun d'entre eux est donc porteur d'un impact qualitativement supérieur à un événement identique dans un contexte classique. Ainsi, la récession américaine qui vient de débuter n'est pas juste " une récession de plus ", comme les Etats-Unis en ont connu plusieurs ces dernières décennies, mais elle est, comme l'a annoncé LEAP/E2020 début 2007, le déclencheur de la " Très Grande Dépression US 2007".
En effet, elle s'inscrit dans un moment historique bien particulier qui est caractérisé par une détérioration de la puissance des Etats-Unis dans toutes ses dimensions (politique, économique, financière, monétaire, militaire, stratégique, diplomatique). Son impact sera donc multiplié par autant de crises-miroirs, transformant notamment la récession en dépression. Dans ce numéro du GEAB, l'équipe LEAP/E2020 souhaite présenter les grandes lignes des enchaînements dépressionnaires qui vont dominer l'économie américaine et mondiale au cours des prochains mois. Dans le prochain numéro, nous reviendrons plus en détail sur les conséquences pour le secteur financier (notamment sur les hedge-funds, les grandes banques d'affaires et le Yen carry-trade)
1/ Aggravation de l'insolvabilité du consommateur US, chute des profits des sociétés dépendantes du marché américain et licenciements massifs aliment une boucle rétroactive négative
Dès Novembre 2006, dans le GEAB N°9, l'équipe de LEAP/E2020 annonçait que l'insolvabilité du consommateur américain serait l'une des grandes caractéristiques de 2007. Les récents chiffres (en baisse) des ventes de détail (1) illustrent qu'en effet le consommateur américain, malgré un endettement croissant (y compris désormais sous forme de crédit revolving ou d'encours en cartes de crédit, puisqu'il ne peut plus emprûnter sur la valeur de ses biens immobiliers) (2), est en train de déclarer forfait (3). Cette évolution est renforcée, au-delà du problème du marché immobilier et du crédit connexe (4), par le fait que désormais l'emploi est affecté et que les licenciements se multiplient déjà dans l'industrie manufacturière et le commerce de détail, après l'immobilier et le bâtiment, et avant de s'étendre aux services.
Evolution comparée du taux des prêts à risques non remboursés et du prix moyen des maisons / Etats-Unis - source Reuters
Sans le crédit et sans les salaires, la consommation des ménages aux Etats-Unis ne peut plus représenter un facteur porteur de croissance. Or, elle a représenté 70% de la croissance US de ces dernières années. Cette défection du consommateur explique bien entendu l'entrée en récession de l'économie des Etats-Unis, mais elle éclaire également l'évolution des prochains mois, à savoir une contagion récessionniste qui va s'étendre d'abord vers les sociétés au contact direct du consommateur (1° et 2° trimestre 2007), puis remonter vers les industries de biens d'équipement et les services aux entreprises (2° et 3° trimestre 2007) (5). Le secteur financier américain (et implanté aux Etats-Unis), déjà affecté par les conséquences et les ramifications de la crise des prêts à risques (6), sera au coeur de cette spirale récessionniste (7).
A partir de ce moment, la boucle de rétro-activité négative est enclenchée, nourrissant la baisse des profits qui alimente le chômage (comme l'illustrent déjà les licenciements massifs en cours et la faiblesse de la création d'emploi) (8), qui lui-même pèse sur la consommation, et donc les profits des entreprises principalement dépendantes du marché américain. Les entreprises qui sont également bien positionnées sur les marchés asiatiques et européens pourront au contraire jouer d'un double atout : une croissance maintenue dans ces zones, et un effet de change positif si leurs résultats sont en dollars US.
II- Accélération de la baisse du Dollar, inflation importée, hausse du déficit de la balance des paiements et tensions commerciales avec l'Asie et l'Europe provoquent l'implosion du consensus à la Réserve Fédérale et l'entrée dans la " Très Grande Dépression "
Le taux EURUSD est déjà sur la pente des 1,40 et à l'été des 1,50. La tendance est la même pour la Livre britannique et le Yuan chinois. La prise de conscience généralisée de l'entrée en récession de l'économie américaine va accélérer la baisse des flux de capitaux investis aux Etats-Unis, aggravant de ce fait le déficit de la balance des paiements du pays. Ce phénomène renforcera le déclin de la devise américaine par rapport à l'ensemble des grandes monnaies mondiales; et aura une double conséquence d'aggravation de l'inflation importée (notamment via une hausse quasi-automatique des prix du pétrole libellés en Dollars US) (9), et de renforcement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et leurs partenaires commerciaux au premier rang desquels la Chine et le Japon qui seront simultanément exposés à une baisse de leurs recettes d'exportation (10) et à une réduction de la valeur de leurs réserves en Dollars US, mais aussi des pays européens. Pourtant le déficit commercial américain ne s'améliorera pas significativement dans les mois à venir faute de substitution possible aux importations.
Evolution des exportations américaines / Estimation jusqu'à Août 2007 - Source : Forecasts.org
Cette situation promet d'alimenter copieusement les conflits commerciaux entre les Etats-Unis et ses partenaires (11), tout en condamnant définitivement la moindre chance de relance du cycle de libéralisation des échanges de l'OMC et en renforçant les synergies régionales (Chine-Japon-Asean d'une part (12), UE dont Royaume-Uni/Euroland d'autre part). Et en ce qui concerne la Chine, ce sera un test décisif de sa capacité à affronter une telle réduction de ses exportations, entraînant notamment l'explosion de la " bulle spéculative boursière " du pays (13).
La Réserve fédérale américaine va désormais être au coeur de la tourmente politique, médiatique, économique, monétaire et financière, car ce qui n'est qu'une interrogation aujourd'hui va se transformer en accusation dans les prochaines semaines : pourquoi avoir tant tardé à baisser les taux d'intérêts et avoir condamné l'économie américaine à entrer en récession ? (14) Et la Fed ne pourra pas répondre publiquement la seule réponse valide : pour éviter un effondrement pur et simple de la devise US. Car en effet, comme l'équipe LEAP/E2020 l'a déjà longuement explicité dans les précédents numéros, la valeur de la devise américaine (déjà bien affaiblie) ne tient plus qu'à deux fils : le niveau favorable des taux d'intérêts américains et la croyance dans la valeur intrinsèque de l'économie des Etats-Unis. La prise de conscience de l'entrée en récession de cette même économie ayant coupé un fil, il ne reste plus que les taux d'intérêts pour éviter que la monnaie ne s'effondre. Mais évidemment, une telle déclaration est impossible à faire pour la Fed, car elle déclencherait aussitôt une fuite hors de la monnaie US. Alors parlons d'inflation maîtrisée, à maîtriser, maîtrisable, ... et préparons le terrain pour une baisse des taux forcément en demi-mesure (probablement 0,5%) d'ici l'été, tout en ayant l'air de maintenir une politique ferme et de ne pas céder à la panique. La panique viendra à l'automne du côté des politiques, au Congrès comme à la Maison Blanche, qui exigeront de l'action afin d'éviter la déroute électorale à l'automne 2008. Mais à ce moment là, ils devront choisir entre sauver le Dollar (15), ou sauver l'emploi de l'ouvrier Ryan, sur fond de vaste crise sociale (16).
--------
Notes:
(1) Source : MqarketWatch/DowJones, 11/05/2007
(2) Source : Mish's Global Economic Trend Analysis, 11/05/2007
(3) Source : Deloitte, 16/04/2007
(4) A Détroit, certaines maisons sont désormais moins chères qu'une voiture. Source : Reuters, 19/03/2007
(5) Ainsi, par exemple, l'immobilier commercial (hôtels, bureaux, magasins, ...) commence également à être affecté par la crise qui a touché l'immobilier d'habitation. Source : New York Times, 02/05/2007
(6) Comme déjà analysé dans le précédent GEAB, la crise du crédit aux Etats-Unis ne se limite plus aux prêts à risque (subprime). A lire : Bloomberg, 25/04/2007.
(7) Le cas de General Motors dont les profits au 1° trimestre se sont évanouis du fait des pertes de sa filiale financière GMAC, est particulièrement symbolique. Source : Yahoo, 02/05/2007
(8) Source : EpochTimes, 01/05/2007
(9) A lire: CnnMoney, 07/05/2007
(10) Au Japon, les premiers effets de l'entrée en récession de l'économie américaine se font déjà sentir via l'accumulation des stocks. Source : International Herald Tribune, 03/05/2007
(11) Le cas britannique est très symbolique en la matière. Source : Financial Times, 13/05/2007
(12) Le Japon, dont l'excédent commercial a augmenté de 80% au 1° trimestre 2007, réalise un chiffre croissant de son commerce extérieur avec la Chine, qui confirme son rôle de premier partenaire commercial. Source : YahooBiz/LaTribune, 25/04/2007
(13) A lire : MarketWatch/DowJones, 06/05/2007
(14) A Wall Street, certains opérateurs et spécialistes ont d'ailleurs déjà commencé à anticiper un futur " règlement de compte ". Source : Bloomberg, 30/04/2007
(15) Il est assez ironique de constater qu'un magazine américain aussi institutionnel que Foreign Affairs publie un article qui décrit la " fin des monnaies nationales " et appelle l'Amérique latine à rejoindre le Dollar US ... notamment pour le sauver face à l'Euro et une future monnaie commune asiatique. Foreign Affairs, 05/2007
(16) LEAP/E2020 a déjà commenté cet aspect dans les précédents numéros du GEAB et y reviendra dans l'avenir. Pour information, la crise de l'immobilier et du crédit commence à affecter durement les " babyboomers " américains qui se préparent à quitter la vie active. Source : MSNBC, 26/04/2007. Le tissu social de zones entières des métropoles américaines est déjà durement affecté par la crise immobilière en cours et les saisies qu'elle induit. Source : City Mayors, 14/04/2007 et CnnMoney, 07/05/2007
Mardi 08 Janvier 2008
22:11 | Lien permanent | Commentaires (0)
22/01/2008
Critique de la raison universitaire
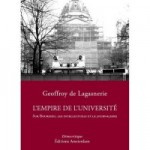 Critique de la raison universitaire
Critique de la raison universitaire
Par Thierry Pech
http://www.laviedesidees.fr/Critique-de-la-raison.html
Pourquoi les mêmes intellectuels critiques qui, dans les années 1960, appelaient à l’insurrection des savoirs contre l’académisme universitaire, se sont-ils retournés contre le journalisme et les médias au nom de l’institution universitaire à partir de la fin des années 1970 ?
Recensé :
Geoffroy de Lagasnerie, L’Empire de l’université. Sur Bourdieu, les intellectuels et le journalisme, Paris, Ed. Amsterdam, 2007, 112 p., 8,5 euros.
L’opuscule de Geoffroy de Lagasnerie part d’un paradoxe où l’on est tenté de voir une contradiction : les mêmes intellectuels – Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze et Pierre Bourdieu en l’occurrence – qui firent le procès de l’académisme universitaire et de son caractère « conservateur et répressif » dans les années 1960 et au début des années 1970, se révélèrent, à partir de la fin des années 1970, les plus rudes adversaires du système médiatique, et ce au nom du savoir et de l’institution universitaires. Après avoir valorisé la « vie du dehors », ils se rangèrent avec la même entière conviction à la « vie du dedans ». L’aventin universitaire, fustigé dans leurs jeunes années au profit d’une « insurrection des savoirs » et d’une libération de la parole, devint leur base de repli pratique et théorique pour critiquer une sphère médiatico-intellectuelle faite d’impostures, de gloires télévisuelles surfaites et d’essayisme bon marché. Nul n’eut alors la dent plus dure que ces clercs retournés au couvent en contempteurs implacables des turpitudes du monde…
Si G. de Lagasnerie voit dans ces deux positions successives, les visages inverses mais complices d’une même rhétorique, c’est tout de même à la critique de la seconde qu’il consacre l’essentiel de sa réflexion, parce qu’elle est, note-t-il, « devenue aujourd’hui dominante, voire hégémonique ». Le programme du livre est bien celui-ci : « s’interroger sur les effets d’une telle rhétorique de restauration de l’Université et de ses valeurs, et [en] critiquer les fondements théoriques et politiques », en évitant de retomber dans le piège de la première position, c’est-à-dire « une apologie du dehors du champ académique et des savoirs spontanés qui y naissent ». Bref, il s’agit de casser « la croyance dans la frontière » entre l’institution et son dehors, « les individus et les communautés qui portent le renouvellement théorique [n’ayant] pas d’espaces naturels assignés à l’avance ». Ce faisant, ce livre ne recherche pas le moyen terme ou la demi-mesure : il s’engage bel et bien sur le chemin d’un réarmement critique pour « comprendre selon quelle logique l’hérésie peut être véritablement soutenue et encouragée ».
Comment le revirement de ces intellectuels s’est-il produit ? G. de Lagasnerie reprend les arguments d’une croisade philosophique contre le « pouvoir journalistique » et décrit la montée en puissance d’un « fétichisme de l’université et de ses valeurs ». Deux dates semblent jouer un rôle moteur dans ce revirement : 1975 et 1976. 1975, c’est la naissance de l’émission de télévision Apostrophes qui va s’imposer rapidement comme le lieu où se font les réputations et les succès éditoriaux ; 1976, c’est la naissance des « nouveaux philosophes » dont la notoriété se construit presque entièrement dans la presse. G. de Lagasnerie propose d’analyser ce changement de pied de nos quatre intellectuels à la lumière des concepts qu’ils ont eux-mêmes forgés. Il montre ainsi que leur défense de la citadelle universitaire peut se comprendre comme un comportement « tactique » ou « stratégique », pour reprendre les catégories de M. Foucault. Il s’agit de réagir à une conjoncture qui menace leur situation acquise, car la nouvelle « capacité des médias à incarner un pouvoir alternatif de consécration » est « susceptible de produire un brouillage très puissant des hiérarchies intellectuelles ». « N’est-ce pas une sorte d’habitus intellectuel commun, confronté à un changement radical de l’ordre culturel, qui s’est exprimé dans leurs analyses (…) ? » Bref, Bourdieu, Derrida, Deleuze et Foucault auraient voulu réaffirmer leur monopole sur les choses intellectuelles et défendre une rente chèrement acquise.
L’analyse convainc d’autant plus que les mêmes n’avaient pas boudé le monde médiatique lors de la sortie de leurs livres, multipliant les interventions « extra-scientifiques » et les entretiens (Foucault en accorde onze pour la sortie des Mots et les choses et de l’Archéologie du savoir ; Bourdieu en donne quatre pour celle de la Distinction ; Deleuze six pour l’Anti-Œdipe ou l’édition des œuvres complètes de Nietzsche ; Derrida, quant à lui, intervient vingt-deux fois dans les médias entre 1980 et 1989…). « D’alliés, les journalistes seraient donc devenus des adversaires ».
Dans la deuxième partie de son livre, G. de Lagasnerie interroge « la pertinence des croyances et des représentations qui sous-tendent implicitement ou explicitement la critique du journalisme ». Les mécanismes de la « reconnaissance par les pairs », la croyance dans le titre scolaire, les conditions sociales d’accès à l’espace scientifique, l’idée selon laquelle l’université serait le seul lieu autonome de certification de la qualité d’une œuvre et que tous ceux qui cherchent à réussir hors ses murs seraient des faibles qui n’auraient pu réussir dans ses murs… L’Empire de l’université fait une brillante revue critique des mécanismes et des croyances qui organisent la cartellisation progressive des « vrais » producteurs de savoir. Ce système même dont des Roland Barthes ou des Philippe Ariès eurent à connaître les exclusives, mais aussi des Michel Foucault (refusé à la Sorbonne en 1967), des Jacques Derrida (battu par « un professeur marxiste de recrutement local à Nanterre », souligne G. de Lagasnerie)…
L’un des grands mérites de ce petit livre est précisément d’instruire ici encore une critique du fétichisme universitaire qui s’appuie sur une lecture des textes et pointe les contradictions de leurs auteurs. Ainsi Pierre Bourdieu fait l’apologie de l’autonomisation du champ universitaire et du « jugement des pairs », alors même qu’il avait brillamment souligné les effets de censure de ce type de clôture à propos du champ politique. En définitive, c’est bien souvent par une sorte de fidélité à leurs idées premières que G. de Lagasnerie s’en prend au cantonnement universitaire dont Foucault, Deleuze, Derrida et Bourdieu se firent les champions. Il fait fonctionner leurs œuvres comme une machine de guerre contre l’apologie des normes du champ académique et réveillent contre leurs auteurs toute l’énergie critique qu’elles contiennent. En ce sens, et pour le dire dans les termes de ce temps-là, le travail de G. de Lagasnerie est proprement subversif.
La dernière partie du livre montre que nombre de penseurs innovants se sont bel et bien construits contre l’ordre académique et le « conservatisme de ceux qui contrôlent les pouvoirs universitaires ». A l’apologie du jugement des pairs comme jugement des producteurs sur les producteurs (Bourdieu), l’Empire de l’université oppose une féconde critique du « jugement des reproducteurs sur les producteurs ». Manet et Zola (Zola soutenant Manet contre l’académisme) occupent une position stratégique dans ce dernier mouvement de la démonstration, non parce qu’ils auraient à voir avec le monde universitaire, mais parce que Bourdieu lui-même, dans un texte devenu quasiment introuvable, en fit les héros d’une attaque portée « au cœur même de l’art académique » [1].
La réflexion de G. de Lagasnerie ne sacrifie cependant jamais à une forme de romantisme de la création libre et inspirée contre les diktats de l’institution. Elle invite au contraire à « penser relationnellement », à observer ce qui se joue à la frontière des « champs », quitte à faire exploser les barrières qui séparent le monde savant du monde profane. Si l’on veut critiquer ce cheminement, ce n’est pas la « communauté scientifique » qu’il faut défendre contre la « communauté des hérétiques », mais l’appareil argumentatif qu’il emprunte si habilement à ses figures maîtresses et singulièrement à Bourdieu. Mais c’est une autre affaire.
05:55 | Lien permanent | Commentaires (0)
10/01/2008
Ernst Kantorowicz, biographe de Frédéric II de Hohenstaufen
 Par Stefan PIETSCHMAN
Par Stefan PIETSCHMAN
„Vivet et non vivit“ (= Il vit et n’a pas vécu). A la fin de sa monumentale monographie consacrée à Frédéric II, Ernst Kantorowicz a placé cette citation latine, car il était indubitablement animé par une intention mystique : le mythe de l’Empereur Hohenstaufen, figure clef, est rappelé ainsi à la vie, au-delà des siècles, au-delà de la mort physique. Dès la parution de ce maître ouvrage en 1927, Ernst Kantorowicz acquiert d’un coup la célébrité.
Ernst Hartwig Kantorowicz, né en mai 1895 à Posen, est issu d’une vieille famille juive en vue. Après avoir passé son « Abitur » en 1913, il entame des études d’ingénieur commercial à Hambourg, afin de pouvoir, plus tard, gérer l’entreprise familiale, une fabrique de spiritueux. Dès qu’éclate la première guerre mondiale, Kantorowicz se présente comme volontaire au 20ième Régiment d’Artillerie de campagne de Posnanie, où il servira jusqu’à la fin des hostilités. Il revient du combat la poitrine constellée de décorations. En mai 1918, il s’était inscrit à l’Université de Berlin, en faculté de philosophie. C’est dans la capitale qu’il vécut la révolution, ce qui l’amena à retourner dans sa province natale de Posnanie, pour s’engager immédiatement dans un Corps Franc, dont le but était de défendre les revendications allemandes dans cette région de l’Est du Reich. Au cours du printemps 1919, il est engagé contre les Spartakistes à Berlin, et puis, en mai, alors qu’il étudie les sciences économiques, contre la République des Conseils à Munich.
Il déménage ensuite à Heidelberg. Il fait connaissance avec le poète Stefan George et, immédiatement après avoir remis sa thèse de doctorat (sur « L’essence des associations musulmanes d’artisans »), se consacre au thème de sa vie : la figure de l’Empereur Frédéric II de Hohenstaufen.
Indubitablement, il a été amené à ce choix, inspiré par les poèmes de Stefan George. Dans son poème « Rom-Fahrer », George avait averti ses disciples en faisant allusion au destin tragique de l’Empereur Frédéric II et de son petit-fils Konradin. « La grandeur des grandeurs de Frédéric, véritable nostalgie des peuples » est une nouvelle fois évoquée dans le poème « Die Gräber in Speier ». George y rappelle la figure de ce petit-fils de Béatrice de Bourgogne, dont la tombe est à Spire (Speyer) ; elle avait été la seconde épouse de Frédéric Barberousse. George voyait dans le règne de Frédéric II revivre la politique générale des Empereurs germaniques issus de ces premières lignées que furent les Carolingiens, les Ottoniens et les Saliens, une politique générale couplée au sens impérial et romain de l’Etat, à la culture grecque et orientale.
La fin des grands temps
Dans ses « Conversations avec Stefan George », Edith Landmann fait dire au poète ce qu’il ressentait face à la figure de Frédéric II, des Allemands en général. Question d’Edith Landmann : «Vous avez évoqué le passage de la belle ère allemande médiévale à l’époque plus prosaïque de Rudolf von Habsburg… ». Réponse de George : « Ce Rudolf était déjà un roi bourgeois. Avec lui, c’est autre chose. Les grands temps sont passés. C’est insaisissable, ce qui s’est passé là ; pourra-t-on jamais revenir au-delà de cette césure ? La meilleure explication de ce passage me semble celle-ci : à certaines époques, les dieux visitent un pays et quand ils repartent, les hauts temps s’évanouissent ». Le « Frédéric II » d’Ernst Kantorowicz décrit le déclin des Staufen, et fait de cette description une lecture si captivante, qu’elle ne laisse aucun lecteur indifférent. « Quelle impression cela a fait sur les Italiens, la mort de ce bel homme ! Les Allemands, en revanche, lui ont comme tapé sur l’épaule, en lui demandant de restreindre ses élans et en lui disant : tu aurais mieux fait de rester au pays, voilà ce qui arrive quand on ne le fait pas ». « Cette phrase, écrit Edith Landmann, m’est restée gravée dans la mémoire… ».
Stefan George disait de Kantorowicz qu’il était « ce que les Français nomment un ‘Chevalier’ » et, ajoutait-il, « il était si entièrement ‘Chevalier’, qu’on ne s’en apercevait plus ». Homme du monde, très élégant dans le choix de ses vêtements, dans sa gestuelle quotidienne, dans son langage ; il avait tout, dit le germaniste Boehringer, d’un escrimeur, virtuose du fleuret. « Son intelligence, qui avait la faculté de pénétrer profondément en toute matière, se doublait d’une étonnante capacité à percevoir les choses dans leurs interrelations ; c’est sur ces facultés intellectuelles-là que repose sa vision et sa présentation si grandioses et si vivantes de l’histoire ».
Le livre consacré à Frédéric II de Hohenstaufen, Kantorowicz l’a écrit, pour l’essentiel, dans son appartement de Heidelberg, charmante petite ville universitaire où George, lui aussi, tenait ses quartiers à l’époque, du moins pendant quelques étés jusqu’en 1926. Plusieurs passages du livre en témoignent. Stefan George et les frères von Stauffenberg en ont corrigé les épreuves et négocié sa publication auprès des éditeurs.
L’Allemagne secrète à Naples et à Palerme
Le livre contient une sorte de préambule, dont le style et la teneur sont typiques du Cercle de Stefan George : « Lorsqu’en mai 1924, le Royaume d’Italie a célébré le 700ième anniversaire de la fondation de l’Université de Naples, que Frédéric II de Hohenstaufen avait fondée, on a trouvé, au pied du sarcophage de l’Empereur, dans la cathédrale de Palerme, une couronne portant l’inscription suivante : ‘A ses empereurs et héros, l’Allemagne secrète’ (= Das Geheime Deutschland) ». Cette couronne et ce bandeau votif avaient été déposés, selon toute vraisemblance, par des amis de George, qui séjournaient vers Pâques 1924 à Palerme : parmi eux, il y avait Ernst Kantorowicz. Son mérite demeurera, d’avoir ramené au présent la figure sublime de Frédéric II, grâce aux stupéfiantes facultés de son intelligence critique, à la pertinence profonde de son questionnement. L’Etat, construit en Sicile par Frédéric II, fondé et gouverné par le truchement de la Constitution de Melfi, selon les lois de la raison, se référait à l’antiquité, jugée en son temps « païenne ». Ce « paganisme » antique et ce recours à la raison politique contribuèrent à faire de lui, pour ses ennemis, un « hérétique ». Il n’y avait pourtant rien d’autre d’ « hérétique », chez lui, que d’être simplement en avance sur son temps. Quelques siècles plus tard, personne n’aurait parlé de ‘stupor mundi’, en faisant référence à l’œuvre qu’il avait bâtie. Frédéric II nous interpelle, nous et nos contemporains, dans tous les domaines qu’il a touchés, tout simplement parce que sa pensée, sa sensibilité, sa volonté et son action anticipaient les époques qui allaient advenir, après l’ère proprement médiévale.
En décembre 1933, Stefan George meurt à Minusio en Suisse, sur un territoire politiquement neutre, afin d’échapper aux honneurs que n’auraient pas manqué de lui réserver le nouveau régime national-socialiste. La veillée funèbre du poète fut assumée par Ernst Kantorowicz, Claus von Stauffenberg et quelques autres. Il faut rappeler ici que c’est justement Kantorowicz, et non pas seulement Stefan George, qui a conforté les trois frères von Stauffenberg dans la certitude, mythique, qu’ils étaient les descendants des Staufer et donc, possédaient un sang royal.
Les différends d’ordre idéologique avaient pourtant déjà profondément divisé l’ « Etat », c’est-à-dire le Cercle de George, ce que ressentaient tout particulièrement les amis, sympathisants et membres de confession israélite qui étaient restés en Allemagne entre 1936 et 1938. Tout en ressassant ses souvenirs sur ces clivages qui divisaient cruellement le Cercle, Edgar Salin expliqua plus tard à Berlin, en quelques lignes poignantes, les sentiments de Kantorowicz, qui venait, lui, d’émigrer aux Etats-Unis en 1938 : « Il avait été profondément marqué par l’affliction générale qui avait uni dans la douleur tous ceux qui firent partie du Cercle mais avaient été séparés par les circonstances politiques. Mais lorsqu’il se hissa dans le train pour quitter la Suisse, il vit, à une autre fenêtre du wagon, un des ‘amis’ lever le bras à la nouvelle mode qui régnait alors en Allemagne, et deux autres, plus jeunes, répondant à son salut depuis le quai, de la même manière ». Ces deux jeunes hommes étaient ceux qui avaient soigné et aidé George, dans les derniers mois de sa vie, à Minusio.
En novembre 1938, Kantorowicz réussit à quitter l’Allemagne, grâce à son ami le Comte Albrecht von Bernstorff, qui fut assassiné en 1945 dans la prison de Berlin Moabit. En passant d’abord par l’Angleterre, son exil finit par le conduire aux Etats-Unis où il enseigna, dès 1939, à l’Université de Berkeley.
Refus des injonctions maccarthystes
En 1951, une fois de plus, Kantorowicz agit de cette manière chevaleresque, qu’admirait tant chez lui Stefan George : c’était à l’époque où sévissait la commission McCarthy. Comme en Allemagne en 1933, Kantorowicz demeura fidèle à lui-même et refusa de prêter le serment d’allégeance et de loyauté que les Etats-Unis exigeaient des professeurs. Il fut licencié sur le champ.
On est touché de constater combien les traces de la vision politico-mythique de George persistent dans l’œuvre de Kantorowicz, tant d’années après la mort du poète. Kantorowicz est resté fidèle à l’ « Allemagne secrète », à ce Reich de mystères et de mythes. Dans ses derniers ouvrages, il prouve encore qu’il ne cesse de servir ces mythes, d’explorer et d’étayer les concepts éducateurs et pédagogiques préconisés par le Cercle de Stefan George. A partir de l’automne 1951, il travaille à l’ « Institute for Advanced Study » à Princeton. En 1957, le deuxième de ses deux ouvrages majeurs sort de presse, intitulé « The King’s Two Bodies », « Les deux corps du Roi », qui ne fut traduit en allemand qu’en 1991 ! C’est un immense travail synoptique, composé d’innombrables pièces formant, toutes ensemble, une magnifique mosaïque, qui n’est pas toujours aisée à comprendre dans chacun de ses éléments. Tentons de cerner le noyau même de ce maître ouvrage en donnant ses sources principales : le point de départ de la quête de Kantorowicz se situe dans la « doctrine des deux natures » de l’église primitive, où le Christ est à la fois Dieu et homme ; ensuite dans les oeuvres des juristes de Cour anglais de l’époque des Tudor, qui avaient élaboré une « christologie royale » très sophistiquée.
En 1963, Ernst Kantorowicz rejoint Stefan George dans la mort. Il avait été un grand historien juif et allemand et aussi un patriote animé par une foi nationale infaillible.
Stefan PIETSCHMANN.
(article paru dans l’hebdomadaire berlinois « Junge Freiheit », n°30/2000 ; trad. franç. : Robert Steuckers).
14:55 | Lien permanent | Commentaires (0)
06/01/2008
Le Prophète et la Cabale
La Leo Strauss in the French newspapers
mercredi 11 avril 2007, par Adeimantos
Article originally written on September 13, 2003
Il est de bon ton ces derniers mois, en France, de réduire la politique étrangère des États-Unis d’Amérique à quelques conseillers qui auraient trouvé leur inspiration chez Leo Strauss, professeur de philosophie politique à l’Université de Chicago de 1949 à 1971, décédé en 1973 à l’âge de 74 ans. Quiconque cherche à s’informer connaît l’existence de cet homme obscur par les gazettes, la radio et la télévision. Obscur certes, mais semble t-il prodigieusement influent, puisqu’il serait à l’origine de la nouvelle doctrine américaine de défense des États-Unis et de tout ce qui de prés ou de loin peut être rapporté à l’influence du néo-conservatisme politique.
Le Philosophe et la Cité
Être l’inspirateur d’une politique est en effet l’ambition du philosophe qui se mêle des affaires de la Cité. C’est au moins à une méditation de cette expérience que nous convie Platon dans son œuvre, singulièrement dans sa Lettre VII. Si le lien entre le philosophe et la vie politique est sinon revendiqué, du moins problématisé dans les œuvres classiques de la philosophie, du Hiéron de Xénophon au Prince de Machiavel et si la vie politique est évidemment une source de méditation constante pour le philosophe, il n’en reste pas moins que la tentative de Platon pour conduire Dion de Sicile à infléchir le régime de Denys de Syracuse vers plus de modération s’est soldée par une déconvenue. C’est par euphémisme que l’on doit parler du sort du philosophe pris dans l’étau de l’action politique : Machiavel, après Platon, en fit l’amère expérience et la carrière d’Alexandre, élève d’Aristote, ne fut pas exactement à l’origine des régimes mixtes qu’avaient médités son maître. Il serait cependant inexact de dire que les idées philosophiques n’ont aucune prise sur l’expérience humaine, comme il serait imprudent d’affirmer que les idées ne sont pas au pouvoir. Encore faut-il accorder au philosophe le bénéfice du doute, se méfier de la théorie des " éminences grises ", rendre à César ce qui lui appartient , se méfier des mécaniques du complot et autres cabales, dont le fumet antisémitique est toujours nauséabond.
Puissance ou faiblesse du professeur ?
suite ici.
10:15 Publié dans Leo Strauss | Lien permanent | Commentaires (0)
24/09/2007
Alan Greenspan
Les Mémoires d’Alan Greenspan sortiront en librairie mercredi. Celui qui a régné près de vingt ans sur la finance mondiale se confie dans un entretien exclusif au Figaro.
22:13 | Lien permanent | Commentaires (0)
05/09/2007
La fin des haricots
Entretien intégral
Richard Millet : la littérature a-t-elle fait son temps ?
31/08/2007 - Propos recueillis par Jacques-Pierre Amette - © Le Point
Un écrivain s’insurge contre le déclin de la littérature. Richard Millet, 54 ans, dénonce en soixante pages véhémentes le servile langage démocratique des médias, le déclin de la syntaxe, la perte du prestige de l’écrivain, la déhiérarchisation des valeurs, la foire commerciale, l’invasion d’un roman formaté à l’américaine.
La condamnation est terrible. « Le français est aujourd’hui tombé dans la fange. » « France moribonde », « nous flottons dans une langue du Bas Empire ». Voici donc un nouveau Savonarole qui allume un bûcher en pleine rentrée littéraire en même temps qu’il nous propose, au Mercure de France, un carnet de voyage au Liban, L’Orient désert, qui est un formidable document sur un écrivain en crise, et sans doute un des textes les plus excitants de cette rentrée. On pourrait hausser les épaules. Mais Richard Millet n’est pas n’importe qui. Il travaille dans le saint des saints de la littérature, puisqu’il est membre du prestigieux comité de lecture des éditions Gallimard. Il a guidé Jonathan Littell et retravaillé sur le manuscrit des Bienveillantes, prix Goncourt 2006. Enfin et surtout, c’est un authentique écrivain qui a publié une trentaine de volumes. Nous sommes allés le voir dans son bureau, chez Gallimard.
Le Point : En pleine rentrée littéraire, vous publiez un pamphlet violent, qui parle de l’actuelle littérature française comme d’« une production semblable à des eaux mortes où se réfléchit le ciel vide ». « L’obscurité vient », ajoutez-vous : qu’est-ce qui vous arrive ?
Richard Millet : le pouvoir d’envoûtement que notre génération a accordé à la littérature n’existe plus. J’ai choisi le mot « désenchantement » un peu comme Paul Valéry a utilisé le mot , «charme » au sens fort. Je ne crois pas que ce soit un phénomène cyclique. Je pense que, vraiment, on est peut-être à la fin de la littérature.
Vous parlez « d’effondrement » à plusieurs reprises. Mais dans les années 1830, époque d’une génération qui va de Balzac à Musset en passant par Stendhal et Hugo, le critique Désiré Nisard se tuait déjà à proclamer : « Non ce n’est pas une grande génération et ce sont les anciens qui sont toujours les meilleurs.»
Oui, mais aujourd’hui, ce à quoi nous avons affaire n’a plus de valeur, plus de sens. Je pense, pour aller très vite à l’essentiel, que l’idée qui consiste à dire que la démocratie serait nocive à la littérature actuelle est en train de se réaliser.
Expliquez-moi pourquoi le déclin de la littérature serait lié à l’idée même de démocratie?
C’ est lié aussi à l’effondrement du stalinisme, à l’effondrement de l’autorité, à l’effondrement de l’idée de père, à l’effondrement du système de transmission. On va avoir affaire à quelque chose qui s’appelle littérature, mais qui sera, à mon avis, de langue anglaise majoritairement. A quelque chose qui oscillera entre Harry Potter et les polars de l’américain Michael Connelly. En gros ce sera ça. Avec peut-être des arborescences un peu latino-américaines pour quelques décennies encore mais ce sera tout.
Vous avez pourtant été le directeur littéraire et le conseiller de Jonathan Littell , un américain qui écrit en français, avec le succès qu’on sait...
Jonathan Littell est un objet migratoire. C’est l’exception dans tous les sens du mot. C’est un objet littéraire d’une telle ampleur qu’il apparaît dans la production française normale comme exceptionnel. De plus, dans « Désenchantement de la littérature » je vous parle de ce qui se passera dans dix ans. Tous les profs de fac se plaignent de l’inculture de leurs étudiants. Les étudiants en lettres ne lisent pas. Je ne veux pas avoir l’air du vieux con qui la ramène constamment là-dessus. Mais dans une classe j’ai vu que rien ne passait plus.
Combien d’années dans l’enseignement ?
Vingt ans. Rien ne passe. La littérature n’intéresse plus personne. Nous faisons semblant la plupart du temps.
Ce n’est pas nouveau: dans son pamphlet « la littérature à l’estomac », Julien Gracq écrit, en 1949 : «On a rarement en France autant parlé de la littérature du moment, en même temps qu’on y a si peu cru. »
Mais c’est une époque quasi paradisiaque, les années 50 !. C’est fini, «Cinna» ! Corneille ! Racine ! Personne ne sait plus qui c’est. Je ne plaisante pas en disant ça.
C’est votre expérience à la fois de professeur et de lecteur chez Gallimard qui vous permet de dire ça ?
Chez Gallimard et partout où je suis passé. Le centre de gravité de la littérature s’est déporté vers une forme de récit beaucoup plus efficace. Le vrai succès de la littérature aujourd’hui c’est le polar. Avec quelques merdes du genre pour femmes, magazines féminins étendus au niveau d’un pseudo-roman. En gros, c’est ça.
Vous imaginez bien qu’en disant « merde », « bonnes femmes », d’un seul coup tout le monde va hurler contre vous en disant «c’est l’école du mépris».
On a besoin de ça aussi, quelque chose qui s’est perdu, à savoir le sens critique. Je ne rue pas dans les brancards, je dis seulement ce que je constate.
Vous parlez de « l’esthétique du prêt-à porter romanesque, immédiatement scénarisable en anglais... »
Je ne demande qu’à être démenti. Et quand je parle de la France, je peux parler aussi de l’Angleterre, tout ce que je lis à l’étranger me tombe de mains. Ce sont des remakes des romans du XIXe siècle, des trucs de science- fiction… Pour moi l’exemple de la fausse valeur américaine, c’est Jim Harrison. C’est pour moi de l’école de Brive en américain... En gros c’est ça. Et il est encensé…
Vous écrivez : «Ecrire, faut-il le rappeler, c’est avant tout hériter d’une langue. Et le français que nous entendons aujourd’hui est tombé dans la fange, non seulement par fadeur stylistique, et flottement syntaxique, sémantique, orthographique, mais aussi parce qu’il ne nomme plus le monde, l’ayant abandonné aux médias anglo-saxons. » Plus loin vous parlez du « sabir des banlieues ». Mais Louis-Ferdinand Céline a construit une oeuvre monumentale avec le «sabir » de la banlieue Nord, non ?
Céline est mort en 1961. Depuis je n’ai pas vu une oeuvre littéraire de cette dimension inspirée par la rue.
Vous n’attendez rien des prochaines générations?
Même un roman de Balzac, je pense que c’est illisible pour les jeunes esprits d’aujourd’hui. Il y a une syntaxe, un champ référentiel, culturel, des mots qui leur échappent. Ce n’est pas possible.
Cela veut dire que l’écrit est chassé par l’image ?
Je ne vais pas tomber dans cette opposition. Je pense que la littérature n’est plus assez puissante, n’engendre plus de mythes littéraires, de mythes d’écrivains. C’est fini ! Tout ceci est fini. Le dernier mythe français littéraire, c’est peut-être ,hélas, Françoise Sagan. C’est- à-dire quelque chose de pas très intéressant. Il n’y a plus de figure, plus de mythe. C’est peut-être une chance. C’est là que je serais moins pessimiste que j’en ai l’air. Peut-être une chance au sens où la littérature va devoir se renouveler entièrement.
Dans cet « effondrement », la critique littéraire a-t-elle joué un rôle ?
La littérature française s’est effondrée à partir du moment où on a banalisé la figure de l’écrivain. Il n’y a plus de hiérarchie entre les bons et les mauvais. N’importe qui peut être écrivain, c’est la démocratie! On sait très bien comment cela se passe : n’importe qui peut apporter un sujet, mais nous–mêmes éditeurs sommes là pour retravailler le texte, en fait nous sommes de véritables auteurs. C’est ce qui se passe en Amérique, le fantasme de l’atelier d’écriture où l’on peut apprendre à écrire, alors que c’est faux, nous le savons tous. Fantasme du succès : c’est à dire que le roman- pas la littérature- est devenu un instrument de promotion sociale.Les femmes des écrivains se sont mises à écrire, les amants des femmes d’écrivains aussi, les maîtresses se sont mises à écrire. Tout le monde écrit.
Êtes vous allé vous incliner devant vos aînés et y chercher un adoubement ? La visite au grand écrivain est un rite de passage : Sollers allant chercher l’onction de Mauriac…
Je n’ai jamais cherché à rencontrer de grands écrivains. Quignard m’a fait rencontrer Lous-René Des Forêts, c’est la seule fois où j’ai accompli ce geste de payer mon tribut aux grands aînés. Je n’ai pas cherché à rencontrer de grands écrivains, mais j’avais payé mon tribut à la grandeur.
Dans « L’Orient désert », que vous publiez en même temps que votre pamphlet, vous mettez en avant votre catholicisme. Vous sentez-vous en mission ?
L’Eglise telle qu’elle est ne m’intéresse pas, c’est une succursale d’Emmaüs ou de l’humanitaire. Je suis totalement ailleurs, constamment ailleurs. J’ai dédié ce livre aux chrétiens d’Orient parce que je suis scandalisé qu’on ne se préoccupe pas de leur sort. Tout le monde est en larmes sur le Darfour -avec plusieurs années de retard, d’ailleurs -, mais les chrétiens, on s’en fout, parce qu’il y a toujours ce soupçon que ce sont les nababs du Proche-Orient. Je peux vous dire, moi qui ai passé mon enfance dans ces pays, que ce ne sont pas forcément des riches. Vous avez des gens qui ne parlent pas un mot de français ou d’anglais. La messe se dit en arabe, il faut le rappeler, c’est étrange.
Au fond en vous lisant je me suis dit que vous étiez assez proche d’un Hugo, de son rôle de mage, je parle du Hugo de « La fin de Satan » c’est-à-dire que l’écrivain doit être un guide spirituel.
Pas du tout.
Vous aimez quand même beaucoup les ruines, la mort, la prière, les cimetières, le chagrin, le passé, comme les romantiques, non ?
Vous voulez absolument désamorcer ce que j’écris ?
Non, je ne veux pas désamorcer. Je vous pose une question. Honnêtement, c’est ce qui m’est apparu en vous lisant.
Nous entrons actuellement dans la nullité de la littérature, dans la nuit de la langue, tout ce que vous voulez. C’est à dire le contraire du phare, du mage, etc.
Dans « L’Orient désert », une phrase m’a frappé : «Je suis révolté contre moi-même .» Que voulez-vous dire ?
Je ne veux pas me laisser aller aux mauvaises pentes qui sont l’image sociale, la réussite sociale, le désir d’être reconnu à travers de fausses reconnaissances, c’est-à-dire les prix, tous ces machins-là. Parce que cela n’a l’air de rien, mais le système gangrène, vous le savez vous-même – je ne sais pas comment vous avez vécu votre Goncourt…
Plutôt dans la rigolade, franchement. Quand ça m’est arrivé, j’avais un âge canonique, ce n’était pas un tourment du tout de l’avoir. C’était plutôt une rigolade, parce que ça me sauvait financièrement. Je pouvais payer mes pensions alimentaires.Et puis j’étais heureux d’avoir ce prix avec un sujet impopulaire au possible, Bertolt Brecht.
Vous avez eu de la chance. Vous savez très bien qu’il y en a qui ont été bousillés. Pour revenir à votre remarque sur le romantisme, je pencherai plutôt vers Chateaubriand. Non pas que je me compare à lui !… Les «Mémoires d’outre-tombe », dévoilent quelqu’un qui a la conscience qu’il passe d’un monde à un autre. C’est le leitmotiv des « Mémoires » je viens de les relire. Cela m’a frappé ce passage. Je suis né dans un ancien monde, je suis dans un nouveau monde… Que puis-je faire à partir de ça ? La filiation c’est important. Mais essayez de voir quelqu’un qui a une filiation aujourd’hui.…Beigbeder qui se revendique de Scott Fitzgerald. Autre chose : je pense que le fait de vivre dans cette espèce d’Europe est mortellement ennuyeux. On est sortis de l’Histoire. Cela joue aussi sur l’état du roman, de la littérature.
On vit dans une bulle ?
On vit dans une bulle.
Vous avez écrit une vingtaine de romans, mais si je vous prends au pied de la lettre, la parole de l’écrivain tombant dans un néant, pouvez vous continuer à écrire ?
Je pensais que la littérature était immortelle, que la langue française, la France étaient immortelles. Je m’aperçois aujourd’hui que tout cela est non seulement mortel mais quasi mort. Orwell avait déjà noté que la destruction d’une syntaxe était concomitante à la destruction d’un système politique. Une ère inculte s’annonce. Débâcle syntaxique et ignorance de l’étymologie. La littérature a fait son temps, mais je vais achever ce que j’ai commencé.
Vous n’êtes pas un peu comme un enfant gâté qui casse son jouet en disant : « Les gens ne me regardent pas assez »?
Pas du tout. Vous avez lu « L’Orient désert », c’est un livre de cri absolu personnel, crise sentimentale, crise existentielle, crise littéraire. Je suis confronté à des choses dans un pays, le Liban, qui est encore un peu en guerre, je vais en Syrie, où il n’y a rien, où je me confronte au vide. Je vois des gens… des prostituées de l’Est, et un type complètement tordu… replié sur lui-même, la colonne vertébrale en anneau...
Et vous dites au fond qu’intérieurement vous vous sentez proche de cet homme…
Exactement. Je suis né dans un ancien monde, je suis dans un nouveau monde... Que puis-je faire à partir de ça ?
Je vais vous poser une question brutale. Vous dites « les romans dont j’ai une nausée croissante », « je préfère actuellement lire la vie des saints plutôt que les romans ». Or vous êtes éditeur chez Gallimard. Vous allez donner votre congé ?
Cher Jacques-Pierre Amette, quand vous êtes devant votre machine à écrire, vous êtes comme moi, vous savez très bien qu’il y a des choses qu’on doit faire parce qu’on doit manger tout simplement. Sans être une pute, on peut très bien travailler sur des manuscrits qui sont honorables. Lorsque je généralise, c’est sur une distance de vingt ans et c’est avec l’espoir qu’il y ait une exception, sinon je m’en vais.
Y a-t-il eu un événement fondateur qui vous a fait dire « bon, il est temps que je parle enfin, que je vide mon sac ?
Je pense que c’est une accumulation. Une asphyxie lente: à partir de l’an 2000, quand j’ai publié un roman qui s’appelle « Lauve le pur », là j’ai compris. Car on comprend mieux les choses quand on écrit des romans. Il se trouve que j’ai vu mourir la civilisation rurale dans laquelle je suis né.
Le côté « je suis le témoin d’une civilisation qui disparaît», le plateau de Millevaches, les paysans du Limousin ?
Oui. J’ai compris que c’était aussi la fin de la France. Ensuite, quand j’ai saisi l’enchaînement, que c’était la fin de la dimension chrétienne de la civilisation occidentale, là j’ai commencé à me dire : il faut quand même nous demander ce que nous sommes en tant qu’écrivain. Moi je ne peux pas parler en tant que citoyen ; je ne suis pas un citoyen. Je ne me considère pas comme un citoyen français, je n’ai jamais voté, jamais inscrit. Je ne suis rien, rien du tout. Quand je dis que je ne suis pas un démocrate, cela ne veut pas dire que je suis royaliste. Je ne suis rien. Donc je tente de me redéfinir. Le seul lieu à partir duquel je puisse me redéfinir, c’est la littérature, c’est ce que je connais le mieux.
Eet la réception de vos romans ? De « l’angelus » à « la Gloire des Pythre », « dévorations », « le gout des femmes laides » vous avez eu quand même des regards très attentifs, une grande reconnaissance dans la critique littéraire...
Bien sûr, je ne me plains pas. Je ne suis pas dans l’aigreur. On me traite tout à fait correctement même si j’ai beaucoup d’ennemis. Mais c’est surtout sur les blogs que cela se déchaîne.Les blogs sur le Net développent tout ce qu’il y a de mauvais. On remue la boue. Plus besoin de faire dans la Gestapo, on va sur le Net.
Pourquoi êtes-vous retourné au Liban ? A cause de vos années d’enfance, passées là-bas ?
Oui, c’est complètement lié à mon enfance. D’un seul coup, je pouvais toucher mon enfance. Ça m’intéresse beaucoup, ce sentiment : que devient l’individu quand il a l’impression que tout l’abandonne? En gros le seul endroit où je pouvais aller, c’était effectivement dans un endroit où il y avait pile la guerre. Quand vous sentez l’odeur des cadavres qui sont depuis une semaine sous les décombres, quand vous voyez les jets israéliens qui lâchent une bombe - vous ne voyez d’ailleurspas, vous entendez -, et après vous entendez un bruit très étrange. Voyez ce genre de chose, les hurlements, les sirènes. Peu à peu vous vous posez des questions sur ce que c’est que la souffrance personnelle, la souffrance anonyme, la souffrance d’autrui, le sens de l’Histoire.
Il y a quand même une grande ombre sur votre séjour au Liban : le silence de Rimbaud le brûlé dans son Harar. Avec ses fusils, ses livres de géographie, ses plaques photographiques et son oeil mauvais, mais surtout son mépris absolu de la littérature. Vous y avez forcement pensé dans votre expérience au Liban ?
Je vous assure que non. La seule question que je me posais : « Vais-je continuer à vivre et comment ? Ou vais-je aller me foutre sous les bombes ? »
Richard Millet
Ecrivain français né à Viam, en Corrèze, en 1953. Une partie de l'enfance au Liban. Editeur chez Gallimard. Longtemps professeur de lettres. A été le directeur littéraire de Jonathan Littell pour les « Bienveillantes », prix Goncourt 2006. Membre du comité de lecture des éditions Gallimard. Revendique son héritage catholique. Une grande partie de ses romans a pour cadre le village de Siom : « La gloire des Pythre », « Lauve le pur », « Ma vie parmi les ombres », « Le goût des femmes laides » et des essais, dont « Le sentiment de la langue ». Il publie « L'Orient désert » au Mercure de France et « Désenchantement de la littérature » aux éditions Gallimard.
04:32 Publié dans Anciens et modernes | Lien permanent | Commentaires (0)
27/08/2007
Transformers

|
|
Ric Hoogestraat est un homme de 53 ans, queue de cheval grisonnante, moustache en guidon de vélo, look biker sur le retour. M. Hoogestraat habite Phoenix, Arizona. Il a fait un tas de métiers : instituteur, professeur de ski, marchand itinérant d'huiles essentielles, graphiste sur ordinateur. Maintenant, il est opérateur dans un centre d'appels téléphoniques. Un travail qui lui laisse du temps libre.
Il s'est remarié pour la troisième fois voilà sept mois. Sa nouvelle épouse, Sue, 58 ans, regarde la télévision dans le salon, pendant que Ric emmène une rousse incendiaire sur sa moto pour une longue course, cheveux au vent, dans les collines.
M. Hoogestraat est bigame, ce qui lui a valu un long article dans le très sérieux quotidien américain de la finance, The Wall Street Journal. Bigame, enfin, pas vraiment. Virtuellement bigame. Cet Américain moyen fréquente en effet assidûment Second Life, cet univers étrange situé quelque part dans le cyberespace où se téléportent plus de huit millions de Terriens, et chaque jour il en débarque davantage. On a déjà beaucoup écrit sur Second Life (notamment dans Le Monde 2 du 2 décembre 2006, et ici même sous la plume de Jean-Michel Dumay, le 30 avril), ersatz de planète Terre qui petit à petit se meuble - en faux - de tout ce qui nous casse les pieds - en vrai (spéculation, banques, boutiques de marques, publicité, ciné porno, meetings politiques, cabinets de recrutement...). Avoir une épouse dans chaque monde est une situation de plus en plus fréquente, qui pose des questions nouvelles et intéressantes sur les plans psychologique et juridique.
Dans Second Life, Hoogestraat s'appelle Dutch Hoorenbeek. Il s'est fabriqué un avatar qui lui ressemble, mais, sans lui faire injure, en plus jeune et en mieux. Il en a profité pour changer de métier et s'est lancé dans le business avec succès. Dans sa seconde vie, il possède plusieurs boutiques, un club de plage privé et un dancing. Il est à la tête d'une petite fortune d'environ 1,5 million de linden, l'unité monétaire du lieu, soit environ 6 000 dollars réels.
Il a rencontré Tenaj Jacklope chez des amis avatars, et cette jolie rousse lui a tapé dans l'oeil. En chair et en os, elle s'appelle Janet Spielman et elle est beaucoup moins sculpturale que son double, mais ce n'est pas l'important. Ce ne sont pas Janet et Ric qui sont tombés amoureux, mais bien Dutch et Tenaj, tout est dans cette nuance. Ils se sont mis en cyberménage, ont adopté deux cyberchiens, se promènent sur la cyberplage, invitent leurs cyberamis et, bien sûr, font le cyberamour. Ils ne se sont jamais vus dans la réalité, ni même parlé au téléphone, mais ils sont cybermariés selon les rites de Second Life qui sont les mêmes que dans la vie, mais pas vraiment, parce que ça ne compte pas, enfin pas tout à fait.
Mme Hoogestraat commence a en avoir par-dessus la tête. Son mari est capable de rester dans Second Life de 6 heures du matin à 2 heures du matin. C'est un addict. Un samedi soir qu'il était parvenu à attirer Sue devant son ordinateur, il lui a présenté Tenaj par surprise : "Mme Hoorenbeek", a-t-il dit sobrement. Elle ne sait plus quoi faire.
Le couple Hoogestraat n'est pas une exception. On recense de plus en plus de couples brisés pour cause d'infidélité virtuelle. Peut-on pour autant classer ce genre de situation dans la catégorie des adultères au sens légal du terme ? Pas encore, répondent les juristes, même si les avatars peuvent se livrer à des simulations d'actes sexuels. En revanche, ajoutent-ils, la cyberbigamie peut être aisément retenue comme une cause de divorce, bien réel celui-là, et constituer un argument déterminant pour décider de la garde des enfants. Certes. Mais on n'a pas encore prévu le cas suivant qui va bien arriver un jour : si un couple virtuel se sépare, qui gardera les cyberbébés ?
Jacques Buob
Article paru dans l'édition du 26.08.07.
|
|
06:35 Publié dans Anciens et modernes | Lien permanent | Commentaires (0)
25/08/2007
L'égalité des mamifrères
 Une initiative populaire fédérale propose la modification de la Constitution et l’inscription dans le texte fondamental d’une obligation de protéger les animaux et d’assurer la défense de leurs droits par un avocat.
Une initiative populaire fédérale propose la modification de la Constitution et l’inscription dans le texte fondamental d’une obligation de protéger les animaux et d’assurer la défense de leurs droits par un avocat.
Cette initiative, dont la date limite était fixée au 15 mai 2007, a réuni plus de 100.000 suffrages et vient d’être déclarée valable par la Chancellerie fédérale. Elle propose l’insertion d’un article 80, al. 4 et 5 (nouveaux) dans le texte constitutionnel :
Art. 80 al. 4 - La Confédération édicte des dispositions sur la protection des animaux en tant qu'êtres vivants doués de sensations.
Art. 80 al. 5 - En cas de procédures pénales motivées par des mauvais traitements envers des animaux ou par d'autres violations de la législation sur la protection des animaux, un avocat de la protection des animaux défendra les intérêts des animaux maltraités. Plusieurs cantons peuvent désigner un avocat de la protection des animaux commun.
10:00 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
23/08/2007
Mano nera (II)
 La mafia calabraise à la conquête de l'europe
La mafia calabraise à la conquête de l'europe
La tuerie du 15 août, à Duisbourg, où six jeunes Calabrais ont été liquidés en pleine ville, a révélé à la fois la sauvagerie des vendettas entre clans de la 'Ndrangheta et l'internationalisation de la mafia calabraise qui a su adapter ses valeurs archaïques aux nécessités des sociétés industrielles avancées...
De notre correspondante à Rome, Marcelle Padovani
Surveillé, quadrillé, militarisé, San Luca attend la vendetta. Tous les mâles ont pris préventivement la fuite de ce patelin de 4 500 âmes au pied de l'Aspromonte, en plein coeur de la Calabre. Un silence irréel monte des maisons basses accrochées aux rues en pente. Un silence entrecoupé seulement des cris des femmes dont les fils sont tombés en Allemagne, à Duisbourg, le 15 août. On se croirait dans un film de guerre. Quiconque se hasarde à mettre le nez dehors scrute d'abord l'horizon avant de tenter l'aventure. A l'entrée de la petite ville, le panneau routier qui annonce San Luca est criblé de 16 balles. "C'est un patelin de vivants qui vivent comme des morts", dit le curé de Santa Maria délia Pietà.
San Luca attend donc la vendetta. Aujourd'hui, demain, dans six mois. "Le 2 septembre serait une bonne date, hasarde un carabinier. Parce que c'est la fête de la Madonna dei Polsi, vénérée par les mafiosi." Mais la vengeance n'aura pas forcément lieu en Calabre. Il n'y a plus de frontières pour les "'ndranghetisti" : pour venger l'assassinat, à Noël 2006, de Maria Strangio, son clan n'a-t-il pas attendu la mi-août et fait le déplacement jusqu'à Duisbourg pour y descendre six membres présumés du clan rival, les Vottari-Pelle ? "Les représailles pourraient avoir lieu au Canada, en Australie ou pourquoi pas ? - en France, à Nice par exemple, ou Saint-Etienne ou Clermont-Ferrand, où les clans calabrais ont énormément investi", dit Vincenzo Macri, magistrat à la Direction nationale Anti-Mafia. Cet enquêteur n'a pas été surpris par les événements de Duisbourg. Pour lui, il s'agit seulement de la chronique d'un massacre annoncé.
Mais revenons aux faits, à ce 15 août 2007, lorsque, vers 2h30 du matin, six jeunes Calabrais qui viennent de fêter les 18 ans de l'un d'eux, Tommaso Venturi, se dirigent dans Mülheimer Strasse vers leurs voitures, une Golf et une Opel. Sebastiano, 40 ans, cuisinier du Da Bruno, a fermé la porte en verre blindé de l'un des plus coûteux restaurants de la ville. Les six s'installent dans leurs voitures. Une gerbe de feu les fauche immédiatement. On trouvera sur le sol 70 douilles. Et le cadavre d'un délinquant appelé Marco Marmo, venu en Allemagne négocier un chargement d'armes à rapatrier en Calabre. Cet homme, étroitement surveillé par la police italienne, qui avait placé une puce électronique dans sa voiture et pensait le coffrer à son retour en Italie avec son chargement, était considéré à San Luca comme le responsable de l'assassinat de Maria Strangio à Noël.
Même si les médias ont eu l'impression de découvrir d'un coup la puissance de feu de la 'Ndrangheta et de ses ramifications internationales, les enquêteurs italiens, eux, ne sont pas étonnés par la vendetta de Duisbourg. Des écoutes téléphoniques récentes laissaient prévoir des événements dramatiques : "Tuons les tous", "Ces couillons de Vottari nous les cassent depuis des siècles". La police avait même découvert, en mars dernier, lors d'une perquisition dans une maison du clan Vottari à San Luca, un souterrain auquel on accédait grâce à un mécanisme hydraulique qui actionnait un ascenseur camouflé sous le carrelage de granit : quatre lits, un réfrigérateur bien fourni, des téléviseurs, des DVD, un pistolet-mitrailleur Skorpion, deux pistolets, 300 cartouches, un appareil radio calé sur les fréquences de la police et... un dépliant sur la trattoria Da Bruno à Duisbourg. L'empire allemand de la 'Ndrangheta avait même été soigneusement répertorié. Et de longue date. Pietro Grasso, procureur national anti-mafia, rappelle une vieille écoute téléphonique remontant à 1989 le jour de la chute du mur de Berlin. Un mafioso téléphonait à un autre : "Va à Berlin-Est et achète." "J'achète quoi ?", disait l'autre. "Tout. Bars, restaurants, immeubles." Aussitôt dit, aussitôt fait. La 'Ndrangheta s'empare alors de vieux palais à moitié détruits, d'édifices en tout genre, de restaurants. Pour une bouchée de pain. C'est donc avec la chute du Mur que commence l'épopée germanique des Calabrais, y compris ceux de San Luca. Ils investiront peu à peu les profits du trafic de drogue, à Bochum, à Munich, à Stuttgart. Un rapport du BND, les services secrets allemands, daté de novembre 2006, envisage même que les investissements mafiosi soient arrivés à la Bourse de Francfort, spécialement dans le secteur de l'énergie. Dans Gazprom par exemple où ils auraient 3% du capital. De leur côté, les Italiens avaient produit une carte détaillée, avec noms et prénoms, des familles calabraises présentes en Allemagne dans une quarantaine d'établissements de l'ex-République démocratique et une trentaine en Allemagne fédérale. Mais leur rapport n'eut pas de suite. Une malheureuse sous- évaluation de la part des collègues allemands ?
L'épopée internationale de la 'Ndrangheta ne s'arrête pas sur les bords du Rhin. Et on redécouvre aujourd'hui une vérité établie par le juge Giovanni Falcone : la puissance du modèle criminel enraciné dans la réalité locale; l'importance du dialecte comme barrière de protection; la force d'une petite communauté de langue et de sang. L'exportation intégrale de ce modèle en terre étrangère assure une imperméabilité et une fiabilité sans précédent aux Calabrais. Les Colombiens l'ont compris qui leur ont confié, semble-t-il, un tiers du trafic de la cocaïne dans le monde. Un rapport de la DIA (Direction des Investigations Anti-Mafia), daté de 2006, détaille le business mondial de la 'Ndrangheta : trafic de stupéfiants, trafic d'immigrés et immobilier en Allemagne. Idem aux Pays-Bas. En Suisse, ce sont les trafics d'armes et de haschisch qui dominent. En France, celui de la cocaïne et les investissements immobiliers (sur la Côte d'Azur). En Australie, le trafic d'armes et d'héroïne, ainsi que les jeux de hasard. En Afrique du Sud, le trafic de diamants, bien sûr, et au Canada, aux Etats- Unis et en Colombie, le trafic de drogue. En Russie, le trafic de drogue, l'immobilier et la contrefaçon de roubles et de dollars. Dès 1993, au moment où la Russie s'ouvrait aux capitaux étrangers, les magistrats de Locri (Calabre) découvraient ainsi un recyclage fabuleux entre Moscou et leur terre. Et des mafiosi qui étaient prêts à payer cash une aciérie et une usine chimique à Saint- Pétersbourg avec l'équivalent en roubles de 2 600 milliards de lires prélevées dans une banque allemande... Mais qu'est-ce qui fait le succès mondial de la 'Ndrangheta sur la scène du crime et de l'illégalité ?
Retour à l'histoire. Le 'ndranghetiste - du mot grec ndrangatos, qui signifie homme valeureux et courageux - a des origines lointaines. Thucydide et Plutarque parlent déjà de lui. C'est quelqu'un tout d'une pièce, sourcilleux sur son honneur, qui, lorsqu'il devient criminel, est un adversaire redoutable en raison de sa détermination et de sa férocité. Un officier français, Duret deTavel, envoyé par Murât en Calabre, écrit déjà en 1808 que "les Calabrais sont de stature moyenne, bien proportionnés et musclés. Ils ont une peau sombre, des traits marqués, des yeux vifs et brûlants. A cause des haines qui opposent les familles, ils sortent toujours armés de fusils, de poignards et d'une ceinture en forme de giberne qui contient des cartouches". Duret de Tavel savait aussi que la vraie force du Calabrais, et du 'ndranghetiste, lui vient de ses liens familiaux exclusifs (dans quelle autre région du monde existe-t-il une myriade d'organisations criminelles dont les membres appartiennent tous à une seule et même famille ?) et de son apparente arriération culturelle. L'archaïsme devient alors une défense et un atout. La 'Ndrangheta est ainsi une organisation horizontale (contrairement à la Cosa Nostra sicilienne, pyramidale et hiérarchisée), sans chef incontesté (mieux : avec des chefs interchangeables), qui contrôle à la perfection son territoire (en Calabre et ailleurs) et le conteste à l'Etat légal. Et qui organise scientifiquement ses trafics nationaux (pourcentages, travaux publics) et internationaux (drogue et armes). La 'Ndrangheta est un interlocuteur obéissant, fidèle, fiable, courageux. Et muet. Quelle meilleure garantie d'omerta que de n'avoir à rendre des comptes qu'à sa propre famille de sang ? C'est d'ailleurs pourquoi il n'y a pratiquement pas de "repentis" dans l'organisation calabraise. L'un d'eux, un certain Antonio Zagari, s'est contenté de raconter aux enquêteurs des événements mineurs, comme par exemple la légende qui accompagna sa propre naissance : "Peu après que j'ai vu le jour, mon père a placé dans mon berceau une clé et un couteau, comme le veut la coutume. Si j'avais touché en premier la clé, je serais devenu flic. Si j'avais touché le couteau (et je l'ai touché), je serais devenu 'ndranghetiste. Ehonneur de la famille était sauf."
La confédération mafieuse calabraise a ainsi réussi à constituer un réseau qui couvre le monde entier et qui est quasiment imperméable à la répression, car si un affilié est arrêté, il n'ouvre guère la bouche et se trouve aussitôt remplacé par son "clone", comme dit Vincenzo Macri. Selon lui, la 'Ndrangheta a tiré "avantage du préjugé qui voulait qu'une organisation criminelle archaïque et grossière ne pouvait pas négocier avec les cartels internationaux".
"Qui aurait pu croire il y a vingt ans, continue Macri, qu'un patelin de bergers apparemment analphabètes comme San Luca pouvait devenir la capitale du monde des affaires illégales ? Que ce coin perdu de l'Europe occidentale deviendrait l'un des principaux centres du trafic international de la drogue ?" Car il l'est devenu. Les trafiquants colombiens ont fait sa fortune. Reconnaissant la fiabilité financière et "mo rale" des Calabrais, dès les années 1980, lorsque Cosa Nostra commence à décliner, sous les coups de la répression, et finit par abandonner la gestion directe de la drogue. Les Calabrais venaient de mettre un terme à leur expérience des séquestrations de personnes (157 !), qui n'avaient rapporté que dans les 220 milliards de lires. Tandis que la "coke", vendue 50 à 100 euros la dose sur les places européennes, rapportait cent fois plus."Il n'y a plus un gramme de cocaïne qui ne soit sur les marchés du Vieux Continent sans la bénédiction de la 'Ndrangheta", dit un enquêteur. Pour ce faire, les Calabrais ont établi en Colombie des rapports directs et exclusifs avec les Forces armées révolutionnaires (Farc) et les Forces unies d'Autodéfense (AUC) de Salvador Miguel Mancuso, dit El Mono, qui serait d'origine italienne, et qui fait l'objet de 23 mandats d'arrêt internationaux.
Alors ceux qui voient dans la tuerie de Duisbourg le dernier, ou avant-dernier, acte d'une faida (" suite de vengeances ") ancestrale entre deux familles de la Calabre profonde, une espèce de folklore résiduel de populations méridionales arriérées, doivent impérativement réviser leur copie. Si tout semble né un 14 février 1991 avec un lancement d'oeufs inopportun un jour de carnaval, entraînant 20 morts en seize ans dans les deux familles adverses, il faut pour comprendre la situation actuelle dépasser les clichés sur le culte rétrograde de l'honneur dans la Calabre sous-développée. La 'Ndrangheta a "prouvé de longue date qu'elle savait adapter ses valeurs archaïques aux nécessités d'une société industrielle avancée", comme dit Gian Maria Fara, directeur de l'Institut Eurispes. Car la 'Ndrangheta sait être à la fois traditionnelle et innovante, médiévale et moderne, avec son chiffre d'affaires qui approche les 40 milliards d'euros. Capable d'intervenir partout dans le monde, en tout cas là où elle a un locale, un honorable et enraciné représentant de la famille. Il risque donc d'y avoir d'autres Duisbourg...
Mais dans ce tableau inquiétant de la puissance mafieuse calabraise, un point noir demeure : ce n'est jamais bon signe lorsqu'une organisation criminelle passe à la guerre en éliminant ses rivaux "intérieurs". "La guerre mafieuse est un indice de vulnérabilité, dit Macri. Elle ouvre la porte à la répression, car même le simple nom des morts est un indice précieux pour la police." Il y a gros à parier que les enquêteurs allemands qui travaillent sur le massacre de Duisbourg aimeraient partager cet optimisme.
Marcelle Padovani
Le Nouvel Observateur
Semaine du 23 août 2007
08:30 | Lien permanent | Commentaires (0)



















