11/06/2015
Heidegger et la question du "salut"
 Heidegger et la question du « salut »
Heidegger et la question du « salut »
MICHEL BEL
(16.12.2007)
Quand on lit Heidegger et qu’on regarde l’ensemble de sa production une question vient aussitôt à l’esprit : quel est le sens de cette œuvre ? Pourquoi Heidegger a-t-il tant écrit ? Et qu’a-t-il écrit, exactement ? Si « ce que l’on énonce en mots n’est jamais ce que l’on dit » comme il le fait remarquer dans son écrit sur « L’expérience de la pensée » (Questions III p.35) qu’a-t-il dit vraiment ? De quoi nous a-t-il entretenus pendant soixante ans de 1916 à 1976 ? Nous a-t-il parlé d’Aristote, de Platon, d’Anaximandre, d’Héraclite, de Schelling ? Ou bien nous a-t-il conduits à notre insu sur une voie où nous ne voudrions pas aller ? Si tel était le cas pourrait-on encore considérer Heidegger comme un philosophe ? Car il ne suffit pas de lire Heidegger en surfant sur ses concepts ou sur son pseudo concepts, il faut encore l’interroger. Il nous a invités à considérer ses écrits comme des « Chemins ». Mieux, comme des « Holzwege ».Que signifient chez lui les « Holzwege » ? A-t-on oublié son avertissement qui nous dit expressément que ces chemins forestiers sans issue apparente conduisent les bûcherons à leur lieu de travail ? (Chemins. NRF p.8). Qui sont ces bûcherons ? Sur quel lieu de travail doivent-ils se rendre ? Quelle forêt ont-ils en charge d’ « éclaircir » ? Quels bois sont-ils chargés d’extraire ? Par qui sont-ils contraints de le faire ? Est-ce par Heidegger, puisque lui seul semble être le commanditaire exclusif de la « chose »? Sinon à quel donneur d’ordres sont-ils sommés d’obéir ? Ces problèmes de fond posés par les écrits d’Heidegger sont loin d’être résolus.
Kant, dans un texte célèbre sur l’histoire avait comparé l’humanité à une forêt. La forêt qu’Heidegger se propose d’éclaircir en invitant les bûcherons à avancer sur ses « chemins » serait-elle aussi l’humanité ? A quelle fin l’ « éclaircissement » de la forêt doit-il conduire ? Quelle utilisation le commanditaire veut-il faire du bois extrait? Est-il destiné à être brûlé ? Où doit-il être préalablement stocké ? Quels critères ont-ils présidé à l’extraction ? Comment la sélection des essences a-t-elle été décidée, voire programmée ? De qui enfin le commanditaire, s’il n’est pas lui-même propriétaire de la forêt, s’est-il autorisé pour agir ainsi ? Pourquoi Heidegger veut-il que nous avancions sur ses chemins de coupe sans nous dire ce qu’il veut faire de son « bois » ni qui l’a autorisé à agir ainsi ?
Le premier « Holzweg » qu’il nous propose en 1950, lors de l’édition de son ouvrage alors qu’il est encore interdit d’enseignement par les Alliés est L’origine de l’œuvre d’art. Quelle est pour Heidegger la signification de la pratique artistique ? Pourquoi est-elle chez lui intimement mêlée à l’Histoire, au point de conduire cette dernière à un « éclatement » ou à un « recommencement », voire à une « reprise »? Pourquoi faudrait-il qu’Hölderlin, dont on sait qu’il considérait la « Germanie » comme « le cœur sacré des peuples », devienne « la puissance qui commande la réalisation de l’Histoire » ? Pourquoi celle-ci devrait-elle être considérée comme « le temps de la domination germanique de la planète ». Pourquoi l’Histoire devrait-elle être « l’éveil d’un peuple à ce qu’il lui est donné d’accomplir » ? (Chemins, NRF p. 61). Pourquoi Hölderlin devrait-il être « le poète de l’œuvre » dont il restait en 1935 et « dont il reste aujourd’hui encore », au dire de Heidegger, « aux Allemands à s’acquitter »? Si c’est de l’histoire allemande qu’il s’agit et de la domination planétaire d’un peuple-race sur tous les autres peuples devenus ses esclaves qu’avons-nous à faire de ces « Holzwege » ? Faire éditer cette conférence incitatrice au combat et à l’épuration après la découverte par les Alliés des charniers d’Auschwitz et de tous les abattoirs humains installés dans les territoires conquis de la Grande Allemagne par le régime nazi, a quelque chose de plus qu’indécent. Surtout quand on sait que les nazis assurant le commandement de la Wehrmacht ont été arrêtés dans l’accomplissement des millions de fois criminel de leur prétendue « mission » par la victoire des Alliés.
Qu’annonçait la conférence sur L’origine de l’œuvre d’art en 1935, l’année même où Heidegger légitimait l’Introduction de la violence la plus sordide dans sa « Métaphysique » ? – La « libération de la Terre pour qu’elle soit une Terre ». (Chemins, NRF p.35). Qu’entendait-il par « libération » ? Visait-il la libération de la Terre des Juifs et de tous les peuples à ses yeux indésirables ? Si oui, que signifie la réitération de cette conférence en 1950 ? Quelle nécessité y avait-il à remémorer ces horreurs ? Quel intérêt Heidegger avait-il, la même année, à rejeter la raison de la pratique de la pensée, à la fin de sa conférence intitulée : Le mot de Nietzsche : « Dieu est mort » ? En vertu de quelle nécessité l’approche de l’être devrait-elle se faire exclusivement à partir de la Logique de Hegel ? Pourquoi l’accès à l’être est-il contraint de commencer en donnant à l’homme la « position de l’absolu » ? (Hegel et son chemin de l’expérience. Chemins p.127). En vertu de quelle autorité devons-nous être amenés à reconnaître que « ce qui demeure les poètes le fondent » ? A admettre que la prétendue « souche germanique », prétendument « parente de la « souche hellénique », selon Heidegger, avait besoin de poètes en temps de détresse et précisément d’Hölderlin ? A quelle exigence non avouée obéissent toutes les contingences qu’Heidegger voudrait nous faire prendre pour des nécessités ontologiques ?
Comment Heidegger, interdit d’enseignement à la demande du Sénat de l’Université de Fribourg, a-t-il osé braver l’interdiction de faire cours en publiant des principes de pensée et de vie contenus dans des cours des années trente et quarante qui ont servi de fondement à l’action des nazis : le rejet de la raison, la valorisation de la souche germanique, voire son absolutisation ? L’extraction du bois de la forêt ne signifiait-elle pas dans les années trente-quarante l’éradication des Juifs de la « forêt germanique » afin de pouvoir réaliser pleinement l’« habitat poétique » « planétaire » des Germains ? Quelle lecture faut-il faire de ces textes aujourd’hui? Une lecture immanente, platement naïve, totalement aveugle à la réalité, comme il est de mode depuis 1950 dans certains milieux éducatifs, ou une lecture symptomale éclairante ? Les mots et les images employés par Heidegger sont-ils des signes renvoyant aux réalités habituellement visées par le langage courant ou sont-ils des signes lisibles seulement à partir d’un autre système d’encodage voire de plusieurs autres? Heidegger a enfin dit aux auditeurs de son cours sur Nietzsche, en 1937, que dans le cadre de son nouveau regard les mots fondamentaux avaient changé de sens. (Nietzsche I, p.133). Quant on sait que chez lui « les mots fondamentaux sont historialisants » (Ibid. p. 134) on est en droit de s’interroger sur la manière dont l’œuvre a été comprise jusqu’à ce jour par de prétendus spécialistes. Il n’a rien dit en revanche sur le sens des symboles qu’il employait, sur lesquels il a préféré « garder un silence total» se contentant de déclarer en 1935 dans son commentaire du Rhin de Hölderlin que chaque auditeur était « éloigné du secret différemment ». (NRF p.261). Mais on sait aujourd’hui, hélas ! en quoi consistait le « secret » de ce « bonheur lourd à porter » dont la « charge » avait été « confiée » par lui « aux Allemands » de « souche » et présentée abusivement en termes de « mission ».
A la lumière de cette semi mise au point heideggérienne, on comprend mieux pourquoi dans son cours sur la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel, en 1930, il a pu définir la « patience » comme « la vertu du philosopher » qui « comprend que nous devons constamment dresser le bûcher avec du bois approprié et choisi jusqu’à ce qu’il prenne enfin. » (NRF p.124). Pourquoi à la fin de ce même cours a-t-il dit aux étudiants : « Il ne peut y avoir qu’un seul véritable signe que vous ayez compris quelque chose à cet essentiel inexprimé qui a été constamment traité : c’est qu’en vous se soit éveillée une volonté de satisfaire à l’œuvre en ses requêtes les plus internes – chacun pour sa part, chacun selon ses forces et ses mesures ». (NRF p.228). On comprend mieux à la lumière de ces paroles pourquoi dans le commentaire des Hymnes de Hölderlin de 1934 à 1945 il n’a cessé de demander à ses auditeurs de participer à la « corvée de bûches », « d’accroître la charge de bûches » ; et pourquoi au début du semestre d’été 1942 il a estimé nécessaire de commenter le poème d’Hölderlin intitulé « Der Ister » en insistant particulièrement au début et à la fin du cours sur l’ordre donné par Hölderlin :« Jezt, komme Feuer ! ». La conférence de Wannsee venait d’avoir lieu en janvier, très exactement le 20. Le cours commença le 21 avril et se termina le 14 juillet. Les premiers bûchers ont commencé à crépiter à la fin de l’été comme en témoigne dans sa déposition le commandant d’Auschwitz. . Mais Auschwitz-Birkenau ne fut pas le seul site de stockage où eut lieu la « venue du feu ». A la même période les fours de boulanger améliorés commencèrent à être expérimentés à Belzec pour faire disparaître les traces d’anéantissement des indésirables, et particulièrement les cadavres entassés dans des fosses qui risquaient de s’avérer compromettants pour le régime. Comme par hasard les premiers fours crématoires commandés par les autorités nazies à la firme Topf et Fils venaient juste d’être livrés et étaient prêts à fonctionner à plein rendement. Est-ce un hasard si Heidegger, apparemment très bien informé, écrit dans Andenken au semestre d’hiver 1941-42 et répète au cours de l’année 1943 : « Le vent du Nord-est souffle Je l’aime entre tous, Car il annonce l’esprit de feu » … « Le vent du Nord-est devient le messager qui porte le salut » « L’envoi du salut est le retour dans le Propre de celui qui désormais reste où il est » (Approche p.102, 122-123).
Doit-on considérer l’œuvre écrite de Heidegger comme indépendante de cette réalité historique comme ont voulu le faire croire Jean Beaufret et son fidèle ami François Fédier ou comme le laisse croire aujourd’hui encore Peter Sloterdijk ? (La politique de Heidegger : reporter la fin de l’histoire, in Heidegger le danger et la promesse, Kimé 2006, p.179-180). Ou doit-on considérer que l’expression symbolique de cette œuvre a été choisie par l’auteur pour le mettre à l’abri de tout soupçon du fait de son engagement profond dans le processus d’extermination envisagé comme le salut de la « race » pudiquement appelée la « souche germanique »? N’est-ce pas Heidegger en personne qui a dit dans ce même texte: « L’ombre ménage l’abri qui protège de l’excès du feu » « Le feuillage d’un bouquet d’arbres cache la grande porte ouverte sur la cour… » « Un mot peut bien n’avoir qu’une mince apparence, une « image » peut bien sembler n’être là que pour « faire plus poétique », le mot et l’image n’en font pas moins une parole de salut, qui parle selon la pensée fidèle et reprend dans la pensée l’étranger qui a été et le patrimoine qui vient selon la convenance qui les lie originellement l’un à l’autre » (Approche p.128-129).
Cette hypothèse est-elle absurde ou bien est-elle, au contraire, le véritable fil d’Ariane qui seul peut conduire le lecteur jusqu’au secret le plus intime du nazisme ? Comment faut-il comprendre une expression telle que : « L’œuvre libère la terre pour qu’elle soit une Terre » prononcée en novembre 1935, deux mois à peine après la promulgation des lois racistes de Nuremberg ? Comment faut-il comprendre :« L’homme est Dieu », « Le bien est le mal », « le mal est le bien », « la liberté est liberté pour le bien et pour le mal », paroles prononcées en 1936 dans le cours sur Schelling ? Ou cette autre proposition, émise dans les années trente « l’essence de la liberté qui est le problème fondamental de la philosophie » consiste à « devenir essentiel dans le vouloir effectif de sa propre essence ». « Le vouloir effectif implique toujours d’être au clair, de s’être mis au clair sur les motifs. » « Quiconque veut effectivement ne veut rien d’autre que le devoir de son Dasein » « L’essence nous demeure fermée tant que nous ne devenons pas nous-mêmes essentiels en notre essence » (De l’essence de la liberté humaine. NRF p.266, 276-277). De quelle essence peut-il bien s’agir lorsque l’impératif de la raison pratique de Kant a été rejeté comme impropre et qu’Heidegger déclare en 1935 dans le commentaire du Rhin que « l’histoire est toujours l’histoire unique de tel peuple(…) ici, l’histoire de la Germanie », que « le moment crucial de notre histoire est venu » (NRF p.264,269) et, en 1941, qu’:« il est nécessaire qu’en cet instant du monde les Allemands sachent ce qui pourrait à l’avenir être exigé d’eux si l’esprit de leur patrie doit être un cœur sacré des peuples ». (Concepts fondamentaux, NRF p. 24).
Comment croire dans ces conditions que malgré leur apparence philosophique les écrits d’Heidegger nous parlent exclusivement de philosophie ? N’est-ce pas Heidegger lui-même qui a décrété la mort de la philosophie et qui a invité à substituer à la philosophie un nouveau commencement de la pensée ? (La fin de la philosophie, Questions IV NRF p.116, 139). N’est-ce pas lui encore qui a déclaré à Jean Beaufret aux entretiens de Cerisy en 1955 qu’ « il n’y a pas de philosophie de Heidegger, et même s’il devait y avoir quelque chose de tel, je ne m’intéresserais pas à cette philosophie » (Essais et conférences. Préface. NRF p. VIII). Confrontés à de telles positions nous devons nous poser la question : que faisons-nous quand nous lisons Heidegger ? Comprenons-nous sa conception de l’être ? Adhérons-nous à cette conception ou nous contentons-nous de survoler ses écrits en recueillant l’écume des mots qui retiennent notre attention et en nous désintéressant de tout le reste ? Mais ce reste qu’en faisons-nous ? N’existerait-il plus pour nous parce qu’il ne sollicite pas notre intérêt ? Ne devons-nous pas au contraire nous interroger pour savoir ce qu’il contient réellement ? Dès lors la question se pose de savoir si pour lire Heidegger il faut faire appel à un seul encodage ou à plusieurs.
L’encodage du langage courant se double chez lui d’un encodage étymologique facilement lisible par tous (« aletheia », « poiésis », « pur », etc.). Mais on ne peut pas s’arrêter là. L’encodage étymologique se double à son tour d’un encodage propre à Heidegger (« o logos » est « to pur », « art » égale « intensification de la volonté de puissance » ; « habitat poétique » égale « Reich germanique » ; « justice » égale acte de « construire, d’éliminer, d’anéantir » ; « genos » égale « souche » et non « genre » ; « poiésis » signifie « traitement médical », etc.…Je passe sur tous les néologismes inventés par Heidegger pour adapter l’écriture de son monde à son imaginaire. On est forcé de constater que ces encodages conceptuels surnuméraires par rapport à l’expression philosophique courante sont encore enveloppés par un encodage symbolique (la charge de bûches, l’habitat poétique, le poème, la Hütte, la coupe en argent, le Geviert, la cruche, les Holzwege, la caverne, le tablier, etc. La plupart de ces symboles sont empruntés à des domaines ésotériques connus mais leurs signifiés ont été modifiés, ce qui fait de la symbolique ésotérique d’Heidegger une symbolique totalement originale d’apparence trompeuse au contenu ultra secret. Un contenu dont « chacun est éloigné par une distance plus ou moins grande » « en fonction de son degré d’accès au secret » au sein de la « communauté ». (De l’essence de la liberté humaine, NRF p.270 ; Le Rhin p.261; etc.).
Mais Heidegger ne se contente pas de jouer avec une large palette d’encodages, il prend encore plaisir à utiliser un foisonnement de « perversions de sens » qui dénaturent les œuvres de tous les auteurs qu’il étudie. Aristote, Platon, Descartes, Kant, Schelling, Leibniz, Nietzsche, Hölderlin ont tous été mutilés pour devenir conformes aux exigences de la « visée » heideggérienne (ontico-ontologique) de la totalité. Cette désubstantialisation heideggérienne des auteurs de toutes les traditions (philosophique, poétique, mystique, artistique, ésotérique, etc.) est devenue tellement proverbiale qu’Heidegger lui-même y faisait référence dans ses cours mais sans changer un iota à ce qu’il disait et quelquefois en faisant preuve d’une arrogance hautaine difficile à supporter : « nous affichons la prétention d’être « plus philologique » que cette mouture irréfléchie de « philologie scientifique » (Concepts fondamentaux , NRF p.126). On sait ce qu’il est advenu d’Anaximandre dans les Concepts fondamentaux entre les mains d’Heidegger. Le professeur était trop obnubilé par la brillance de sa pensée qui devait « rester, disait-il, comme une étoile au ciel du monde » pour remettre en cause la validité de son regard abusivement qualifié par lui, à l’origine de sa pensée, de « phénoménologique ». Il eut été plus judicieux de dire « phénoméno-tragique » en se référant à son passage obligé par « l’être-en-faute » au sens que son ami le pangermaniste antisémite Max Scheler donnait à ce mot.
Quant à la suite d’une analyse assez longue on a repéré tous ces travers, qu’on les a identifiés, une question se pose à nouveau à nous: qu’y a-t-il réellement dans l’œuvre d’Heidegger? Quel message a-t-il voulu nous transmettre ? A qui s’est-il réellement adressé dans ses leçons, dans ses recueils et dans ses conférences ? Pourquoi a-t-il procédé à un ré encodage continuel des signes du langage ? Sommes-nous en présence d’un enrichissement de sens par rapport aux lectures philosophiques traditionnelles ? Ou avons-nous à faire à une production pathologique d’apparence savante dont les références culturelles masquent à la fois la physionomie et le contour ? Comment cette production s’insère-t-elle dans la production historique de l’époque ? En est-elle totalement séparée ? Se contente-t-elle de l’accompagner en la commentant comme l’œuvre de Hegel accompagna pour un temps la conquête de Napoléon ? Ou – et ce serait gravissime – trace-t-elle aux acteurs politiques les voies à suivre pout parvenir aux fins que nous savons et que je n’ose pas nommer ? Les philosophes français n’ont jamais voulu explorer cette voie ; à quelques rares exceptions près vilipendées aussitôt par des nuées d’acolytes du prétendu « grand homme ». Puisque de nombreux indices nous incitent à le faire nous allons prendre ce chemin oublié.
Pourquoi Heidegger se complaît-il tant à parler de la « libération des prisonniers de la caverne », à parler de « fournaise », de « bûcher », de « flamme », de « sacrifice », de « libation », d’ « offrande aux dieux » ? Pourquoi utilise-t-il de manière aussi ostentatoire la langue du « sacré » pour s’opposer au christianisme qu’il honnit ? Pourquoi se complaît-il à évoquer « les corps pleins de vie qui tombent en poussière », « la puissance du feu qui d’abord illumine et qui n’en finit pas de consumer jusqu’au blanchissement de la cendre » ? (Textes sur Abraham a Sancta Clara et sur Trakl postérieurs au génocide). Pourquoi, faisant référence au prédicateur antisémite Abraham a Sancta Clara dit-il que « la pensée est la pensée fidèle » treize ans après « Qu’appelle-t-on penser ? Toutes ces positions nous interpellent. Et si nous nous étions complètement trompés sur le compte de Heidegger ! Si, au lieu d’être le philosophe qu’il paraît être au premier abord, il n’était en réalité qu’un sophiste « pipeur de consciences » selon l’expression de Nietzsche, cherchant à établir, in fine, « sans tracasseries ni démêlés », son règne sur la Terre, comme le firent avant lui, Alexandre le Grand, Napoléon ou César, et ce, en se fondant sur une idéologie de renversement des valeurs, sur une impitoyable sélection des souches humaines, en privilégiant l’une d’entre elles, la prétendue souche germanique, au détriment de toutes les autres, sans avoir peur de recourir au génocide qu’il nomme « l’anéantissement » sans autre précision, afin de n’être pas pris en défaut!
La négation de l’universalité du genre humain au profit de cette prétendue « race-souche » est affirmée dans toute son œuvre depuis le cours sur Le Sophiste en 1924 jusqu’au cours sur la Métaphysique de Nietzsche en 1940 où elle trouve son apothéose, en passant par Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie en 1927, les cours de l’année 1933 et l’Introduction à la métaphysique en 1935 Pour dire qu’Heidegger n’est pas raciste, il ne faut jamais avoir lu ses textes. Naturellement, il l’est de manière plus subtile que Drumont ou que Darré. Il met en avant les rapports logiques des conditions nécessaire et suffisante, il avance avec des souliers vernis de rhétoricien et non avec de gros sabots de bateleur de foire. Mais le fait est là. Sa lecture raciste de Platon diffère certes, de celles de Günther et de Julius Stenzel mais les « souches de l’être », les cinq « gene » n’en servent pas moins de « paradigme » grâce au principe d’analogie, pour l’affirmation de la « division en souches du Dasein ». Il y a la « souche germanique », la « souche parente grecque » et « l’espèce dégénérée ». « Comparaison n’est pas raison » aurait dit Châtelet, mais qu’importe à Heidegger puisque son paradigme est pour lui vérité. Le « sang et le sol » sont bien, chez lui, des principes fondateurs et non une simple concession de circonstance au régime nazi. Jaspers qui ne pouvait le croire en 1933 à la lecture du Discours de rectorat, l’a appris à ses dépens, dans les années suivantes, mais trop tard.
Savons-nous par ailleurs comment Heidegger a cherché à vivre l’idéal de Nietzsche : « Dionysos contre le crucifié » qu’il présente comme la seule compréhension authentique de Nietzsche dans son cours sur les Concepts fondamentaux de la métaphysique ? Si, au lieu de nous égarer dans des considérations oiseuses sur le « Da » de « Dasein », nous suivions cette piste à laquelle Heidegger s’est constamment référé depuis 1929, - Nietzsche lui « était déjà salutaire depuis 1909 », dit-il dans son cours sur Nietzsche de 1937 - peut-être découvririons-nous un Heidegger très différent de celui que ses thuriféraires nous ont présenté. Heidegger, en 1961, a déclaré avoir adhéré à la cause de Nietzsche dans la Préface de l’édition de ses cours sur l’auteur d’Ecce homo. Pourquoi ne pas vouloir prêter attention à sa parole ? Aurions-nous la prétention de savoir mieux qu’Heidegger, sans l’avoir lu attentivement, ce qu’Heidegger a pensé, simplement parce qu’il ne fallait à aucun prix qu’il ait été nazi pour certains philosophes français, ceci afin de ne pas ternir son image de marque inventée de toute pièce au mépris de l’évidence? C’est grotesque. Un penseur qui considère la guerre comme le père de toute chose, qui déclare son existence nécessaire pour assurer la partition de l’humanité en dieux et en esclaves, qui affirme sans broncher que la conception du bien issue du christianisme et de l’humanisme est un mal, qu’il faut appeler Bien le Mal, qui déclare froidement que l’humanité doit être soumise « à cette race qui possède l’aptitude essentielle à assumer sa domination sur la Terre entière », en « traquant sans cesse » « l’ennemi intérieur, au besoin en l’inventant » (Métaphysique de Nietzsche (1940); l’essence de la vérité (1933)), est un penseur qui ne relève pas de la philosophie ou alors nous ne savons plus ce que parler veut dire. Les « philosophes » heideggériens français ont profité de la méconnaissance des textes de Heidegger qui était celle de leurs auditeurs ou de leurs lecteurs pour affirmer des contre-vérités absolument irrecevables. Peut-être ont-ils été eux-mêmes victimes de leurs lacunes et de leurs illusions.
Intermédiaire entre « le poète » qui l’inspire et « l’homme politique » qu’il dirige, le « philosophe » Heidegger – il se désigne lui-même ainsi en 1934 – trace les voies à suivre pour réaliser sa « phénoménologie de l’être » concrétisée en histoire et indique les étapes à franchir pour l’accomplir. Il s’agit de réaliser une « ré-volution » qui ne soit plus sujette à un retour en arrière et pour cela, Heidegger se devait d’éradiquer absolument « le Mal », - ce qui par lui était considéré comme tel, ce mal que Kant désignait par ces mots: « ces Palestiniens qui vivent parmi nous » - afin de laisser place nette à la seule édification du « Bien », entendons du Nouveau Bien, à savoir, l’ancien Mal. Aujourd’hui la radicalité de la décision énoncée en 1935 dans l’Introduction à la métaphysique, relue avec un recul historique de plus de soixante dix ans, fait frémir : « (…) nous affrontons » dit-il « la grande et longue tâche de dégager par déblaiement (« abzutragen ») l’origine d’un monde vieilli et d’en bâtir un vraiment neuf, c’est-à-dire situé dans l’histoire. (…) Seul le savoir le plus radicalement historial peut nous faire sentir le caractère insolite de nos tâches et nous éviter de voir survenir à nouveau une simple restauration et une imitation stérile ». (Introduction à la métaphysique NRF p.134 ; Einführung, Niemeyer, 1987, p.96, 3° §)
Quel était ce « monde vieilli » (« altgewordene Welt ») qu’il n’appréciait guère? De toute évidence, celui qu’avait construit Abraham par sa foi et par son exil, celui qu’avait consolidé Moïse par sa Loi, celui qu’avait parfait le Christ par l’Evangile et qu’avaient diffusé ses disciples sur toute la terre habitée, à savoir : non pas seulement un monde d’idées mais la population juive dans son ensemble. Dès 1924 Heidegger dans son cours de Marbourg sur Le Sophiste avait assimilé, de manière « euphémisée » certes, mais bien réelle, le Juif Husserl à un « sophiste » et les sophistes au « Néant ». La référence au Néant était patente dans la Leçon inaugurale en 1929 et elle sera beaucoup plus marquée encore dans la conférence sur Abraham a Sancta Clara en 1964, mais seuls pouvaient comprendre ses propos ceux qui savaient dans les années trente –quarante ce que visait Heidegger, c’est-à-dire le « groupe de choc » qui l’avait accompagné à Marbourg et « l’escorte » déjà très abondante de ses disciples armés , à savoir, des « prisonniers de la caverne » que sa parole avait déjà « libérés ». Soit, dans l’esprit de Heidegger, ceux qui n’étaient déjà plus des « hommes » assujettis à la Loi de Moïse, ni contaminés par l’influence nocive de la « souche dégénérée » (« nicht arisch ») mais des « surhommes », c’est-à-dire des « demi-dieux » (Le Rhin 1935)
Nous savons aujourd’hui que ces paroles, prononcées trois ans à peine après la prise de pouvoir, en 1935, n’étaient pas simplement des mots jetés en l’air mais des décisions politiques réelles qui allaient s’accomplir sans tarder, de manière irréversible et, - n’hésitons pas à le dire -, ouvertement diabolique. La planète entière allait savoir ce que signifiait pour Heidegger : « Le « Surhomme » est l’homme qui donne à l’Être un fondement nouveau – dans la rigueur du savoir et dans le grand style de la création ». (La volonté de puissance en tant qu’art, semestre d’hiver 1936-37, dernière parole du cours, Nietzsche I, NRF p.199). Trois ans plus tard, en 1940, il devait déclarer que « l’acte de créer » implique comme condition nécessaire « l’anéantissement ». « Construire ne va pas sans éliminer », dit-il. « Le penser constructif est à la fois éliminateur et anéantissant ». « Chaque construire (en tant que créer) implique le fait de détruire. » (…) « L’élimination qui distingue et préserve, est la suprême manière de conserver ». « L’anéantissement est la suprême manière de la contre-essence pour la conservation et l’intensification ». « Le fait d’anéantir assure le penser contre la pression de toutes les conditions de déclin ». « Justice » [signifie] « l’intention de conserver quelque chose qui est plus que telle ou telle personne » « La justice » est conçue « en tant que manière de penser constructive, éliminatrice, anéantissante » (La métaphysique de Nietzsche, (1940), Nietzsche II, NRF p. 257-260).
Ce qui avait été annoncé sous une forme encore euphémisée en 1935, mais qui, en fait était préparé depuis 1919, et avait commencé à se réaliser en 1933, allait trouver son accomplissement et, dans l’esprit de Heidegger, son plein achèvement, de 1942 à 1945 avec le génocide (Der Ister – Le Feu. Fin de parcours du fleuve nazi). Depuis la source (1919) le courant est maintenant arrivé à l’estuaire (1942). La mission aryenne du retour à la pure origine grecque est censée être terminée : « Ite missa est ». Pour l’anniversaire de sa mort Hölderlin doit trouver tout le travail réalisé, sa « prophétie » accomplie. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. L’alliance des communistes et des libéraux est venue brouiller les cartes. Il allait falloir recommencer en s’y prenant mieux. C’est ce qu’allait concrétiser la reprise des conférences et des publications destinées à la remobilisation du Dasein, reprise qui inaugure la deuxième vague de conditionnement à partir de 1949 (Regard sur ce qui est). Mais avant de nous intéresser à cette seconde vague continuons à nous intéresser aux effets de la première.
Que le « philosophe », depuis 1919, c’est-à-dire depuis qu’il a effectué la « mise en pratique de son regard phénoménologique » (Questions IV p.168) ait indiqué la voie à suivre et montré les étapes pour la réaliser, c’est ce que disent, chacun de son côté Heidegger et Hitler. Le premier dans les commentaires des Hymnes de Hölderlin et dans les « Chemins d’explication »(1937) notamment, le second dans de nombreux chapitres de Mein Kampf. On ne sera donc pas étonné que fondé sur cet accord et « assuré d’être obéi », comme il le dit dans ses cours sur Nietzsche (La volonté de puissance en tant qu’art, Nietzsche I, NRF p.59), Heidegger ait pu déclarer le 3 novembre 1933 que « Le Führer et lui seul est la vérité présente et future de l’Allemagne et sa loi. » Pourquoi « lui seul » ? Parce que de tous les « créateurs » et de tous les « gardiens » qu’il a formés, il est le seul qui lui obéisse au doigt et à l’œil du fait se sa confiance aveugle, de son absence totale de culture et de son fanatisme résolu. Heidegger aura maille à partir avec les autres « gardiens », - ce sera le deuxième « aiguillon » de sa vie après celui de la « foi des origines », mais avec Hitler, tout baigne dans l’huile. Avec lui il va pouvoir « poétiser » comme il l’entend car « commander » et « poétifier » sont désormais tout un. (Cf. La volonté de puissance en tant que connaissance, 1939, NRF p. 474). Les textes relatifs à la signification de l’acte de commander sont très nombreux chez Heidegger. Ils sont présentés essentiellement dans les cours sur Nietzsche, et les modes de commandement sont tellement bien explicités, chacun dans son essence propre, qu’on ne peut pas commettre d’erreur sur la nature de celui qui commande. (Nietzsche I, NRF pp.45, 59, 472-478,492-494 ; Chemins, NRF pp.192-193).
Quant à l’identification du philosophe qui a assuré le conditionnement d’Hitler, aucun doute n’est possible non plus compte tenu de tous les éléments que nous fournit Hitler sur la question. Cf. Mon combat, Nouvelles Editions Latines pp.109,168-176,209-222,293,330-368, 371-383, 450-477, 575-602). Il suffit de s’y reporter. Le nom d’Heidegger n’est jamais cité mais la « nouvelle conception du monde » de Heidegger est entièrement circonscrite et l’appel à la violence qu’elle implique, explicité. On ne peut cependant pas forcer à voir la réalité les porteurs d’encensoirs qui ne veulent pas voir. Il est sûrement plus enthousiasmant d’agiter l’encensoir pour faire de la fumée que de regarder la vérité en face. Quand on a compris la symbiose existant entre les deux partenaires associés on n’est plus étonné qu’en éditant en 1953 son cours de 1935 sur l’Introduction à la métaphysique Heidegger ait pu parler de la « vérité interne et de la grandeur du national socialisme » (mot à mot : « de ce mouvement ».NRF p.202) et qu’en faisant son cours sur les Questions fondamentales de la métaphysique durant le semestre d’hiver 1935-1936, pour illustrer la « mathesis », « l’acte d’apprendre », « dans son exercice même », Heidegger ait eu recours à des considérations sur le « maniement du fusil modèle 98 ». On voit tout de suite, n’est-ce pas, le lien nécessaire qui existe entre la vérité mathématique prise en elle-même et « l’usage des armes » tel qu’il est pratiqué par les nazis et par la Wehrmacht. (Qu’est-ce qu’une chose ? NRF p.83-85). Dans cette page qui est une véritable pièce d’anthologie du conditionnement nazi où Heidegger se transforme en maréchal des logis instructeur on reconnaît, hélas ! le même Heidegger qui le 25 novembre 1933 lors de la cérémonie d’immatriculation des étudiants avait fait office de sergent recruteur pour enrôler les étudiants dans les sections d’assaut : « l’étudiant allemand passe à présent par le service du travail ; il se tient aux côtés de la S.A. ; il est assidu aux sorties sur le terrain ». (Traduction adoucie de François Fédier, Ecrits politiques, NRF p.126). Heidegger exige, de plus, de chaque étudiant qu’il garde en mémoire pour le répéter « le sacrifice » d’ « Albert Léo Schlageter » (p.135). Si Boileau pouvait dire de Molière : « Dans ce sac ridicule où Scapin l’enveloppe Je ne reconnais pas l’auteur du Misanthrope », nous pouvons, à notre tour, dans un plagiat sans prétention, dire à propos d’Heidegger : « Dans ce cours affligeant d’un instructeur de guerre On voit l’effet pervers du génie de naguère. » « Les « mathémata » sont les choses, dit-il, dans la mesure où nous les prenons dans la connaissance ». (p.84). Nous sommes très heureux d’apprendre durant le semestre d’hiver 1935-1936, que ces « choses » sont les fusils des SS et ceux de l’Armée allemande, destinés à « libérer » artistiquement « la Terre pour qu’elle soit une terre ». Nous savons par ailleurs grâce au témoignage d’un professeur de médecine, rapporté par Hugo Ott, qu’Heidegger relevait en 1933 les rapports d’entraînement paramilitaire des étudiants, établis par l’ancien officier de carrière Georg Stieler, militant actif du Stahlhelm, en se rendant lui-même sur les lieux d’exercice, dans les glaisières du Schönberg, « comme si le recteur était le commandant en chef de ces associations ». (Hugo Ott, Martin Heidegger, Eléments pour une biographie, Payot, p.158).
Au vu de ces éléments bellicistes accablants qui structurent l’œuvre d’Heidegger et en constituent la charpente logique solidement ancrée dans Scharnhorst d’un côté, dans Clausewitz, de l’autre, (Cf. Le Discours de rectorat et le cours sur Schelling), il apparaît urgent de mettre en garde les lecteurs contre les tentatives laudatives des heideggériens français et autres qui s’emploient à faire accréditer la pureté d’intention de ce psychopathe aux visées impérialistes qui n’a jamais eu un mot de compassion pour toutes les victimes de ses conquêtes guerrières et, plus grave encore, pour celles de ses « extractions forestières ». En lisant le texte de 1937 sur l’appel des Français à la collaboration, les textes sur la métaphysique de Nietzsche et sur la justice de 1939 et de 1940 appelant à l’anéantissement peut-on encore en rester vis à vis de son action réelle à la seule attitude du soupçon ? Comment Heidegger s’il n’avait été très haut placé dans la hiérarchie nazie aurait-il pu annoncer en 1941 des « décisions immanentes » dans sa leçon sur les Concepts fondamentaux juste avant la conférence de Wannsee ? Pourquoi la profession de l’ordre hölderlinien de mise à feu répond-il, au printemps de l’année 1942, à la décision responsable d’effectuer des tâches insolites prise l’année précédente dans la leçon sur les Concepts fondamentaux, au cas où l’Allemagne serait « appelée à devenir un cœur sacré des peuples » ? Ces tâches insolites avaient été annoncées dans la leçon sur l’Introduction à la métaphysique en 1935. On comprend mieux maintenant pourquoi la leçon de 1941 a pu être intitulée : Concepts fondamentaux. Quelle place devait occuper Heidegger dans l’Allemagne nazie pour être au courant de ce grand secret et pour se permettre de donner l’ordre suprême de mise à feu en langage codé, à peine voilé ? La réponse s’impose d’elle-même.
En lisant les cours et les conférences des années 1940, 41, 42, 43, nous ne pouvons pas rester indifférents à ce que nous lisons. L’« anéantissement » est exigé pour « prévenir tout risque de déclin ». La révolution allemande heideggérienne ne doit pas se solder par une plate imitation des Grecs ou par les « basses eaux » d’un « vulgaire humanisme ». Heidegger voit plus grand. Dans son hymne « à la flamme et au feu » du solstice d’été 1933, il demandait à « l’ardeur de la flamme de faire savoir que la révolution allemande n’était pas endormie, et d’illuminer le chemin sur lequel il n’y a plus de retour ». (Discours politiques, traduction François Fédier, NRF p.117). « Plus de retour » ! Après la découverte par les Alliés de tous les charniers et de tous les camps d’extermination nazis ces paroles ne font pas seulement froid dans le dos. Elles glacent d’horreur ! Comment peut-on encore appeler philosophe quelqu’un qui a la monstruosité de penser une telle barbarie ? Disons-le encore plus clairement, d’instaurer sur Terre la puissance d’un enfer de flammes et de meurtres auprès duquel les turpitudes de Sade et les fureurs imaginaires de Dante ne sont que « des jeux d’enfants » littéraires. Un enfer politique de torture, de terreur et de meurtre pour mener à bien une domination impérialiste sans précédent visant non seulement la conquête de la Terre mais également la transformation de l’homme en profondeur au point de faire de tous les êtres humains des monstres sanguinaires sans frein dénués de tout scrupule et de toute autonomie spirituelle.
Dans le cours sur l’Essence de la vérité en 1933, il proclamait à nouveau la nécessité de la guerre comme il l’avait fait dans sa thèse sur Être et temps en 1927, mais cette fois il s’aventurait plus loin encore, il l’accompagnait d’une « chasse à l’ennemi intérieur » fût-il « enté sur les racines du Dasein germanique », visant par là les mariages mixtes, notamment celui de Jaspers dont l’épouse juive l’avait si gentiment hébergé pendant des années, et celui de Misch avec la fille de Dilthey – mariage que Dilthey , très apprécié d’Heidegger, ne voyait pas d’un bon œil. Comment peut-on encore considérer ses paroles comme anodines l’année même où il proclame que l’antisémite forcené Hitler est « la vérité présente et future de l’Allemagne et sa loi » ? Pourquoi, si les intentions de ce penseur avaient été pures, l’une des conférences qu’il fit en Italie en 1936, quelques mois à peine après la promulgation des lois de Nuremberg, aurait-elle été interdite aux Juifs ? Venait-il apporter à l’Italie le levain nazi de l’antisémitisme alors que ce pays en était exempt et n’avait nulle envie de le connaître ? Pourquoi, s’il avait été comme on a voulu le faire croire persécuté par les nazis pour ses idées aurait-il eu le droit de donner deux conférences en 1936, à Rome, l’une sur l’Essence de la poésie, quand on sait que la « poésie » sous sa plume désigne depuis 1924 le « traitement médical » du peuple allemand, l’autre sur l’Université allemande et l’Europe quand on sait quelle mission il a imposée à l’université allemande en tant que fer de lance du « Sturm » nazi ? Le Sénat universitaire de Fribourg ne lui a jamais pardonné d’avoir attelé l’Université au service du travail et au service des armes afin de réaliser son ambition démesurée de « Grandeur » antisémite pangermanique.
Heidegger a eu beau user d’euphémismes pour faire croire que son adhésion au nazisme avait été l’effet d’une illusion passagère, il faut bien un jour ou l’autre donner aux mots leur sens réel et les ajuster aux visées affichées, celles du « salut », de « l’épuration », de la « domination raciale », de la « grandeur planétaire » et du « bûcher ». Pourquoi le « salut » heideggérien doit-il passer obligatoirement par l’usage du feu pour mettre un terme au prétendu « déracinement de l’Occident » ? Quand on lit Heidegger après avoir relu le Nouveau Testament on est conduit à se demander si Heidegger ne s’est pas attribué le rôle de la Providence tel qu’il est annoncé à la fin des temps, rôle qui consiste à « lier en bottes la mauvaise herbe et à la jeter au four » ? Les wagons à bestiaux conduisant sans égards les familles juives, tchèques, russes, tziganes, et autres aux chambres à gaz et à « l’anus mundi », ne peuvent-ils pas être assimilés à ces liaisons en bottes ? Heidegger rejetant totalement le christianisme mais s’attribuant les fonctions d’épuration dévolues à Yaweh se serait-il pris pour le Dieu Dionysos, (nom que Nietzsche avait donné à l’Anti-Christ, ne sachant comment le nommer), engendrant une nouvelle guerre et usant de son van – attribut traditionnel de Dionysos - afin de réaliser sa « mission salvatrice » consistant, pour lui , à libérer définitivement les prisonniers de la caverne ? C’est-à-dire l’Europe entière de la présence des juifs et du christianisme. Hitler, dans ce cas, n’aurait été que « l’homme politique » fantoche mettant en œuvre les visées du « grand homme » - terme par lequel il se plaisait à désigner dans Mein Kampf, le « grand philosophe » créateur d’une « nouvelle vision du monde» qui était plus, disait-il, que le programme d’un parti politique. Quand on met en parallèle les écrits d’Hitler et ceux de Heidegger, on est frappé par l’identité de vues qui est exprimée derrière des vocabulaires différents, certes, mais aboutissant au bout du compte, au même résultat. Hitler nous dit dans Mein Kampf qu’un livre destiné aux foules ne doit pas être écrit de la même façon qu’un livre destiné à un public cultivé. Il est facile de voir que la division des tâches a été correctement exécutée.
L’ « homme politique » et le « penseur » qui dit avoir « forgé ses gonds en partant des énigmes de l’existence » (Chemin de campagne), s’harmonisent parfaitement comme une porte tournant sur ses gonds s’encastre dans son huisserie, ici, son cadre conceptuel. Le combat d’Hitler apparaît comme la réalisation de la « guerre » et de l’ « anéantissement » voulus par Heidegger pour imposer au monde sa conception de l’être. Voulus, mais révélés seulement de manière de plus en plus précise au fur et à mesure que le nécessitaient l’action et l’adaptation de la visée aux circonstances. Aujourd’hui que l’édition des œuvres assemblées par ses soins est pratiquement terminée aucun doute n’est plus possible sur les fins poursuivies par Heidegger. Il a déployé toute son énergie, durant toute sa vie, pour réaliser la « gigantomachie » qui devait aboutir à la « parousie » de sa « divinité » au sommet de sa « domination planétaire » effectuée par sa race « élue », celle qu’il a nommée le « Dasein germanique ». L’Introduction à la métaphysique et la Métaphysique de Nietzsche (1935-1940) se complètent on ne peut mieux sur ce point. Le slogan unitaire : « Ein Reich, ein Volk, ein Führer » n’était pas celui d’Hitler dont la fonction se limitait à celle d’un démiurge réalisant les plans de l’architecte placé au-dessus de lui, mais celui du « Grand architecte » « dictateur » dont Hitler avait révélé l’existence à la Deutsche Zeitung et aux auditeurs de ses discours au début des années vingt, sans dire son nom. Secret oblige, surtout à cette époque-là, en mai 1921 et en mai 1923 (Cf. Kershaw, Hitler, p. 260 et 281).
Il s’agissait pour ce penseur fou, pour ce pseudo philosophe « architecte » au sens pharaonique et platonicien du terme de subsumer la totalité dans l’Unité, non plus seulement de manière théorique comme avait tenté de le faire Spinoza mais de manière concrète, historique, « ontique » à la manière de Stirner mais sans la franchise abrupte de Stirner. On a beau lire et relire les textes d’Heidegger en pensant qu’on a pu se tromper pour chercher à n’y voir qu’une lutte théorique menée sur le seul plan des idées, les faits résistent à cette interprétation. Les mots et les symboles visant l’ « onticité » sont incontournables et ce, depuis 1927. « L’ouverture en projet de l’être se transforme elle-même nécessairement en projet ontique », écrit-il en 1927 dans les Problèmes fondamentaux de la phénoménologie (NRF p.387).Tous ceux qui refusent de voir le « projet ontique » de Heidegger réaffirmé en 1929 dans le cours sur Les concepts fondamentaux de la métaphysique (NRF Chapitre VI, Exposé thématique du problème du monde), ne parlent donc pas de Heidegger mais d’une espèce d’ectoplasme auquel ils ont donné ce nom. Il faut être vraiment aveugle et sourd pour ne pas entendre ce que nous dit Heidegger. Ainsi dans la même leçon de 1927, il écrit, page 334: « Le comprendre à titre de projet de soi, est le mode d’être fondamental de l’advenir historial (das Geschehen) du Dasein. Il constitue aussi, peut-on dire, le sens véritable de l’agir. Le comprendre caractérise l’advenir historial du Dasein : son historicité (Geschichlichkeit). Le comprendre n’est pas une espèce du connaître, mais la détermination du fond de l’exister. Nous parlons aussi de compréhension existentielle dans la mesure où l’existence, comme advenir du Dasein en son histoire, se temporalise à travers sa compréhension. C’est dans et par ce comprendre que le Dasein devient ce qu’il est, et il n’est à chaque fois que tel qu’il se choisit, c’est-à-dire tel qu’il se comprend soi-même dans le projet de son pouvoir-être le plus propre. »
Heidegger disait déjà en 1916, - il le répètera en 1927 dans Être et temps - qu’une philosophie qui ne s’incarne pas dans la chair de l’histoire est une « survivance métaphysique ». On a beau vouloir fermer les yeux sur le commentaire de Trakl paru en 1953 où il fait l’éloge du feu qui d’abord « illumine l’esprit » par intuition puis « n’en finit pas de consumer jusqu’au blanchissement de la cendre », cette phrase, vingt ans après l’hymne au feu du solstice d’été 1933, nous saute au visage comme une morsure de cobra. Il s’agit de la conception alchimique de l’ouroboros des « philosophes du feu » expérimentée grandeur nature non plus dans l’espace confiné d’un laboratoire mais dans l’espace historique de l’humanité planétaire où elle fait des ravages sans nombre. On a beau vouloir fermer les yeux sur son appel à la fidélité de la vocation énoncé en 1910 et réitéré à l’âge de 75 ans dans sa conférence de Messkirch sur Abraham a Sancta Clara, les faits historiques n’en demeurent pas moins là. On ne peut s’empêcher de constater que les pages qu’il a choisis avec soin dans les écrits d’Abraham a Sancta Clara lui permettent de se délecter de la vision mentale des « corps pleins de vie qui tombent en poussière et de poussière tombent au néant » ; morceaux choisis assortis en prime, pour que nous comprenions mieux l’allusion, d’une référence à Sachsenhausen, localité considérée ici - pudeur oblige- non comme le camp d’extermination de Sachsenhausen auquel on ne peut s’empêcher de penser en entendant ce nom, mais comme la proche banlieue de Francfort. Quand on veut s’exprimer à travers les paroles d’Abraham a Sancta Clara on ne peut guère faire mieux, il faut prendre ce qu’il a dit et inviter le lecteur qui le souhaite à faire les ajustements nécessaires. A trois siècles de distance un même énoncé sans rien changer à ce qui a été dit précédemment résonne d’un sens totalement différent. Heidegger était très friand de ce genre d’emprunts anachroniques dont la subtilité sémantique avait également été remarquée par Guillaume de Humboldt. « Sans changer la parole, disait le linguiste, le temps introduit en elle ce qu’autrefois elle ne possédait pas. Alors dans la même demeure un autre sens est placé, sous le même sceau quelque chose de différent est donné, en suivant les mêmes lois de liaison s’annonce un cours des idées autrement échelonné. Voilà ce qui est le fruit constant de la littérature d’un peuple, mais en cette dernière par excellence de la poésie et de la philosophie ». (Acheminement, Le chemin vers la parole NRF p.257). Quand on a compris la méthode d’expression utilisée par Heidegger l’allusion est évidente. Farias n’avait aucune raison de se rétracter dans le commentaire qu’il fit du texte d’Heidegger. C’étaient ses critiques qui, dans leur malveillance prétentieuse, étaient, sur ce point précis, tout simplement des ignorants.
Et que dire des allusions à « l’étranger qui va devançant », à « la race qui va se défaisant », « au chemin où s’est engagé l’Etranger qui écarte de la race dégénérée », etc., expressions mises en avant dans le commentaire de Trakl, en 1953, qui sont toutes un rappel de l’action passée destinée à ranimer la flamme de ceux qui ont participé à l’« Einsatz », du temps que le « pâtre tranquille» écoute « le doux hymne du frère contre la colline du soir ».
A partir d’un certain nombre de considérations de ce genre qui vont de l’énoncé du projet de « gigantomachie » à la délectation de l’acte et du résultat de l’extermination, le regard du lecteur finit par basculer. Le penseur qu’on avait bien voulu prendre avec une candeur ingénue pour un grand philosophe éclairé, apparaît au contraire, comme le chef d’orchestre rusé, à demi-dissimulé et pervers de la plus grande abomination de tous les temps.
On n’est plus étonné, dès lors, qu’il ait pu porter pendant de longues années, l’insigne nazi à la boutonnière et qu’il n’ait pas eu la délicatesse de l’ôter, en 1936, à Rome lors de sa rencontre avec son étudiant juif Löwith. Comment s’étonner qu’il soit venu faire une conférence sur Hölderlin et l’essence de la poésie, qui n’a de littéraire que l’apparence, dès lors que l’on sait qu’il considérait, déjà en 1934, la poésie d’Hölderlin comme la plus haute leçon de science politique. (Le Rhin, NRF p.198). Comment s’étonner qu’il ait voulu qu’Hölderlin par sa parole commande lui-même en 1942 l’embrasement des bûchers afin de le faire participer à ce qu’il avait, selon Heidegger, prophétiquement conçu ? Tel est le sens, semble-t-il, qu’il faut donner à la « puissance » qu’Heidegger attribue à Hölderlin lorsque dit qu’ « Hölderlin n’est pas encore puissance dans l’histoire de notre peuple. Il faut qu’il le devienne. Y contribuer est de la politique au sens le plus haut et le plus propre ». Faire donner des ordres par Hölderlin, c’est effectivement faire participer Hölderlin à la puissance politique. En lui faisant donner l’ordre d’embrasement Heidegger lui fait réaliser la puissance politique au plus haut sommet. Mais qu’est devenu Hölderlin entre les mains d’Heidegger ? Une marionnette. Rien de plus. En donnant l’illusion de laisser parler Hölderlin, Heidegger devenu marionnettiste à la manière de Kleist ne fait rien d’autre qu’une prestation de ventriloquie. On cherche en vain derrière cette pantomime l’exercice de la philosophie. Qu’il ait trouvé un être inculte comme Hitler pour croire à sa parole, on peut encore le comprendre, mais que tout un peuple dans ses sphères les plus cultivées l’ait suivi dans cette voie criminelle, voilà qui passe l’entendement. Bon nombre d’Allemands se considéraient-ils dans leur for intérieur comme les « prisonniers de la caverne » qu’Heidegger venait « libérer » ? Ou, après les arrestations et les emprisonnements massifs ont-ils été piégés par les modalités de la politique dictatoriale mise en place par l’Apostat et ses exécutants devenus les « travailleurs » et les « soldats » de son nouvel empire ? Cet empire qui était censé clore le « cycle de la métaphysique » par la réalisation du « Surhomme », lequel devait ouvrir la voie à la « Grandeur » inévitable « de la Germanie » sur le chemin cyclique de « l’Eternel Retour du Même ».
En voyant Heidegger mettre la vie des hommes, des femmes et des enfants en jeu pour satisfaire une foi aussi puérile et aussi peu étayée rationnellement, on ne peut qu’être effaré. Comment est-il possible qu’un être aussi cultivé ayant reçu une solide formation chrétienne ait pu en arriver là ? Comment a-t-il pu devenir un tyran aussi criminel, pire encore qu’Attila, en se faisant renégat de la foi de l’origine ? Aurait-il vécu trop près du christianisme comme le dit Nietzsche ? Mais qu’est-ce que vivre trop près du christianisme ? N’aurait-il pas plutôt vécu trop près d’un système institutionnel répressif qui n’aurait rien à voir avec le christianisme ? Système répressif et humiliant qui aurait créé chez lui une réaction antithétique encore plus oppressive. On ne peut guère s’expliquer un tel comportement que par les effets conjugués d’une surestimation de soi, d’une immense humiliation et d’une très grande frustration devenues indélébiles. Il semble que ce soit le retentissement de l’empreinte initiale sans cesse amplifiée qui l’ait conduit à cultiver cette « haine » prétendument « clairvoyante » dont il nous entretient dans le premier cours sur Nietzsche (NRF p.51), une haine jouxtant l’absoluité et ne laissant plus aucune place à l’amour du prochain, la haine-vengeance d’un amour contrarié et sublimé ne laissant à l’amour humain d’autre forme d’expression possible que l’amour de la patrie, le sacrifice de soi que l’on doit faire à la « mère patrie » (en allemand, « Vaterland » ou « Heimat »), afin de réaliser sa Grandeur dans l’Histoire. On est cependant en droit de se demander si cet appétit de « Grandeur » ne serait pas plutôt l’expression de la paranoïa du dictateur qui dirige cette ascension historique. La réalisation de cette dernière, en effet, n’est désormais possible, du fait de l’inversion des valeurs, que par le recours à l’assaut (« Sturm ») et donc aux méfaits produits par les sections d’assaut, les SS et la Wehrmacht, elle-même commandée par le chef suprême des autorités nationales socialistes, lui-même dirigé par le dictateur « sûr d’être obéi »faisant office de Providence.
Que proclamait Heidegger dans son discours de rectorat en 1933, « Alles Grosse steht im Sturm ».Et il ajoutait : « Nous voulons que notre peuple remplisse sa mission historique ». Quand on sait que cette mission consistait à exterminer le peuple Juif qui le gênait pour construire son « monde » on a vite compris quel est le sens de l’œuvre de Heidegger. Les Juifs d’Europe, les peuples d’Europe et la planète entière ont vite compris en treize ans à peine ce que signifiaient le « Sturm » et la « mission » heideggériens. Il ne faudrait surtout pas que nous l’oubliions aujourd’hui. Or il semble que ce soit, hélas ! ce que s’empressent de faire tous ceux qui encensent Heidegger sans comprendre réellement ce qu’ils font, pour certains, en ne le sachant que trop, pour d’autres. On se prend à redouter ce qui pourrait se produire demain si Heidegger redevenant le maître à penser d’une génération cherchant à nouveau le « salut de l’Occident » comme il le fut dans les années trente et quarante. On verrait alors la poésie chausser des bottes cirées et envahir les rues de ses bataillons de chemises brunes. Faute de rimes, on verrait resurgir des crimes, les corvées de bûches, la préparation zélée des bûchers et la remise en fonctionnement des fours de boulangers transformés en fours crématoires. Si c’est cela que certains veulent en encensant Heidegger, ils sont en bonne voie. Mais si ce n’est pas cela que nous voulons, alors il faut montrer dès maintenant aux jeunes générations où conduit l’heideggerianisme qu’on leur demande de vénérer et pourquoi il faut se méfier de ce faux philosophe, de ce faux ami et de ses affidés, qu’ils soient totalement incultes ou profondément cultivés, car, sur le plan de la frustration et de la surestimation de soi les extrêmes se rejoignent comme l’histoire du nazisme l’a amplement prouvé.
En commençant cette réflexion sur l’œuvre de Heidegger nous avons posé la question : quel est le sens de cette œuvre ? Aujourd’hui nous pouvons le savoir pour peu que nous voulions nous donner la peine d’analyser le ciment avec lequel il a construit sa cathédrale de haine et d’extermination. Si nous ne mettons pas en garde les générations à venir contre les dangers contenus dans sa « bible gnostique », dite de « dernière main », nous contribuons volontairement ou involontairement à la mise en place de la tyrannie politique des idées de ce penseur fou. Si nous voulons que demain le nazisme se répète il suffit de recommencer à diffuser son conditionnement. Celui qui, en 1937, dans son appel des Français à la collaboration prétendait « sauver l’Occident » en guidant la « volonté de rénovation de fond en comble» par le recours à des « décisions radicales », au sein du mouvement nazi, et qui « mesurait la singularité de l’instant historial », écrivait, aux côtés du maire national socialiste de Fribourg, Kerber et d’Alphonse de Châteaubriant, l’auteur de La gerbe des forces, dans le premier annuaire de la ville : « Si une authentique compréhension des positions philosophiques fondamentales réussit, si la force et la volonté d’y parvenir s’éveillent dans les deux pays, alors le savoir s’élèvera à une hauteur et à une clarté nouvelles. Ce qui se prépare, c’est une transformation des peuples, bien qu’elle soit au départ et souvent ensuite, longtemps invisible ». (Wege zur Aussprache, traduit par Chemins d’explication par Jean Marie Vaysse et Luc Wagner, Heidegger, Cahier de l’Herne, livre de poche 1983, p.76).
On a vu, en huit ans, de 1937 à 1945 en quoi consistait cette « rénovation de l’Occident de fond en comble » « anticipée et régie » par le « philosophe » et en quoi consistaient ces « décisions radicales ». Heidegger n’était pour rien dans cette barbarie osera-t-on dire ? Ecoutons plutôt ce qu’il dit en 1937 : « la méditation philosophique ouvre de nouvelles voies et fixe des critères nouveaux à tout comportement et à toute décision. De cette manière, la philosophie, dans sa fonction anticipatrice(…) régit la tenue et l’avancée de l’être-là historial de l’homme » (Heidegger, Cahier de l’Herne (poche), p.74). Qui a donc conduit l’histoire du troisième Reich ? Au vu de ces déclarations, une seule réponse s’impose aujourd’hui à nous: Martin Heidegger assisté de son complice Hitler, l’architecte servi par son démiurge. C’est-à-dire celui qui se prenait pour le « dernier dieu », « le dieu à venir » accompagné de son collaborateur zélé devenu chancelier. En 1932, le photographe John Heartfield sur la couverture du numéro 42 de l’Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ) a montré d’où venait l’argent nécessaire à la réalisation de ce prétendu « salut de l’Occident ». Le nerf de la guerre étant fourni par le patronat l’opération Heidegger pouvait commencer et la collaboration être sollicitée. Alphonse de Châteaubriant créa son journal collaborationniste catholico-raciste en Juillet 1940. Il avait pour nom : « La gerbe ». Il disparut en août 1944. A partir de cette date les ennuis commencèrent pour Heidegger. Sa « mission » « hellénico-germanique » était arrivée à son terme. L’ontocratie heideggérienne avait échoué. Le Dionysos germanique devait rendre des comptes. Il ne les a pas rendus.
13/06/2010
“Les immigrés rendent l’Allemagne plus bête”
Le membre du comité de direction de la Bundesbank Thilo Sarrazin a déclaré que les immigrés de Turquie, du Proche-Orient et d’Afrique rendent l’Allemagne “plus bête”, rapporte Deutsche-Presse-Agentur.
Les immigrés de ces pays sont moins éduqués que les autres et ont plus d’enfants, a déclaré Sarrazin lors d’un événement hier, selon la dépêche. Du fait de ces immigrés, l’Allemagne devient “plus stupide en moyenne”, cite DPA. “Il y a une différence dans la reproduction des groupes de population d’intelligence différente”, selon ses propos.
Suzanne Kreutzer, une porte-parole de la Bundesbank basée à Francfort, a déclaré que les commentaires “étaient une opinion personnelle de M. Sarrazin” et a refusé tout autre commentaire.
Sarrazin, qui a rejoint la Bundesbank en mai 2009 après sept ans à Berlin comme ministre des Finances, a été contraint de démissionner en octobre après qu’il a décrit les enfants musulmans comme de “sous classe”.
“Je n’ai pas à accepter quelqu’un qui vit aux crochets d’un Etat qu’il rejette, n’assume pas l’éducation de ses enfants, et continue à produire plus de petites filles en foulard”, déclara Sarrazin au journal “Lettre Internationale” lors d’un interview. “C’est valable pour 70% des Turcs et 90% de la population arabe de Berlin.”
Il avait ensuite présenté ses excuses pour ses propos, dont le président de la Bundesbank, Axel Weber, avait déclaré qu’ils entachaient la réputation de la Banque centrale.
19:46 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
03/04/2010
Le cheval de Caligula
 Caligula est cet empereur romain qui nomma son cheval consul (quelque chose comme premier ministre). Cette désignation est restée le symbole ou la caricature de la suprématie de la politique sur la compétence. Certes, nous n'en sommes pas là. M. Sarkozy n'est pas Caligula, et M. Migaud n'est pas un cheval. Nous sommes même moins avancés que l'Italie, où le premier ministre promeut des jeunes femmes pour leurs mensurations et l'usage qu'elles en font. Mais nous y allons à petits pas. La France est plus que les autres grandes démocraties le pays du tout-politique. Elle en est malade. On en donnera quatre exemples.
Caligula est cet empereur romain qui nomma son cheval consul (quelque chose comme premier ministre). Cette désignation est restée le symbole ou la caricature de la suprématie de la politique sur la compétence. Certes, nous n'en sommes pas là. M. Sarkozy n'est pas Caligula, et M. Migaud n'est pas un cheval. Nous sommes même moins avancés que l'Italie, où le premier ministre promeut des jeunes femmes pour leurs mensurations et l'usage qu'elles en font. Mais nous y allons à petits pas. La France est plus que les autres grandes démocraties le pays du tout-politique. Elle en est malade. On en donnera quatre exemples.
Le premier concerne les récentes nominations au Conseil constitutionnel et à la Cour des comptes. Elles ont bien entendu concerné des personnalités honorables. Mais elles ont d'abord été motivées par des raisons et des objectifs politiques, ou pour mieux dire politiciens : caser celui-ci, amadouer celui-là. Dans les deux cas, il s'agissait pourtant de désigner des magistrats, des juges au-dessus de tout soupçon de partialité. On a choisi des anciens ministres, c'est-à-dire des militants politiques. Aucun autre grand pays ne fait cela. Considérons les juges de la Cour suprême des Etats-Unis. Certes, le président qui les nomme n'ignore pas leurs sensibilités socio-culturelles. Mais ils sont tous – et toutes - des juristes de grand mérite, qui ont pratiqué le droit, et seulement le droit, depuis des dizaines d'années ; ils se sont tous illustrés par des arrêts motivés qui ont établi leur réputation, et leur compétence pour la fonction.
Le second se rapporte à l'élimination du pouvoir de l'administration. Pendant longtemps, la haute administration française, basée sur le mérite, a représenté une force d'analyse et de proposition avec laquelle les politiques devaient compter. En simplifiant un peu, on avait d'un côté les directeurs de ministère, qui incarnaient la compétence, et de l'autre les membres des cabinets ministériels, qui représentaient le politique. Les premiers comprenaient qu'ils devaient essayer de suivre les orientations du ministre relayées par son cabinet ; les seconds savaient qu'ils devaient compter avec la connaissance des réalités des directeurs ; les uns et les autres trouvaient un équilibre finalement heureux pour le pays. Cet équilibre a été rompu, au seul profit des politiques. La quasi-totalité des directeurs sont aujourd'hui d'anciens membres de cabinets ministériels. L'administration ainsi politisée n'est plus que la voix de son maître.
Ce phénomène a été aggravé par la décentralisation. Dans les administrations des grandes villes, des départements et des régions, à peu près tous les postes de direction sont le plus officiellement du monde confiés à des militants politiques proches du parti au pouvoir. On se croirait en Amérique latine. L'affaire de la désignation du président de l'EPAD (Etablissement public d'aménagement de la Défense), le plus important centre d'affaires d'Europe, n'est que l'illustration caricaturale de cette dérive. Jean Sarkozy, en dépit de son inexpérience évidente, était parfaitement qualifié pour le poste puisqu'il était un politicien élu. Ce qui était en cause, c'était la logique française du tout-politique bien plus qu'un éventuel népotisme.
Le troisième exemple, qui est une conséquence des autres, est la professionnalisation de la politique. Autrefois, on faisait d'abord carrière dans le secteur privé ou public, avant de devenir politicien. Plus maintenant. De Julien Dray à Jean Sarkozy, beaucoup de nos élus n'ont jamais rien fait d'autre et ne savent rien faire d'autre que "de la politique". Ils ont milité dans les associations d'étudiants ou de jeunes contrôlées par des partis, manifesté, collé des affiches, géré des associations prétendument neutres et souvent partisanes, obtenu des sinécures, puis des sièges électoraux grâce notamment aux scrutins de liste. Aux récentes élections régionales, dans à peu près tous les partis, les deux tiers des candidats étaient définis non pas par leur métier, mais par leurs seules fonctions électives ou associatives. Autrefois, la politique était une passion. Aujourd'hui, elle est une profession. Elle était animée par le seul désir du bien commun, elle l'est dorénavant par le souci des carrières personnelles.
Le dernier cas est une preuve autant qu'un exemple de cette extrême politisation de la France : c'est la confusion de la fonction politique avec la profession d'avocat. De Dominique Strauss-Khan à Dominique de Villepin en passant par Rachida Dati, beaucoup de politiciens (sur le banc de touche ou même encore sur le terrain) s'inscrivent au barreau. Certains n'ont pas de connaissances juridiques ; d'autres n'ont pas le temps d'étudier les dossiers ; d'autres encore n'ont ni les compétences ni le temps. Ce qu'ils ont, et qui compte plus que le reste en France, c'est un "beau carnet d'adresses". Jolie formule pour ce qui est partout ailleurs dans le monde appelé trafic d'influence : j'ai été ministre, j'ai donc des obligés, et si vous voulez bien me payer, je peux leur demander des décisions ou des faveurs.
Ces constatations ne visent pas tel parti plutôt que tel autre. Elles en sont d'autant plus amères. La dernière pirouette de nos hommes politiques a consisté à nous répéter à satiété que la crise financière marquait le triomphe du volontarisme politique sur la raison économique et technique – leur justification, en somme. Heureusement que nous sommes là pour faire des miracles ! Le résultat net est que jamais les marchés n'ont été aussi puissants. La Grèce, un pays encore plus malade de la politique que la France, en sait quelque chose. Elle est, dit-on, sauvée grâce à la France. Mais qui sauvera la France lorsqu'elle sera dans la situation de la Grèce ? Caligula a mal fini. L'histoire ne dit pas ce qui est arrivé à son cheval.
Rémy Prud'homme
LEMONDE.FR | 02.04.10 | 19h02
Rémy Prud'homme est professeur émérite des universités.
12:42 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (1)
30/03/2010
Devoir de réserve
Jacqueline de Guillenchmidt
Devoir de réserve
Entre le droit et la politique, il y a la puissance des institutions. Une discrète juriste a pénétré la voie royale de la haute juridiction constitutionnelle française, confirmant sa bascule ultramajoritaire : le Conseil constitutionnel. Portrait d’une passionnée de droit cultivant, à discrétion, la sagesse du devoir.
Chaque semaine, Le nouvel Economiste révèle un tempérament à «L’Hôtel», rue des Beaux-Arts. Paris VIe. Rencontre avec une avocate ambitieuse devenue une juriste institutionnelle.
Par Gaël Tchakaloff
Avec Jacqueline de Guillenchmidt, le ciel était bleu, même lorsqu’il y avait des difficultés. » Pour une fois, Pierre Méhaignerie se fond dans la masse. Il abreuve son ancienne collaboratrice de compliments. « Une femme extrêmement compétente avec laquelle il est agréable de vivre et de travailler. Une perte pour le CSA », renchérit Dominique Baudis. Mais qu’a-t-elle de si particulier pour que les hommes politiques et les institutions se l’arrachent ? Lucide, mesurée, la récente membre du Conseil constitutionnel poursuit l’idée de justice et d’impartialité. C’est bien le moins. Son professionnalisme, oui. Son raisonnement juridique implacable, bien sûr. Ses qualités humaines, aussi. Et pourtant, elle semble si lisse que rien n’explique cette avalanche hagiographique, cette carrière fulgurante. Elle travaille bien sans faire de vagues. Son dévouement à la cause publique et son esprit consensuel justifient sa place. Et peut-être ses nominations discrétionnaires à répétition : au Conseil d’Etat, au CSA et, depuis le mois de février dernier, au Conseil constitutionnel. L’entregent de son mari, Michel de Guillenchmidt, conseiller d’Etat honoraire, avocat au barreau de Paris et de Bruxelles, n’est certainement pas étranger à son succès. Si elle ne pousse pas les portes, l’ancienne magistrate les franchit volontiers lorsqu’elles sont ouvertes. Qui ne le ferait pas à sa place ?
La France d’en haut
Résolument Le Quesnoy davantage que Groseille, Madame est née à Pékin, a passé son bac au collège protestant de Beyrouth, s’est mariée à Madrid. « Pour des raisons de commodités »… D’autres s’en contenteraient également. Fille de diplomate, elle promène son enfance et son adolescence à l’étranger, « agréable sur le plan du confort, même si c’était un peu artificiel ». Naturellement, elle entre à Sciences-Po, section service public. L’héritage paternel a laissé des traces : « Servir l’Etat, c’est-à-dire l’intérêt général, c’est le plus beau des métiers. » Mais l’amour arrive, et la dure réalité en même temps, emportant au passage l’ambition de l’Ena. Le ménage doit subvenir à ses besoins. Assistante à la mairie de Paris puis à l’Institut d’administration publique, la jeune mariée travaille « plus par nécessité que par intérêt ». Elle s’inscrit en droit, passe l’examen du barreau, déterminée à en finir avec l’assistanat transversal : « Lorsqu’on choisit un métier, c’est pour exalter ses qualités ou corriger ses défauts. Moi, je devais corriger ma timidité. » Pourtant, sa vocation ne se révèle que 9 ans plus tard, lorsqu’elle intègre la magistrature. Elle devient juge d’instruction au tribunal de Pontoise et reste 13 ans dans la magistrature. Lorsqu’elle évoque cette période, ses yeux enfantins pétillent. Ce métier demeure certainement celui qui répond le plus à son énergie et à son indépendance : « C’est le poste le plus complet que j’aie occupé. Il s’agit d’un métier d’action dans lequel vous êtes pleinement responsable de vos actes. » Mais Jacqueline de Guillenchmidt ne prend jamais le temps de savourer ses plaisirs ou ses victoires. Son exigence, son ambition parfois, l’emportent. Si bien qu’elle court de métier en métier, de fonction en fonction, sans se retourner. Trois ans plus tard, un ami la convainc de participer au travail législatif en entrant à l’administration centrale du ministère de la Justice. A la direction des affaires civiles, au bureau du droit commercial puis au bureau des professions juridiques et judiciaires, elle peaufine son métier de juriste, découvre le travail préparatoire, en amont de la loi. Elle entre dans le temple du droit, délaissant au passage la liberté et l’autonomie de responsabilité qu’elle recherchait tant.
Puissante discrétion
Le parcours de Jacqueline de Guillenchmidt a cela d’interpellant qu’il revêt une spécificité, en principe, gênante. La compétence et le sérieux de la juriste effacent les délicats « coups de pouce » dont elle a bénéficié. Car elle a cumulé les nominations discrétionnaires. Tout commence au cabinet de Pierre Méhaignerie, alors Garde des Sceaux. Elle communique à son ami Philippe Léger, directeur de cabinet du ministre, son désir de travailler à leurs côtés. Cette expérience marque un tournant dans sa carrière, qui deviendra désormais politico-juridique. Ses parents lui ont transmis leurs convictions de centre droit. Sa conscience politique commence au général de Gaulle. Mais elle a toujours préféré les grands commis de l’Etat aux élus. Pierre Méhaignerie se charge de la réconciliation : « La personnalité de Pierre Méhaignerie est attachante. Il valorise l’image de l’homme politique. C’est un homme de terrain, un homme de métier, un homme d’action et un homme courageux. Il a œuvré pour la transparence dans l’action publique, sans chercher à se protéger. » C’est beau. Mais ses démêlés judiciaires n’étaient pas prévus à l’époque. L’ancien Garde des Sceaux lui renvoie le compliment : « Jacqueline de Guillenchmidt allie le professionnalisme, les qualités humaines et l’exigence. Son dévouement à la cause publique en aurait fait un remarquable député. » Cela justifie peut-être son entrée au Conseil d’Etat en sortant de son cabinet… L’intéressée assume, vantant les mérites oxygénants du tour extérieur. Et ce n’est pas fini. Après 4 ans à la présidence de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence, puis à la commission du fonds de soutien à l’expression radiophonique, Jacqueline de Guillenchmidt est propulsée au CSA par Christian Poncelet. Elle quittera ses fonctions avant leur terme. Le même homme vient de lui ouvrir les portes du Conseil constitutionnel, cette fois-ci pour 9 ans. Explications de l’heureuse gagnante : « J’ai des liens très sympathiques avec Christian Poncelet. Je n’ai pas de liens professionnels avec lui. Mon mari le connaît bien et l’apprécie énormément. J’étais sur un petit nuage lorsque j’ai été nommée. Pour moi, il n’y avait rien de mieux. Pour quelqu’un qui a fait du droit toute sa vie, entrer au Conseil constitutionnel, c’est une récompense suprême. » A qui le dites-vous ? La file d’attente des constitutionnalistes en attente des ors de la République était serrée. La droite modérée a pris le pouvoir sur l’institution, désormais présidée par Pierre Mazeaud. Seuls deux des neuf membres actuels du Conseil ont été nommés par la gauche : Jean-Claude Colliard et Pierre Joxe. Quant au reste du renouvellement, Pierre Steinmetz, ancien directeur de cabinet de Jean-Pierre Raffarin devenu conseiller d’Etat, statuera peut-être sur des textes qu’il a contribué à préparer…
Le droit comme devoir
En dehors de son mari et de ses trois enfants, Jacqueline de Guillenchmidt a deux amours : le droit et la radio. Elle ne connaissait pas le secteur audiovisuel. C’est en présidant le fonds de soutien chargé d’examiner les demandes de subventions des radios associatives, qu’elle a développé sa spécificité. Au CSA, elle a donc repris son cheval de bataille, présidant le groupe de travail dédié à ce média et coprésidant celui sur le pluralisme et la déontologie de l’information. Pourtant, la sage juriste s’abstient de tout commentaire sur son passage dans l’autorité de régulation, autant d’ailleurs que sur son travail au sein du Conseil constitutionnel. En intégrant l’instance constitutionnelle, Madame élargit sa stature. Initialement chargé de contrôler le respect du domaine de la loi par le législateur, le Conseil s’est transformé en véritable juge de la conformité de la loi à l’ensemble des règles et principes à valeur constitutionnelle. Ses décisions, non-susceptibles de recours, s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Au-delà de sa compétence consultative, sa compétence juridictionnelle couvre le contentieux normatif, électoral et référendaire. Mais Jacqueline de Guillenchmidt a transformé son devoir de réserve en obligation de silence. Elle pratique l’autocensure aggravée. Bien sûr, les textes lui interdisent de commenter son activité au CSA, durant l’année suivant son départ. Bien sûr, elle ne peut se prononcer sur des questions relevant de la compétence de la haute juridiction constitutionnelle. Mais elle refuse également d’émettre un quelconque jugement sur le rôle ou le fonctionnement de ces institutions. Marquée par son expérience judiciaire ? Frappée d’éducation traditionnellement silencieuse ? Elle lance, simplement, un commentaire lapidaire : « Je trouve extrêmement désagréable pour les membres en exercice que d’anciens membres du CSA se prononcent sur l’institution. » Une allusion à la prolixité d’Hervé Bourges ? Réservée mais maligne, Jacqueline.
09:02 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
15/03/2010
Communication des listes électorales
Question écrite n° 20491 de M. Jean-Claude Gaudin (Bouches-du-Rhône - UMP) publiée dans le JO Sénat du 24/11/2005 - page 3032
M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au sujet de la communication des listes électorales. L'article L. 28 du code électoral stipule, en effet, que tout électeur et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a donné compétence à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour examiner toute question relative à l'article L. 28 précité. Or la CADA, dans un avis rendu le 4 novembre 2004, a estimé que les listes électorales constituaient des documents administratifs communicables de plein droit et intégralement aux électeurs, en ajoutant que, si l'extraction des personnes portant un nom déterminé pouvait se faire par un traitement automatisé d'usage courant, tout retraitement d'un fichier informatique était subordonné à l'examen de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). La ville de Marseille a été surprise par cet avis rendu par la CADA à la suite de démarches individuelles faites par des électeurs dans un but autre qu'électoral. Par conséquent, il lui demande si l'application de l'article L. 28 du code électoral ne risque pas d'engendrer des atteintes à la vie privée des citoyens, même si les demandeurs déclarent ne pas faire de ces données un usage purement commercial. La protection de la vie personnelle des électeurs ne devrait-elle pas être plus renforcée face aux risques d'utilisation abusive de fichiers au contenu sensible ? Par ailleurs, que recouvre la notion de « traitement automatique d'usage courant » utilisée par la CADA dans son avis du 4 novembre 2004, dans la mesure où toute extraction du fichier électoral implique un traitement informatique dudit fichier ? Il lui demande par conséquent s'il ne conviendrait pas que les textes en vigueur délimitent précisément les cas de communication des listes électorales et les modalités de délivrance, de manière à préserver la vie privée des citoyens et de mettre en place une réglementation appliquée uniformément par toutes les communes de France.
Réponse du ministère : Intérieur publiée dans le JO Sénat du 19/01/2006 - page 171
Les listes électorales sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans leur intégralité aux électeurs, aux candidats et aux partis ou groupements politiques, en application de l'article L. 28 du code électoral. L'article R. 16 du même code subordonne la possibilité pour tout électeur d'en prendre copie à son engagement de ne pas en faire un usage purement commercial dans la mesure où ces documents électoraux contiennent des données personnelles : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, qui ne sont pas communicables dans le droit commun régi par la loi 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs. En application de l'article 4 de la loi de 1978 précitée, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place ou par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction. S'agissant de la délivrance de copie sur papier de la liste électorale, la communication peut porter sur l'ensemble de la liste, sur certaines de ses pages ou sur la page correspondant à un nom déterminé. Lorsque l'électeur demande non pas une reproduction sur papier de tout ou partie de la liste électorale, mais une extraction de certaines données du fichier électoral, cette demande doit être satisfaite si cette extraction peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, c'est-à-dire par une requête préexistante dans le logiciel de gestion du fichier électoral. Si, au contraire, la réponse à cette demande nécessite l'élaboration d'une requête spécifique, c'est-à-dire la réalisation d'un ensemble d'opérations se rapportant à l'exploitation du fichier électoral, la commune ne doit pas accéder immédiatement à la demande de l'électeur en raison du coût de la procédure et de l'obligation qu'elle a de saisir préalablement la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande tendant à un retraitement du fichier électoral conformément aux dispositions des articles 5 et 15 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés. La communication des listes électorales à tout électeur est l'un des principaux instruments de contrôle de la sincérité de ces listes. Dès lors, il n'apparaît pas opportun de limiter les cas où les électeurs peuvent en obtenir communication.
03:26 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
11/02/2010
La grande nuit stalinienne
Nicolas Werth explore la grande Terreur (1937-1938)
Publié le 5 février 2010
Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt, “Il y a des larmes pour l’infortune, et les choses humaines touchent les coeurs”, se console Enée au moment où, abordant à Carthage avec ses compagnons, il découvre un temple célébrant les batailles de la guerre de Troie et gardant mémoire de leurs souffrances. Cette consolation semble refusée aux victimes du stalinisme. Nous n’avons toujours pas de larmes pour elles. Dans le récit du siècle écoulé, le Goulag, la Kolyma, la Grande Terreur de 1937-1938 n’ont pas encore leur place aux côtés d’Auschwitz et d’Hiroshima. Hypermnésie du nazisme, amnésie du communisme, le constat fait par Alain Besançon en 1988 n’a rien perdu de sa vérité. On mentionnera l’indifférence qui a entouré, en France, la sortie du film d’Andrzej Wajda, Katyn, consacré aux massacres par les armées de Staline, de milliers d’officiers polonais, jetés dans des fosses communes après avoir été exécutés par balle.
Reste à comprendre. Pourquoi cette asymétrie ? Pourquoi cette déplorable et cruelle réticence à méditer la défaite du communisme? Peut-on tout à la fois se prétendre antitotalitaire, comme s’en flatte notre époque, et rechigner non seulement à penser le communisme réel mais à le condamner avec la même énergie que le nazisme ?Le désastre communiste, quatrième blessure narcissique de l’humanit
Il y a d’abord l’hypothèque prise par la question raciale sur l’intelligence du siècle écoulé. En dépit des efforts déployés par les plus grands esprits, notre époque, paresseuse et infatuée d’elle-même, s’est contentée de réduire le totalitarisme nazi à un racisme. De sorte que nous nous tenons pour quittes de notre devoir envers les victimes du XXé siècle en apprenant à nos enfants à traquer sans relâche, dans le cadre de la lutte contre les discriminations, la résurgence de “la bête immonde qui n’est pas morte”, comme le dit un communiqué de l’ensemble des ministères européens de l’Education. En réalité, cela n’atteste qu’une chose, déjà observée par Georges Orwell : si nous sommes antiracistes, nous ne sommes pas antitotalitaires.
“Il y a des professeurs, mais ils n’entrent plus dans la salle de classe où l’on s’amuse.”1 Et même quand ils y entrent, les formules et les slogans, seuls susceptibles de mobiliser pour le grand combat, finissent par recouvrir toute réflexion. Le degré d’indigence qu’a atteint notre réflexion sur le totalitarisme va de pair, sinon avec avec la lecture, du moins avec l’inscription aux programmes des écoles d’auteurs, comme Primo Levi ou Hannah Arendt, les moins enclins à l’esprit de simplification et à ces facilités sentimentales dont nous avons l’art et le goût.
Il ne s’agit évidemment pas de minimiser le racisme et l’antisémitisme mais de comprendre que le coeur tragique du XXe siècle ne bat pas en eux ou pas seulement. Ce qui a rendu incommensurablement monstrueux ce siècle, et c’est le point sur lequel convergent nazisme et communisme, c’est le traitement mathématique, systématique auquel le dirigeant totalitaire, Staline comme Hitler, soumet la réalité des hommes en dépit de toutes les résistances qu’ils peuvent lui opposer.
Si l’on admet que là est le mal du totalitarisme alors être instruit par le XXe siècle, c’est renoncer à une conception prométhéenne ou messianique qui fait de l’homme le bâtisseur du royaume du Bien. C’est en ce sens que l’on peut dire avec Georges Steiner que “la défaite du communisme est une grande défaite de l’humanité” ou, avec les mots de Freud, qu’elle nous inflige notre quatrième blessure narcissique. Après la révolution copernicienne de l’héliocentrisme, la théorie darwinienne de l’évolution et la théorie freudienne de l’inconscient, le désastre communiste contraint les hommes à admettre qu’il ne leur revient pas d’édifier la cité morale, ce monde d’égalité et de justice promis par le récit marxiste. Les hommes ne peuvent – et c’est déjà beaucoup et excessivement rare – qu’introduire un peu de bien dans le monde. Seul leur appartient l’exercice de ce que Vassili Grossman appelle “la petite bonté sans idéologie“.
Or, otacette conclusion est celle-là même sur laquelle s’accordent les plus profonds penseurs de l’expérience totalitaire. François Furet achevait son essai sur l’idée communiste au XXe siècle par une formule qui a prêté à bien des malentendus et qui pourtant témoignait d’une réelle instruction par le siècle écoulé : “Nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons”2, écrivait-il.
Il n’entendait pas par là qu’il nous fallait renoncer à agir. Il lançait seulement un appel à la réconciliation avec la finitude humaine. Libres, les hommes agissant de concert peuvent modifier, infléchir le cours des choses, empêcher que le monde se défasse ou sorte de ses gonds, pour le dire avec les mots de Camus ou avec ceux de Hamlet, mais n’ont pas vocation à changer la condition humaine, à exalter la plasticité de la nature humaine ou à arraisonner le monde. Après l’ivresse du “tout est possible”, Furet nous invitait à distinguer le possible et de l’impossible.
À l’instar d’Arendt qui, rappelons-le, au sortir de son examen du totalitarisme, publie non un traité d’antiracisme ou un manuel des droits de l’homme, mais écrit son maître-ouvrage, The Human condition3, qui longtemps dans son esprit s’est intitulé significativement amor mundi, Furet nous rapatrie, après l’exil dans le monde fictif des idéologies et des solutions définitives, dans le monde réel, taillé dans l’étoffe du particulier, de l’unicité, de l’imprévisible, où l’homme fait l’expérience du pouvoir que possèdent les choses de “triompher de toutes nos attentes, de tous nos calculs et de les dépasser”, comme le décrit Arendt, où il est aux prises avec des dilemmes, confronté à des questions qui ne se résolvent pas.
Ce savoir de la finitude ne nous sied guère. Il est pourtant infiniment accordé à ce que le présent réclame. C’est pourquoi il faut également méditer les deux expériences totalitaires.
Mais ne succombons pas au péché de la généralisation. Pour penser le stalinisme dans la chair de sa monstrueuse et singulière réalité, des ouvrages importants paraissent. J’ai retenu L’Ivrogne et la marchande de fleurs4 de Nicolas Werth. Il faut aussi lire l’impressionnant travail de mémoire de Orlando Figes, Les Chuchoteurs, Vivre et survivre sous Staline5 et voir Katyn de Wajda.
Seize mois de crime sous chape de plomb
L’Ivrogne et la marchande de fleurs couvre une période qui s’étend du mois d’août 1937 au mois de novembre 1938 au cours de laquelle s’accomplit en Union soviétique, un meurtre de masse que Nicolas Werth qualifie de “plus grand massacre d’Etat jamais mis en oeuvre en Europe en temps de paix”.
De ces années 1937-1938, n’était connue que la face volontairement et habilement rendue publique par le pouvoir stalinien : celle des grands procès de Moscou et des petits procès organisés en province qui avaient permis d’occulter les opérations d’épuration qui visaient la société dans son entier et se déroulaient, elles, dans la coulisse.
L’histoire de ces seize mois de Terreur restait à écrire. Werth s’y est attelé en ne servant pas d’autre cause que celle de la vérité, c’est-à-dire de l’établissement des faits. Mais pour lui comme pour Wajda, dire ce qui a été, c’est aussi faire acte de fidélité aux morts. Werth aurait pu, à l’instar du réalisateur de Katyn, placer son travail sous l’invocation de la figure d’Antigone qui se fait un devoir suprême de donner une sépulture aux morts. On dira que telle est la fonction de l’histoire depuis son origine – sauver de l’oubli les actions humaines, selon l’incipit des Histoires d’Hérodote ou ressusciter les morts, selon le beau mot de Michelet -, mais ici, ce qui vient grossir le fleuve du Léthé, ce n’est pas seulement le travail du temps, c’est d’abord la volonté de Staline de jeter ces morts dans les oubliettes de l’histoire. Ce ne sont pas seulement des fosses communes que les exécutants de la Grande terreur ont eu pour ordre de creuser, ce sont ce que Hannah Arendt a appelé des “trous de l’oubli”, des holes of oblivion.
Tout avait été mis en œuvre pour rendre la mémoire impossible. Pour l’essentiel, les arrestations se déroulaient la nuit. Les condamnations étaient prononcées dans le huis clos de tribunaux expéditifs. Les exécutions et les inhumations étaient très précisément réglées afin de s’assurer que toute trace en soit effacée : “Si l’on enterre les cadavres dans un bois, par exemple, expose à ses subordonnées le chef du NKVD de Sibérie occidentale, il faut au préalable découper la mousse, puis en recouvrir la terre fraîchement retournée pour masquer le lieu, afin qu’il ne devienne pas un jour un endroit où pourrait se donner libre cours le fanatisme contre-révolutionnaire de la cléricaille”. L’ordre était ainsi impérieusement donné de maintenir ces opérations secrètes, et il était rigoureusement respecté. La victime elle-même n’était pas tenue informée de la sentence prononcée contre elle : exécution immédiate ou déportation au Goulag. Quant aux familles, aux proches des personnes arrêtées qui venaient s’enquérir auprès des fonctionnaires du NKVD des raisons de ces disparitions soudaines, quel que fût le verdict rendu, une seule réponse devait être apportée : «L’individu X a été condamné à 10 ans de camp sans droit de correspondance”6. “Les victimes disparaissaient tout simplement”, écrit Nicolas Werth d’une formule lapidaire parfaitement accordée au sentiment d’incompréhension et de désarroi qui devait envahir les familles forcées de constater et d’entériner le fait de l’enlèvement.
Il était en outre rigoureusement exclu d’évoquer ces disparitions soudaines avec quiconque. L’interdit ne pesait pas seulement sur les exécutants mais s’étendait à l’ensemble de la population. C’est d’ailleurs ce motif qui sera retenu contre la marchande de fleurs artificielles du cimetière Preobrajenskii, à laquelle fait allusion le titre de l’ouvrage de Werth, pour la condamner à mort : on l’accuse d’avoir colporté la rumeur, qui gagne alors les esprits, selon laquelle “on amène de nuit des fourgons entiers de fusillés!”. À ce thème du “don de la mémoire si dangereux pour le pouvoir totalitaire”, Hannah Arendt a consacré dans Origines du totalitarisme des pages pour ainsi dire définitives. “Chacun avait appris à se taire”, écrit-elle, ou à chuchoter, selon le mot de Orlando Figes, car chacun avait compris que “le plus grand des crimes, dans un pays totalitaire, est de parler de ces ‘’secrets””. Sur ce point, il faut lire l’extraordinaire témoignage du compositeur Dimitri Chostakovitch cité par Werth: “Déjà avant la guerre, il n’existait sans doute à Leningrad pas une seule famille qui n’ait perdu un proche dans la Grande Terreur. Chacun pleurait un proche, mais il fallait pleurer en cachette. Personne ne devait être au courant. Chacun avait peur.” Celui qui s’obstine dans le deuil, dans l’affliction, qui refuse de se défaire, de “cette couleur nocturne”, comme dit Shakespeare, dresse toujours une sorte d’obstacle contre la déferlante de la vie ou de la violence, comme en ont eu l’intuition Hitler et Staline.
L’Ivrogne et la Marchande de fleurs retrace donc l’histoire de ces citoyens ordinaires, de ces petits gens happés par la machine des “opérations de masse” de la Grande Terreur et que Staline aurait aimé voir oubliés à jamais. Werth s’emploie ainsi à leur redonner un nom, un visage, une histoire. Ainsi nous raconte-t-il l’histoire de l’ivrogne, Vdovine, cet employé des chemins de fer qui, en état d’ébriété, lance une bouteille vide contre un mur qui vient briser le cadre d’un portrait du chef de l’Etat soviétique et finira arrêté et fusillé pour “propagande et propos terroristes” ; celle de la famille Presnovy, ces paysans qui acceptent de louer pour l’été deux chambres à un employé allemand de l’Ambassade d’Allemagne, et dont tous les membres seront arrêtés, sur dénonciation d’un voisin, et exécutés pour avoir “constitué un groupe d’espions à la solde de l’Allemagne” ou encore de ces trois “ex-nobles”, employés du musée d’ethnographie de la ville d’Orel qui seront arrêtés et bientôt exécutés, au motif que les “vitrines du musée passaient sous silence la dimension centrale de la lutte des classes à toutes les étapes du développement des sociétés” et que, sur huit vitrines, une seule était consacré à la lutte des serfs contre les propriétaires fonciers . C’est, ainsi, au travers du prisme de ces vies minuscules, comme dirait Pierre Michon, que Nicolas Werth nous donne à voir et à comprendre le mécanisme de la terreur. Et c’est sans doute par cet attachement au nom propre, à la personne dans son unicité, à la singularité des êtres, que l’on défait quelque chose de ce que le stalinisme a fait.
Cet arrachement à l’oubli est d’autant plus important que le vœu de Staline de rendre cet oubli définitif fut sur le point d’être exaucé. Le silence a perduré jusqu’à Khroutchev qui ne jugea pas opportun en 1956 de briser ce silence. Non qu’il ignorât ces opérations meurtrières et leur ampleur. Car non seulement – mais sans doute ceci explique-t-il cela – , il en avait été un des agents d’exécution, et des plus zélés, mais la commission chargée des travaux préparatoires à la rédaction de son fameux rapport du XXe congrès, y consacrait une dizaine de pages, reconnaissant, en conclusion, “le caractère massif des répressions qui s’étaient abattues sur un très grand nombre de simples citoyens soviétiques”. Mais il n’avait pas cru bon de mentionner ces faits dans le fameux rapport final qui se bornait à dénoncer l’épuration et l’élimination des responsables politiques, des cadres administratifs, militaires, économiques, culturelles.
Khroutchev n’avait donc de larmes que pour les “serviteurs du Parti, des Soviets, de l’armée et de l’économie” et jetait ainsi une nouvelle pelleté de terre sur les victimes, les seules véritablement massives, de la Terreur stalinienne. Sous la qualification de “grandes purges”, les Procès de Moscou pouvaient poursuivre leur carrière d’événements-écrans. Et chacun pouvait continuer de croire, après 1956 et, pour ainsi dire, jusqu’à aujourd’hui – ceci se vérifie aisément, qu’on s’interroge soi-même ou qu’on interroge autour de soi. Même une historienne aussi avertie qu’ Hélène Carrère d’Encausse pouvait écrire en 1979 : “le citoyen anonyme a été dans cette période [de 1937-1938] moins directement menacé que le communiste, militant de base ou cadre du Parti”7. C’est ce rideau tiré, par deux fois donc, à trente ans de distance, sur les meurtres de masse, que déchire Nicolas Werth, plus de soixante-dix ans après les faits, à la faveur de l’accès aux archives autorisé depuis 1991.
Tous ennemis du peuple
Le sous-titre du livre annonce l’”autopsie d’un meurtre de masse”. La promesse portée par la métaphore est parfaitement tenue : du médecin légiste, il a la passion de la précision, du détail, de l’exactitude. Il dissèque ce meurtre dans ses moindres parties, des décisions à leur mise en œuvre, s’attache aussi bien aux bourreaux qu’aux victimes. Le crime a son instigateur, Staline, qui suivra dans ses moindres détails les opérations ; son maître d’œuvre, Nicolaï Iejov, le chef du NKVD ; son objectif, affiché mais dépourvu de toute prise sur le réel : “En finir une fois pour toutes avec le travail de sape mené par les éléments contre-révolutionnaires contre les fondements mêmes de l’Etat soviétique”. Enfin, sa méthode : chaque région se voit attribuer des quotas d’individus, les uns à fusiller immédiatement (1ère catégorie), les autres à interner pour dix ans, en camps de travaux forcés (2e catégorie).
Le plus grand massacre d’Etat, affirme Werth : 750 000 citoyens soviétiques furent exécutés et plus de 800.000 Soviétiques furent condamnés à une peine de dix ans de travaux forcés et envoyés au Goulag – mais aussi et surtout qualitativement : “Un seuil différent de violence a été franchi”.
Entre les purges qui visent l’élite et en permettent le renouvellement et les opérations qui vont décimer la population russe, il n’y a pas de solution de continuité. Les purges ne sont pas la partie visible de l’iceberg. La Grande Terreur s’inscrit dans la continuité de la “brutalisation” des rapports de l’Etat stalinien à la société russe. L’histoire du stalinisme s’écrit comme un affrontement quasi permanent, comme une guerre civile entre le parti-Etat et la société. La conception de la politique que Staline a en partage avec Hitler, implique la violence. Dès lors qu’on entend refaçonner la société à la lumière d’une Idée, dès lors qu’on ne voit plus dans la pluralité humaine que du matériau à tailler, on s’autorise par avance, tout autant que le menuisier qui doit bien faire abattre des arbres pour construire un lit, le recours au geste brutal. Si l’on peut tenir comme substantielle à la politique communiste les “camps de la mort sous la bannière de la liberté”, selon la fulgurante image de Camus, et cesser de les interpréter comme de regrettables accidents de l’histoire, c’est précisément parce qu’ils sont inhérents à la politique pensée comme une ingénierie sociale. L’Union soviétique fut le laboratoire de Staline.
Dès 1929, il s’attaque en premier lieu, à la paysannerie qu’il soumet, dans le mépris le plus complet de ses pratiques ancestrales, à la collectivisation agraire avant de décider “la liquidation des Koulaks en tant que classe”. Les années 1930-1933 sont marquées par une confrontation impitoyable entre le régime et les paysans qui ne se laissent pas docilement arracher à leurs mœurs, coutumes, traditions ancestrales. Un nombre considérable de paysans “Koulaks » sont déportés en Sibérie ou au Kazakhstan. Jusqu’au paroxysme de la famine de 1933 en Ukraine dont l’accès aux archives confirme qu’elle fut littéralement fabriqué par Staline pour se débarrasser d’une population opiniâtre, impossible à faire plier. Un historien a ainsi forgé l’expression, éloquente, de man-made famines.
Une nouvelle étape commence en 1937 avec une forme de violence inédite qui se déchaîne sans le moindre rapport avec le réel. Avec l’ordre 00447 s’ouvre la chasse, non plus à l’opposant, à l’adversaire, au récalcitrant – toutes les structures d’oppositions ont désormais été matées – mais à l’ensemble de la société, la chasse non pas à des ennemis mais à de potentiels ennemis. Plus personne n’est en sécurité. C’est la société en tant que société, dans son autonomie, et les hommes en tant qu’hommes, dans leur liberté, qui sont criminalisés.
La violence cesse ainsi d’être un moyen articulé à une fin – la répression des forces d’opposition au régime -, pour devenir le principe d’action du pouvoir stalinien. On entre alors dans la phrase proprement totalitaire du régime stalinien. Peu importe la querelle sémantique : ce à quoi il nous faut nous confronter c’est à l’essence même de la violence totalitaire (au sens d’Arendt) et au défi qu’elle lance à un esprit normalement constitué. Pourtant, le seul moyen d’être à la hauteur de la nouveauté et de l’atrocité de tels régimes est d’endurer l’idée qu’il n’ y pas de réponse au pourquoi, qu’il s’agit à proprement parler d’une violence “inutile” c’est-à-dire qui ne sert aucun fin, sinon celle d’assurer au régime sa dynamique. D’où son caractère illimité, démesuré, totalement arbitraire de la violence.
“Je n’ai rien contre vous personnellement”
Werth apporte également des éléments très précieux pour penser la figure du criminel stalinien, révélant un processus de dépersonnalisation sans lequel il y aurait peut-être des meurtres mais pas des meurtres de masse. À cet égard, on retiendra, parmi un embarras de richesses le témoignage édifiant de Evguenia Breivinskaia. Lorsqu’elle fait observer à l’agent chargé d’instruire son cas que l’acte d’accusation qu’il lui présente est “un tissu de mensonges”, elle s’entend répondre : “Nous le savons bien au NKVD et nous n’avons rien contre vous personnellement, mais il faut que vous signiez le protocole, vous n’y échapperez pas, vous êtes arrêtée tout simplement parce vous êtes d’origine polonaise et que nous devons remplir la ligne.” “Je n’ai rien contre vous personnellement” : cette parole terrible de l’instructeur est, en réalité, la condition sine qua non du crime de masse. Elle dit le degré d’abstraction auquel peut, et doit, atteindre l’agent de la terreur. Il réussit à ne plus voir dans l’individu singulier, unique qui se tient face à lui, qu’une entité, une généralité, le représentant d’un genre dit ennemi.
L’instructeur ne dissimule rien de ce qui le fait agir, et c’est l’autre point majeur : la stricte soumission à la logique. Vous êtes d’origine polonaise donc vous êtes coupable. Je dois faire du chiffre donc je vous arrête. Vous êtes arrêtée donc vous devez signer. Il semble, en effet, que nulle conviction idéologique n’ait soutenu les agents de la Grande Terreur dans leur entreprise meurtrière. Le grand récit communiste a manifestement perdu de son panache. L’aiguillon de la passion révolutionnaire ne semble guère les animer. Ils ne sont les coursiers d’aucun idéal. Et plusieurs documents inclinent Werth à penser, même si la question demeure affectée d’un certain coefficient d’incertitude, qu’ils n’accordent aucun crédit à l’histoire inventée par Staline, relayée par Iejov et diffusée par les chefs régionaux du NKVD. d’une conspiration nationale et internationale menaçant l’URSS. Nombreux sont ceux qui considèrent, à l’instar de ces agents de la région de l’Oural, que “plus personne ne menace le pouvoir soviétique, [qu'] il ne reste plus que quelques débris de la bande trotsko-zinoviétiste”.
Qu’ils y aient cru ou non, après tout peu importe. Il reste qu’ils ont agi comme si la fiction stalinienne – ces “accusations ritualisés” de sabotages du régime et de complots ourdis contre l’Etat – était vraie. Si les perpetrators, comme dit la langue russe, de ces crimes ne brûlent d’aucun feu révolutionnaire, ils sont en revanche de redoutables géomètres, d’impitoyables algébristes en quête de “solutions” pour “rationaliser le travail”. Hantés par la perspective d’être à leur tour les victimes de cet arbitraire, ils n’ont qu’un but : remplir les quotas avec la plus grande efficacité, “faire du chiffre”. Werth cite le témoignage d’un dirigeant du NKVD à la veille de sa propre arrestation : “J’ai travaillé comme tout le monde à l’extermination des ennemis, mais jamais ne m’a quitté la pensée que je pouvais à tout moment être désarmé, arrêté et descendu dans une cave”.
Ils s’emploient à fabriquer des coupables comme on fabrique des objets. A cette fin, le régime stalinienne dispose d’un instrument fort précieux : la notion, forgée par Lénine, d’ ”ennemi objectif”. Son contenu n’a jamais été contraignant. Si, en 1917, elle désigne le bourgeois, en 1929, elle renverra au koulak, au paysan propriétaire réputé riche. Dès son apparition, comme l’écrit François Furet, “la catégorie vaut non par ce qu’elle englobe mais par ce qu’elle autorise”. Et, entre 1937 et 1938, ce qu’elle autorise, c’est une débauche, sans précédent, de violence qui atteindra la société russe dans la sédimentation de toutes ses couches, sans exception. Très vite, les agents sont invités à jouer de la plasticité de la catégorie d’ ”ennemi objectif”. “Vous pouvez donner des vieux”8, éperonne un chef régional du NKVD promettant récompense à ceux qui auront le mieux travaillé.
L’ordre est donné de “casser du bois’”, selon la formule en vigueur, c’est-à-dire d’obtenir des aveux, et à défaut d’aveux, d’extorquer – le plus souvent par le moyen de la torture – l’apposition d’une signature au bas de l’acte d’accusation.
Comment rendre compte d’ailleurs de cet impératif de posséder in fine un acte d’accusation signé par la victime elle-même ? Non par l’intention de la convaincre, comme le prouve le témoignage précédemment cité, d’Evguenia Breivinskaia. Mais par la volonté diabolique de substituer de façon définitive la fiction au réel, d’ensevelir à jamais la vérité, de faire que de l’innocence, il ne reste pas la moindre trace.
P. Sloterdijk, Entretien avec Elisabeth Levy et Gil Mihaely, Marianne, semaine du 2 au 8 septembre 2006 ↩
Le Passé d’une illusion, Robert Laffont/Calmann-Lévy, 1995, p. 572 ↩
Ce n’est pas par cuistrerie que je ne traduis pas le titre orignal mais parce que la traduction (La condition de l’homme moderne) trahit l’objet même de cet ouvrage qui est de dégager les invariants, le donné de l’existence humaine. L’homme moderne, auquel Arendt s ‘attache dans son avant-propos et dans son dernier chapitre, se distingue par son entrée en rébellion contre la condition humaine. ↩
Editions Tallandier, 2009 ↩
Editions Denoël, 2009 traduction pierre-Emmanuel Dauzat, avec une belle préface d’Emmanuel Carrère. ↩
Ce mensonge ne sera pas levé sous Khroutchev. A la suite du XXe congrès, la libération des camps autorisée, dès 1954, par Khroutchev, s’accéléra. L’administration judiciaire fut alors confrontée à la mémoire des familles des condamnés à mort qui ne voyaient pas les leurs revenir du goulag. La décision fut prise, par crainte “d’introduire une grande confusion dans les esprits”, de perpétrer le mensonge de 1937-1938, en expliquant par la mort ce non-retour, et en lui fixant une date fictive “évaluée approximativement dans la limite des dix ans ayant suivi l’arrestation”. ↩
Hélène Carrère d’Encausse, Staline, L’Ordre par la Terreur, Champs-Flammarion, 1979 p.64 ↩
p.108 ↩
L'AUTEUR
Bérénice Levet est docteur en philosophie.
05:12 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
22/10/2009
Antifascites, encore un effort
Comment ne pas voir que le discours sur l'holocauste est instrumentalisé pour soutenir Israël et pour faire taire les critiques (la question n'étant pas de « mettre en cause » l'holocauste, mais de se demander pourquoi cet événement doit déterminer notre politique étrangère) ? Le temps où une majorité de gens aimait réellement Israël, « la seule démocratie au Moyen-Orient », « la villa au milieu de la jungle » etc. est passé. Mais l'étape qui reste à franchir, pour qu'une autre politique envers le Moyen-Orient soit possible, est de libérer la parole et de faire cesser l'intimidation et la culpabilisation à propos de tout ce qui concerne Israël et le sionisme. |
03:02 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
24/07/2009
Un mensonge d'Etat
Lu chez Ivan Rioufol :
 La désinformation officielle sur l'immigration et son ampleur, que j'ai dénoncée en 2007 dans La fracture identitaire (Fayard), est un scandale qui perdure et interdit toute politique lucide face à cette possible bombe à retardement. Une fois n'est pas coutume, Marianne se fait, cette semaine, l'utile écho de cet aveuglement volontaire, dans un article intitulé : Immigration: l'Insee aurait-elle peur des chiffres ? L'hebdomadaire y rappelle les conclusions d'une étude des démographes Michèle Tribalat et Bernard Aubry. Le document fait état de 37% de jeunes d'origine étrangère en Ile-de-France, de plus de 60% dans une vingtaine de villes, d'une explosion du nombre de jeunes originaires d'Afrique sub-saharienne, d'une proportion de jeunes d'origine étrangère en très forte hausse dans l'ouest de la France. Mais c'est dans la revue Commentaire, et non dans une publication de l'Insee, que cette étude a trouvé refuge. Tribalat : "L'Insee préfère ne pas informer plutôt que de risquer de publier une nouvelle sensible. Par peur de réveiller le racisme en France".
La désinformation officielle sur l'immigration et son ampleur, que j'ai dénoncée en 2007 dans La fracture identitaire (Fayard), est un scandale qui perdure et interdit toute politique lucide face à cette possible bombe à retardement. Une fois n'est pas coutume, Marianne se fait, cette semaine, l'utile écho de cet aveuglement volontaire, dans un article intitulé : Immigration: l'Insee aurait-elle peur des chiffres ? L'hebdomadaire y rappelle les conclusions d'une étude des démographes Michèle Tribalat et Bernard Aubry. Le document fait état de 37% de jeunes d'origine étrangère en Ile-de-France, de plus de 60% dans une vingtaine de villes, d'une explosion du nombre de jeunes originaires d'Afrique sub-saharienne, d'une proportion de jeunes d'origine étrangère en très forte hausse dans l'ouest de la France. Mais c'est dans la revue Commentaire, et non dans une publication de l'Insee, que cette étude a trouvé refuge. Tribalat : "L'Insee préfère ne pas informer plutôt que de risquer de publier une nouvelle sensible. Par peur de réveiller le racisme en France".
Ce syndrome persistant du politiquement correct est, comme toujours, animé des meilleurs intentions. Mais il se révèle indéfendable quand il en vient à camoufler volontairement des réalités, voire à les sous-estimer. Je ne résiste pas à rappeler l'hilarante étude de François Héran, directeur de l'Ined (Institut national d'études démographiques), qui en 2004 avait publié un rapport, largement médiatisé, assurant : "La France n'est pas un pays d'immigration massive". Depuis, Héran n'a jamais cessé d'être promu, en remerciement d'une telle perspicacité, tandis que Tribalat n'a jamais cessé d'être placardisée. Le plus étonnant reste la passivité des médias, qui n'ont pas jugé utile jusqu'à présent (mais Marianne semble se réveiller) de dénoncer ces opérations de propagandes menées par l'Insee et l'Ined, avec l'aval des pouvoirs publics, et constitutives selon moi d'un mensonge d'Etat.
22:21 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
16/07/2009
Péril jaune
 Une fois de plus la presse occidentale aborde la Chine qu’elle connaît mal au travers du prisme idéologique de la Guerre froide. Ainsi le conflit ethnico-social entre ouigours et hans donne lieu à une récitation sur l’oppression du « régime » de Pékin. Domenico Losurdo démonte ce préjugé.
Une fois de plus la presse occidentale aborde la Chine qu’elle connaît mal au travers du prisme idéologique de la Guerre froide. Ainsi le conflit ethnico-social entre ouigours et hans donne lieu à une récitation sur l’oppression du « régime » de Pékin. Domenico Losurdo démonte ce préjugé.
Vous vous souvenez de ce qui arrivait pendant les années de Guerre froide, et surtout dans sa phase finale ? La presse occidentale n’avait de cesse d’agiter le thème des réfugiés qui fuyaient la dictature communiste pour conquérir leur liberté. Dans la seconde moitié des années 1970, après la défaite infligée au gouvernement fantoche de Saigon et aux troupes d’occupation états-uniennes, le Vietnam enfin réunifié était décrit comme une énorme prison, d’où s’enfuyaient désespérés les boat people, entassés sur des bateaux de fortune au péril de leur vie. Et, avec les variations dévolues à chaque cas, ce motif était récurrent à propos de Cuba, de la République démocratique allemande et de tout autre pays « excommunié » par le « monde libre ». Aujourd’hui, tout le monde peut constater à quel point, depuis les régions orientales de l’Allemagne, de la Pologne, de Roumanie, d’Albanie etc., malgré la liberté finalement conquise, le flux migratoire vers l’Occident continue voire s’accentue ultérieurement. Si ce n’est que ces migrants ne sont plus accueillis comme des combattants de la cause de la liberté, mais souvent repoussés comme des délinquants, du moins potentiels.
Les modalités de la grande manipulation se révèlent à présent claires et évidentes : la fuite du Sud vers le Nord de la planète, de la zone moins développée (où se situait aussi le « camp socialiste ») vers la zone plus riche et développée, ce processus économique a été transfiguré par les idéologues de la guerre froide comme une entreprise politique et morale épique, exclusivement inspirée par le désir sublime d’atteindre la terre promise, à savoir le « monde libre ».
Une manipulation analogue est encours sous nos yeux. Comment expliquer les graves incidents qui en mars 2008 se sont déroulés au Tibet et qui, à une plus grande échelle, éclatent ces jours-ci au Xinjiang ? En Occident, la « grande » presse d’ « information » mais aussi la « petite » presse de « gauche » n’ont pas de doute : tout s’explique par la politique liberticide du gouvernement de Pékin. Et pourtant, un fait devrait nous faire réfléchir : le fait que la fureur des manifestants, bien plus que les institutions d’État, prenne pour cible les Hans, et surtout les magasins des Hans. Et pourtant, on peut lire sur n’importe quel livre d’histoire que dans le Sud-Est asiatique (dans des pays comme l’Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie) la minorité chinoise, qui grâce souvent à son passé de culture d’entrepreneurs exerce un poids économique nettement supérieur à sa dimension démographique, est régulièrement « bouc émissaire et victime de véritables pogroms ». Oui, dans le Sud-Est asiatique « la réussite économique des Hua qiao (des Chinois d’outre-mer) s’est en effet accompagnée de jalousies, qui aboutissent régulièrement à des explosions de violence anti-chinoises qui viennent parfois troubler les relations diplomatiques. Ce fut le cas notamment en Malaisie, tout au long des années 1960, et en Indonésie en 1965, lorsque les troubles internes sont prétexte au massacre de plusieurs centaines de milliers de personnes. Trente ans plus tard, les émeutes qui entourent la chute du dictateur Suharto en Indonésie qui s’en prennent systématiquement à la communauté chinoise, viennent rappeler la fragilité de la situation ». Ce n’est pas un hasard si la haine contre les Chinois a souvent été comparée à la haine contre les juifs.
Avec le développement extraordinaire que sont en train de connaître le Tibet et le Xinjiang, dans ces régions aussi tendent à se reproduire les pogroms contre les Hans, qui sont attirés par les nouvelles opportunités économiques et qui voient souvent leurs efforts couronnés de succès. Le Tibet et le Xinjiang attirent les Hans de la même façon que Pékin, Shangai et les villes les plus avancées de la Chine attirent les entrepreneurs et les techniciens occidentaux (ou Chinois d’outre-mer) : ceux-ci jouent souvent un rôle important dans des secteurs où ils peuvent encore faire valoir leur spécialisation supérieure. Cela n’a pas de sens d’expliquer les graves incidents au Tibet et au Xinjiang par la théorie de l’ « invasion » han, théorie qui ne fonctionne certes pas pour le Sud-Est asiatique. Par ailleurs, même en Italie et en Europe, la lutte contre l’ »invasion » est le cheval de bataille des xénophobes.
Mais revenons maintenant au Xinjiang. Voilà comment est décrite la situation en cours, en 1999, sur la revue Limes du général italien Fabio Mini : un extraordinaire développement est en cours et le gouvernement central chinois est engagé à « « financer, presque sans se préoccuper du retour sur investissement, d’immenses travaux d’infrastructure ». À ce qu’il semble, le développement économique va de pair avec le respect de l’autonomie : « La police locale est composée pour la majeure partie de ouigurs ». Malgré cela, l’agitation séparatiste ne manque pas, « partiellement financée par des extrémistes islamistes, comme les talibans afghans ». Il s’agit d’un mouvement qui « se mêle à la délinquance commune », et qui se couvre d’« infamies ». Les attentats semblent prendre d’abord pour cible les « ouigours tolérants ou "collaborateurs" », ou les « postes de police », contrôlés, comme nous l’avons vu par les ouigours. Dans tous les cas, concluait le général Mini, qui ne cachait pourtant pas ses sympathies géopolitiques pour la perspective séparatiste, « si les habitants du Xinjiang étaient appelés aujourd’hui à un referendum sur l’indépendance, ils voteraient probablement en majorité contre » [1].
Et aujourd’hui ? Dans la Stampa Francesco Sisci écrit de Pékin : « De nombreux Hans d’Urumqi se plaignent des privilèges dont jouissent les ouigours. Ceux-ci, en effet, en tant que minorité nationale musulmane, à niveau égal, ont des conditions de travail et de vie bien meilleures que leurs collègues hans. Un ouigour a la permission, au bureau, d’interrompre plusieurs fois par jour son travail pour accomplir les cinq prières musulmanes traditionnelles quotidiennes […] Ils peuvent en outre ne pas travailler le vendredi, jour férié musulman. En théorie, ils devraient récupérer cette journée en travaillant le dimanche. Mais, de fait, le dimanche, les bureaux sont déserts […] Un autre aspect douloureux pour les Hans, soumis à la dure politique d’unification familiale qui impose encore l’enfant unique, est le fait que les ouigours peuvent avoir deux ou trois enfants. En tant que musulmans, ensuite, ils ont des allocations en plus de leur salaire « étant donné que, ne pouvant pas manger de porc, ils doivent se replier sur l’agneau, qui est plus cher » [2].
Cela n’a pas de sens, alors, comme le fait la propagande pro-impérialiste, d’accuser le gouvernement de Pékin de vouloir effacer l’identité nationale et religieuse des ouigours.
Évidemment, outre, d’un côté, le danger représenté par des minorités empoisonnées, dans certains secteurs, par le fondamentalisme, et d’un autre côté excitées par l’Occident, il faut ne pas oublier le danger du chauvinisme han, qui se fait aussi sentir ces jours-ci : et c’est un problème sur lequel le Parti communiste chinois a toujours attiré l’attention, de Mao Tsé Toung à Hu Jintao. Ceux qui, à gauche, sont enclins à transfigurer le séparatisme des Ouigours feraient bien de lire l’interview donnée, quelques semaines avant les derniers événements, par Rebiya Kadeer, la leader du mouvement séparatiste ouigour. Depuis son exil états-unien, parlant avec une journaliste italienne, voici comment s’exprime la dame susnommée : « Tu le vois, tu te comportes comme moi, tu as la même peau blanche que moi : tu es indo-européenne, tu voudrais être opprimée par un communiste à la peau jaune ? » [3]. Comme on le voit, l’argument décisif n’est pas la condamnation de cette « invasion » han et n’est même pas l’anticommunisme. Plutôt, la mythologie aryenne, ou « indo-européenne », exprime-t-elle toute sa répugnance pour les barbares à la « peau jaune ».
Le « péril jaune » fait encore recette
Que se passe-t-il dans le Xinjiang ?
par Domenico Losurdo
Le réseau Voltaire, 15 juillet 2009
Domenico Losurdo
Philosophe et historien communiste, professeur à l’université d’Urbin (Italie). Dernier ouvrage traduit en français : Nietzsche philosophe réactionnaire : Pour une biographie politique.
02:21 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
21/06/2009
Boxe, boxe!
07:10 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
19/06/2009
Nos amies, les belles fées gores
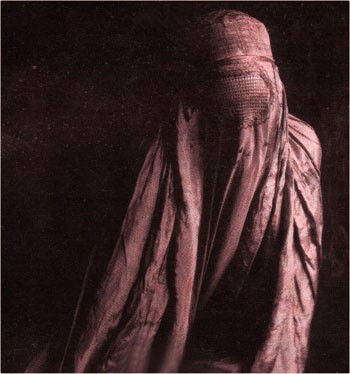 Chronique hebdomadaire de Philippe Randa
Chronique hebdomadaire de Philippe Randa
Décidément, la France multiraciale, multiconfessionnelle, tolérante et antiraciste à ses heures, repentante le reste du temps, ne cesse de « poser problème » selon une moderne expression.
Dernier exemple en date, le port de la burqa : 58 députés de toutes tendances politiques soutiennent en effet la proposition du député communiste André Guérin de créer « une commission d’enquête sur la pratique du port de la burqa et du niqab », tandis que le ministre de l’Éducation nationale Xavier Darcos juge de son côté qu’il s’agit ni plus ni moins d’une forme d’« oppression ». La classe politique est d’ailleurs quasi unanime à s’élever brusquement contre la présence de ces Belphégors qui se multiplieraient dans nos rues.
Fort bien, mais à quel titre interdire la manifestation de cette si contestée et pourtant fort incontestable pratique religieuse ?
À celui de la condition féminine ? « Injure à la femme et à sa dignité », « prisons mobiles », « avilissement de la femme envers son mari », etc. veut-on nous persuader. Certains esprits grincheux pourraient faire remarquer que, dans le même temps, notre société laisse libre les dames de se dévêtir comme cela leur chante dans des magazines pas forcément spécialisés, au cinéma ou dans d’innombrables publicités… que des parents tolèrent que leurs fillettes se culottent de strings tout en se peinturlurant outrageusement le groin… ou que les épouses puissent (tout comme leurs maris d’ailleurs) se percer les naseaux, les mamelles, le nombril ou la salle des fêtes : toute mode et pratique aussi élégantes que fort dignes et surtout des plus libératoires pour nos amies les femmes, n’est-ce pas ?
À celui de la religion ? Impossible quand on autorise la circoncision, soit une incontestable mutilation physique, qui plus est généralement pratiquée sur des enfants ! À celui de la laïcité de notre société ? Gênant quand on bannit quasi-systématiquement des menus scolaires ou de la plupart des collectivités, la viande de porc et qu’on aménage des horaires particuliers dans les piscines municipales pour que ces dames puissent s’ébrouer loin des regards concupiscents…
À celui du trouble à l’ordre public ? Le passage de silhouettes « emburqanées » sur la voie publique est en tout cas moins bruyante que la première Gay Pride venue, pourtant si encensée par nos médias.
À celui de la lutte contre la soumission aux mâles ? Mais « si certaines femmes souffrent de ce voile qui les ensevelit de la tête au pied, “la majorité a volontairement adopté cette tenue” », tranche dans Le Figaro (18 juin 2009) Bernard Godard, spécialiste de l’islam.
À celui de la nécessaire éducation à apporter à des populations culturellement défavorisées ? Non plus, car « … beaucoup ont la nationalité française. Et l’on compte pas mal de converties dans leurs rangs », constate un ancien du Bureau des cultes au ministère de l’Intérieur.
Comble de contrariété laïque, le président américain Barack Obama a lui-même reconnu la semaine dernière au Caire qu’« on ne peut dissimuler l’hostilité envers une religion derrière le faux-semblant du libéralisme. »
Contrairement à leur célèbre ancêtre qui ne hantait les salles du Louvre que de nuit, nos Belphégors modernes ont le mauvais goût, elles, de sortir en plein jour.
Reconnaissons que c’est surtout cela qui gênent tous ceux qui ont prôné « plus, encore plus, toujours plus d’immigration » et ont transformé la France en une boîte de Pandore dont ils ont grand peine désormais à maintenir le couvercle fermé.
21:12 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
17/06/2009
Du goût du bien-être matériel en Amérique
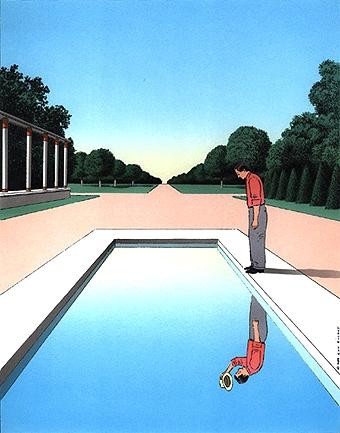 En Amérique, la passion du bien-être matériel n'est pas toujours exclusive, mais elle est générale ; si tous ne l'éprouvent point de la même manière, tous la ressen-tent. Le soin de satisfaire les moindres besoins du corps et de pourvoir aux petites commodités de la vie y préoccupe universellement les esprits.
En Amérique, la passion du bien-être matériel n'est pas toujours exclusive, mais elle est générale ; si tous ne l'éprouvent point de la même manière, tous la ressen-tent. Le soin de satisfaire les moindres besoins du corps et de pourvoir aux petites commodités de la vie y préoccupe universellement les esprits.
Quelque chose de semblable se fait voir de plus en plus en Europe.
Parmi les causes qui produisent ces effets pareils dans les deux mondes, il en est plusieurs qui se rapprochent de mon sujet, et que je dois indiquer.
Quand les richesses sont fixées héréditairement dans les mêmes familles, on voit un grand nombre d'hommes qui jouissent du bien-être matériel, sans ressentir le goût exclusif du bien-être.
Ce qui attache le plus vivement le cœur humain, ce n'est point la possession paisible d'un objet précieux, mais le désir imparfaitement satisfait de le posséder et la crainte incessante de le perdre.
Dans les sociétés aristocratiques, les riches, n'ayant jamais connu un état différent du leur, ne redoutent point d'en changer; à peine s'ils en imaginent un autre. Le bien-être matériel n'est donc point pour eux le but de la vie; c'est une manière de vivre. Ils le considèrent, en quelque sorte, comme l'existence, et en jouissent sans Y songer.
Le goût naturel et instinctif que tous les hommes ressentent pour le bien-être étant ainsi satisfait sans peine et sans crainte, leur âme se porte ailleurs et s'attache à quel-que entreprise plus difficile et plus grande, qui l'anime et l'entraîne.
C'est ainsi qu'au sein même des jouissances matérielles, les membres d'une aristo-cratie font souvent voir un mépris orgueilleux pour ces mêmes jouissances et trouvent des forces singulières quand il faut enfin s'en priver. Toutes les révolutions qui ont troublé ou détruit les aristocraties ont montré avec quelle facilité des gens accoutumés au superflu pouvaient se passer du nécessaire, tandis que des hommes qui sont arrivés laborieusement jusqu'à l'aisance peuvent à peine vivre après l'avoir perdue.
Si, des rangs supérieurs, je passe aux basses classes, je verrai des effets analogues produits par des causes différentes.
Chez les nations où l'aristocratie domine la société et la tient immobile, le peuple finit par s'habituer à la pauvreté comme les riches à leur opulence. Les uns ne se préoccupent point du bien-être matériel, parce qu'ils le possèdent sans peine; l'autre n'y pense point, parce qu'il désespère de l'acquérir et qu'il ne le connaît pas assez pour le désirer.
Dans ces sortes de sociétés l'imagination du pauvre est rejetée vers l'autre monde; les misères de la vie réelle la resserrent; mais elle leur échappe et va chercher ses jouissances au-dehors.
Lorsque, au contraire, tes rangs sont confondus et les privilèges détruits, quand les patrimoines se divisent et que la lumière et la liberté se répandent, l'envie d'acquérir le bien-être se présente à l'imagination du pauvre, et la crainte de le perdre à l'esprit du riche. Il s'établit une multitude de fortunes mé-dio-cres. Ceux qui les possèdent ont assez de jouissances matérielles pour concevoir le goût de ces jouissances, et pas assez pour s'en contenter. Ils ne se les procurent jamais qu'avec effort et ne s'y livrent qu'en tremblant.
Ils s'attachent donc sans cesse à poursuivre ou à retenir ces jouissances si pré-cieuses, si incomplètes et si fugitives.
Je cherche une passion qui soit naturelle à des hommes que l'obscurité de leur origine ou la médiocrité de leur fortune excitent et limitent, et je n'en trouve point de mieux appropriée que le goût du bien-être. La passion du bien-être matériel est essen-tiel-lement une passion de classe moyenne; elle grandit et s'étend avec cette classe; elle devient prépondérante avec elle. C'est de là qu'elle gagne les rangs supé-rieurs de la société et descend jusqu'au sein du peuple.
Je n'ai pas rencontré, en Amérique, de si pauvre citoyen qui ne jetât un regard d'espérance et d'envie sur les jouissances des riches, et dont l'imagination ne se saisit à l'avance des biens que le sort s'obstinait à lui refuser.
D'un autre côté, je n'ai jamais aperçu chez les riches des États-Unis ce superbe dédain pour le bien-être matériel qui se montre quelquefois jusque dans le sein des aristocraties les plus opulentes et les plus dissolues.
La plupart de ces riches ont été pauvres; ils ont senti l'aiguillon du besoin; ils ont longtemps combattu une fortune ennemie, et, maintenant que la victoire est rempor-tée, les passions qui ont accompagné la lutte lui survivent; ils restent comme enivrés au milieu de ces petites jouissances qu'ils ont poursuivies quarante ans.
Ce n'est pas qu'aux États-Unis, comme ailleurs, il ne se rencontre un assez grand nombre de riches qui, tenant leurs biens par héritage, possèdent sans efforts une opulence qu'ils n'ont point acquise. Mais ceux-ci mêmes ne se montrent pas moins attachés aux jouissances de la vie matérielle. L'amour du bien-être est devenu le goût national et dominant; le grand courant des passions humaines porte de ce côté, il entraîne tout dans son cours.
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique II, chap. X.
09:57 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
15/06/2009
Les Indo-Européens étaient des hommes!
 L’étude génétique de 26 individus morts il y a plusieurs milliers d’années en Sibérie du sud a permis de résoudre une énigme vieille de plus de deux siècles : qui étaient les Indo-Européens. C'est le résultat du travail mené depuis sept ans par une équipe réunissant des chercheurs du CNRS, des universités de Strasbourg et de Toulouse III Paul Sabatier, du Ministère des Affaires Etrangères, et de l'université de Krasnoïarsk en Russie.
L’étude génétique de 26 individus morts il y a plusieurs milliers d’années en Sibérie du sud a permis de résoudre une énigme vieille de plus de deux siècles : qui étaient les Indo-Européens. C'est le résultat du travail mené depuis sept ans par une équipe réunissant des chercheurs du CNRS, des universités de Strasbourg et de Toulouse III Paul Sabatier, du Ministère des Affaires Etrangères, et de l'université de Krasnoïarsk en Russie.
A la fin du 18e siècle, un juriste anglais, Sir Jones, en poste aux Indes fut frappé par la similitude entre le sanscrit, le grec classique et le latin. Il émit l'hypothèse que ces langues, et d'autres parlées en Europe, « avaient jailli de quelque source commune qui, peut-être, n'existait plus ». Son hypothèse fut confirmée par de nombreux autres linguistes, et la langue originelle fut appelée l'indo-européen. Depuis cette époque, les hypothèses pour expliquer ces rapprochements furent nombreuses. Ces trente dernières années, deux d’entre elles avaient la faveur des scientifiques. La première reliait l'expansion indo-européenne à l’expansion démographique qui a accompagné la diffusion de l'agriculture, entamée dès le début du Néolithique à partir de la Turquie, vers le neuvième millénaire avant notre ère. La seconde liait cette ressemblance à des mouvements de peuples ayant pris naissance dans l’est de l’Europe à la fin du Néolithique et au début de l’âge du Bronze (entre le troisième et le second millénaire avant notre ère).
Des études de paléogénétique menées sur des squelettes de Sibérie du sud, provenant de plusieurs kourganes (tumulus), démontrent qu’à l’âge du Bronze vers 1 700 ans av. J.-C., cette région était peuplée de sujets de type européen aux cheveux et aux yeux clairs dont les lignées paternelles et maternelles étaient justement originaires d’Europe de l’Est, d’Ukraine notamment. Du côté paternel, toutes les lignées appartenaient à un même groupe qui était considéré comme descendant des Indo-Européens. L’hypothèse liant les Indo-Européens et les populations d’Europe de l’Est sort donc renforcée de ces travaux.
Ces résultats sont issus d’une coopération engagée il y a sept ans entre les universités sibériennes de Krasnoïarsk et de Iakutsk et le laboratoire CNRS AMIS (FRE2960 Anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse). Cette coopération doit s’intensifier car la Sibérie, au carrefour de l’Asie, de l’Amérique et de l’Europe, « en permettant des analyses génétiques pointues sur des corps gelés inhumés il y a plusieurs centaines d’années détient la clef de l’étude de nombreux peuplements passés » a déclaré le Pr. E. Crubézy, directeur du laboratoire AMIS et des Missions Archéologiques Françaises en Sibérie Orientale du Ministère des Affaires Etrangères. L’équipe, qui a déjà obtenu le label de l’Année France Russie 2010 pour ses travaux en Iakoutie, souhaite consolider la coopération avec les laboratoires russes de Sibérie et des républiques autonomes de la Fédération de Russie.
Eric Crubézy
Chercheur Laboratoire AMIS-CNRS
Université Paul Sabatier – Toulouse III
Tel. : 05 61 14 59 87
23:18 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
25/05/2009
Sous le ciel de l'insurrection
 Voici les réponses aux questions que nous avons posées par écrit à Julien Coupat. Mis en examen le 15 novembre 2008 pour "terrorisme" avec huit autres personnes interpellées à Tarnac (Corrèze) et Paris, il est soupçonné d'avoir saboté des caténaires SNCF. Il est le dernier à être toujours incarcéré. (Il a demandé à ce que certains mots soient en italique).
Voici les réponses aux questions que nous avons posées par écrit à Julien Coupat. Mis en examen le 15 novembre 2008 pour "terrorisme" avec huit autres personnes interpellées à Tarnac (Corrèze) et Paris, il est soupçonné d'avoir saboté des caténaires SNCF. Il est le dernier à être toujours incarcéré. (Il a demandé à ce que certains mots soient en italique).
Comment vivez-vous votre détention ?
Très bien merci. Tractions, course à pied, lecture.
Pouvez-nous nous rappeler les circonstances de votre arrestation ?
Une bande de jeunes cagoulés et armés jusqu'aux dents s'est introduite chez nous par effraction. Ils nous ont menacés, menottés, et emmenés non sans avoir préalablement tout fracassé. Ils nous ont enlevés à bord de puissants bolides roulant à plus de 170 km/h en moyenne sur les autoroutes. Dans leurs conversations, revenait souvent un certain M. Marion [ancien patron de la police antiterroriste] dont les exploits virils les amusaient beaucoup comme celui consistant à gifler dans la bonne humeur un de ses collègues au beau milieu d'un pot de départ. Ils nous ont séquestrés pendant quatre jours dans une de leurs "prisons du peuple" en nous assommant de questions où l'absurde le disputait à l'obscène.
Celui qui semblait être le cerveau de l'opération s'excusait vaguement de tout ce cirque expliquant que c'était de la faute des "services", là-haut, où s'agitaient toutes sortes de gens qui nous en voulaient beaucoup. A ce jour, mes ravisseurs courent toujours. Certains faits divers récents attesteraient même qu'ils continuent de sévir en toute impunité.
Les sabotages sur les caténaires SNCF en France ont été revendiqués en Allemagne. Qu'en dites-vous?
Au moment de notre arrestation, la police française est déjà en possession du communiqué qui revendique, outre les sabotages qu'elle voudrait nous attribuer, d'autres attaques survenues simultanément en Allemagne. Ce tract présente de nombreux inconvénients : il est posté depuis Hanovre, rédigé en allemand et envoyé à des journaux d'outre-Rhin exclusivement, mais surtout il ne cadre pas avec la fable médiatique sur notre compte, celle du petit noyau de fanatiques portant l'attaque au cœur de l'Etat en accrochant trois bouts de fer sur des caténaires. On aura, dès lors, bien soin de ne pas trop mentionner ce communiqué, ni dans la procédure, ni dans le mensonge public.
Il est vrai que le sabotage des lignes de train y perd beaucoup de son aura de mystère : il s'agissait simplement de protester contre le transport vers l'Allemagne par voie ferroviaire de déchets nucléaires ultraradioactifs et de dénoncer au passage la grande arnaque de "la crise". Le communiqué se conclut par un très SNCF "nous remercions les voyageurs des trains concernés de leur compréhension". Quel tact, tout de même, chez ces "terroristes"!
Vous reconnaissez-vous dans les qualifications de "mouvance anarcho-autonome" et d'"ultragauche"?
Laissez-moi reprendre d'un peu haut. Nous vivons actuellement, en France, la fin d'une période de gel historique dont l'acte fondateur fut l'accord passé entre gaullistes et staliniens en 1945 pour désarmer le peuple sous prétexte d'"éviter une guerre civile". Les termes de ce pacte pourraient se formuler ainsi pour faire vite : tandis que la droite renonçait à ses accents ouvertement fascistes, la gauche abandonnait entre soi toute perspective sérieuse de révolution. L'avantage dont joue et jouit, depuis quatre ans, la clique sarkozyste, est d'avoir pris l'initiative, unilatéralement, de rompre ce pacte en renouant "sans complexe" avec les classiques de la réaction pure – sur les fous, la religion, l'Occident, l'Afrique, le travail, l'histoire de France, ou l'identité nationale.
Face à ce pouvoir en guerre qui ose penser stratégiquement et partager le monde en amis, ennemis et quantités négligeables, la gauche reste tétanisée. Elle est trop lâche, trop compromise, et pour tout dire, trop discréditée pour opposer la moindre résistance à un pouvoir qu'elle n'ose pas, elle, traiter en ennemi et qui lui ravit un à un les plus malins d'entre ses éléments. Quant à l'extrême gauche à-la-Besancenot, quels que soient ses scores électoraux, et même sortie de l'état groupusculaire où elle végète depuis toujours, elle n'a pas de perspective plus désirable à offrir que la grisaille soviétique à peine retouchée sur Photoshop. Son destin est de décevoir.
Dans la sphère de la représentation politique, le pouvoir en place n'a donc rien à craindre, de personne. Et ce ne sont certainement pas les bureaucraties syndicales, plus vendues que jamais, qui vont l'importuner, elles qui depuis deux ans dansent avec le gouvernement un ballet si obscène. Dans ces conditions, la seule force qui soit à même de faire pièce au gang sarkozyste, son seul ennemi réel dans ce pays, c'est la rue, la rue et ses vieux penchants révolutionnaires. Elle seule, en fait, dans les émeutes qui ont suivi le second tour du rituel plébiscitaire de mai 2007, a su se hisser un instant à la hauteur de la situation. Elle seule, aux Antilles ou dans les récentes occupations d'entreprises ou de facs, a su faire entendre une autre parole.
Cette analyse sommaire du théâtre des opérations a dû s'imposer assez tôt puisque les renseignements généraux faisaient paraître dès juin 2007, sous la plume de journalistes aux ordres (et notamment dans Le Monde) les premiers articles dévoilant le terrible péril que feraient peser sur toute vie sociale les "anarcho-autonomes". On leur prêtait, pour commencer, l'organisation des émeutes spontanées, qui ont, dans tant de villes, salué le "triomphe électoral" du nouveau président.
Avec cette fable des "anarcho-autonomes", on a dessiné le profil de la menace auquel la ministre de l'intérieur s'est docilement employée, d'arrestations ciblées en rafles médiatiques, à donner un peu de chair et quelques visages. Quand on ne parvient plus à contenir ce qui déborde, on peut encore lui assigner une case et l'y incarcérer. Or celle de "casseur" où se croisent désormais pêle-mêle les ouvriers de Clairoix, les gamins de cités, les étudiants bloqueurs et les manifestants des contre-sommets, certes toujours efficace dans la gestion courante de la pacification sociale, permet de criminaliser des actes, non des existences. Et il est bien dans l'intention du nouveau pouvoir de s'attaquer à l'ennemi, en tant que tel, sans attendre qu'il s'exprime. Telle est la vocation des nouvelles catégories de la répression.
Il importe peu, finalement, qu'il ne se trouve personne en France pour se reconnaître "anarcho-autonome" ni que l'ultra-gauche soit un courant politique qui eut son heure de gloire dans les années 1920 et qui n'a, par la suite, jamais produit autre chose que d'inoffensifs volumes de marxologie. Au reste, la récente fortune du terme "ultragauche" qui a permis à certains journalistes pressés de cataloguer sans coup férir les émeutiers grecs de décembre dernier doit beaucoup au fait que nul ne sache ce que fut l'ultragauche, ni même qu'elle ait jamais existé.
A ce point, et en prévision des débordements qui ne peuvent que se systématiser face aux provocations d'une oligarchie mondiale et française aux abois, l'utilité policière de ces catégories ne devrait bientôt plus souffrir de débats. On ne saurait prédire, cependant, lequel d'"anarcho-autonome" ou d'"ultragauche" emportera finalement les faveurs du Spectacle, afin de reléguer dans l'inexplicable une révolte que tout justifie.
La police vous considère comme le chef d'un groupe sur le point de basculer dans le terrorisme. Qu'en pensez-vous?
Une si pathétique allégation ne peut être le fait que d'un régime sur le point de basculer dans le néant.
Que signifie pour vous le mot terrorisme?
Rien ne permet d'expliquer que le département du renseignement et de la sécurité algérien suspecté d'avoir orchestré, au su de la DST, la vague d'attentats de 1995 ne soit pas classé parmi les organisations terroristes internationales. Rien ne permet d'expliquer non plus la soudaine transmutation du "terroriste" en héros à la Libération, en partenaire fréquentable pour les accords d'Evian, en policier irakien ou en "taliban modéré" de nos jours, au gré des derniers revirements de la doctrine stratégique américaine.
Rien, sinon la souveraineté. Est souverain, en ce monde, qui désigne le terroriste. Qui refuse d'avoir part à cette souveraineté se gardera bien de répondre à votre question. Qui en convoitera quelques miettes s'exécutera avec promptitude. Qui n'étouffe pas de mauvaise foi trouvera un peu instructif le cas de ces deux ex – "terroristes" devenus l'un premier ministre d'Israël, l'autre président de l'Autorité palestinienne, et ayant tous deux reçus, pour comble, le Prix Nobel de la paix.
Le flou qui entoure la qualification de "terrorisme", l'impossibilité manifeste de le définir ne tiennent pas à quelque provisoire lacune de la législation française : ils sont au principe de cette chose que l'on peut, elle, très bien définir : l'antiterrorisme dont ils forment plutôt la condition de fonctionnement. L'antiterrorisme est une technique de gouvernement qui plonge ses racines dans le vieil art de la contre-insurrection, de la guerre dite "psychologique", pour rester poli.
L'antiterrorisme, contrairement à ce que voudrait insinuer le terme, n'est pas un moyen de lutter contre le terrorisme, c'est la méthode par quoi l'on produit, positivement, l'ennemi politique en tant que terroriste. Il s'agit, par tout un luxe de provocations, d'infiltrations, de surveillance, d'intimidation et de propagande, par toute une science de la manipulation médiatique, de l'"action psychologique", de la fabrication de preuves et de crimes, par la fusion aussi du policier et du judiciaire, d'anéantir la "menace subversive" en associant, au sein de la population, l'ennemi intérieur, l'ennemi politique à l'affect de la terreur.
L'essentiel, dans la guerre moderne, est cette "bataille des cœurs et des esprits" où tous les coups sont permis. Le procédé élémentaire, ici, est invariable : individuer l'ennemi afin de le couper du peuple et de la raison commune, l'exposer sous les atours du monstre, le diffamer, l'humilier publiquement, inciter les plus vils à l'accabler de leurs crachats, les encourager à la haine. "La loi doit être utilisée comme simplement une autre arme dans l'arsenal du gouvernement et dans ce cas ne représente rien de plus qu'une couverture de propagande pour se débarrasser de membres indésirables du public. Pour la meilleure efficacité, il conviendra que les activités des services judiciaires soient liées à l'effort de guerre de la façon la plus discrète possible", conseillait déjà, en 1971, le brigadier Frank Kitson [ancien général de l'armée britannique, théoricien de la guerre contre-insurrectionelle], qui en savait quelque chose.
Une fois n'est pas coutume, dans notre cas, l'antiterrorisme a fait un four. On n'est pas prêt, en France, à se laisser terroriser par nous. La prolongation de ma détention pour une durée "raisonnable" est une petite vengeance bien compréhensible au vu des moyens mobilisés, et de la profondeur de l'échec; comme est compréhensible l'acharnement un peu mesquin des "services", depuis le 11 novembre, à nous prêter par voie de presse les méfaits les plus fantasques, ou à filocher le moindre de nos camarades. Combien cette logique de représailles a d'emprise sur l'institution policière, et sur le petit cœur des juges, voilà ce qu'auront eu le mérite de révéler, ces derniers temps, les arrestations cadencées des "proches de Julien Coupat".
Il faut dire que certains jouent, dans cette affaire, un pan entier de leur lamentable carrière, comme Alain Bauer [criminologue], d'autres le lancement de leurs nouveaux services, comme le pauvre M. Squarcini [directeur central du renseignement intérieur], d'autres encore la crédibilité qu'ils n'ont jamais eue et qu'ils n'auront jamais, comme Michèle Alliot-Marie.
Vous êtes issu d'un milieu très aisé qui aurait pu vous orienter dans une autre direction…
"Il y a de la plèbe dans toutes les classes" (Hegel).
Pourquoi Tarnac?
Allez-y, vous comprendrez. Si vous ne comprenez pas, nul ne pourra vous l'expliquer, je le crains.
Vous définissez-vous comme un intellectuel? Un philosophe ?
La philosophie naît comme deuil bavard de la sagesse originaire. Platon entend déjà la parole d'Héraclite comme échappée d'un monde révolu. A l'heure de l'intellectualité diffuse, on ne voit pas ce qui pourrait spécifier "l'intellectuel", sinon l'étendue du fossé qui sépare, chez lui, la faculté de penser de l'aptitude à vivre. Tristes titres, en vérité, que cela. Mais, pour qui, au juste, faudrait-il se définir?
Etes-vous l'auteur du livre L'insurrection qui vient ?
C'est l'aspect le plus formidable de cette procédure : un livre versé intégralement au dossier d'instruction, des interrogatoires où l'on essaie de vous faire dire que vous vivez comme il est écrit dans L'insurrection qui vient, que vous manifestez comme le préconise L'insurrection qui vient, que vous sabotez des lignes de train pour commémorer le coup d'Etat bolchevique d'octobre 1917, puisqu'il est mentionné dans L'insurrection qui vient, un éditeur convoqué par les services antiterroristes.
De mémoire française, il ne s'était pas vu depuis bien longtemps que le pouvoir prenne peur à cause d'un livre. On avait plutôt coutume de considérer que, tant que les gauchistes étaient occupés à écrire, au moins ils ne faisaient pas la révolution. Les temps changent, assurément. Le sérieux historique revient.
Ce qui fonde l'accusation de terrorisme, nous concernant, c'est le soupçon de la coïncidence d'une pensée et d'une vie; ce qui fait l'association de malfaiteurs, c'est le soupçon que cette coïncidence ne serait pas laissée à l'héroïsme individuel, mais serait l'objet d'une attention commune. Négativement, cela signifie que l'on ne suspecte aucun de ceux qui signent de leur nom tant de farouches critiques du système en place de mettre en pratique la moindre de leurs fermes résolutions; l'injure est de taille. Malheureusement, je ne suis pas l'auteur de L'insurrection qui vient – et toute cette affaire devrait plutôt achever de nous convaincre du caractère essentiellement policier de la fonction auteur.
J'en suis, en revanche, un lecteur. Le relisant, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai mieux compris la hargne hystérique que l'on met, en haut lieu, à en pourchasser les auteurs présumés. Le scandale de ce livre, c'est que tout ce qui y figure est rigoureusement, catastrophiquement vrai, et ne cesse de s'avérer chaque jour un peu plus. Car ce qui s'avère, sous les dehors d'une "crise économique", d'un "effondrement de la confiance", d'un "rejet massif des classes dirigeantes", c'est bien la fin d'une civilisation, l'implosion d'un paradigme : celui du gouvernement, qui réglait tout en Occident – le rapport des êtres à eux-mêmes non moins que l'ordre politique, la religion ou l'organisation des entreprises. Il y a, à tous les échelons du présent, une gigantesque perte de maîtrise à quoi aucun maraboutage policier n'offrira de remède.
Ce n'est pas en nous transperçant de peines de prison, de surveillance tatillonne, de contrôles judiciaires, et d'interdictions de communiquer au motif que nous serions les auteurs de ce constat lucide, que l'on fera s'évanouir ce qui est constaté. Le propre des vérités est d'échapper, à peine énoncées, à ceux qui les formulent. Gouvernants, il ne vous aura servi de rien de nous assigner en justice, tout au contraire.
Vous lisez "Surveiller et punir" de Michel Foucault. Cette analyse vous paraît-elle encore pertinente?
La prison est bien le sale petit secret de la société française, la clé, et non la marge des rapports sociaux les plus présentables. Ce qui se concentre ici en un tout compact, ce n'est pas un tas de barbares ensauvagés comme on se plaît à le faire croire, mais bien l'ensemble des disciplines qui trament, au-dehors, l'existence dite "normale". Surveillants, cantine, parties de foot dans la cour, emploi du temps, divisions, camaraderie, baston, laideur des architectures : il faut avoir séjourné en prison pour prendre la pleine mesure de ce que l'école, l'innocente école de la République, contient, par exemple, de carcéral.
Envisagée sous cet angle imprenable, ce n'est pas la prison qui serait un repaire pour les ratés de la société, mais la société présente qui fait l'effet d'une prison ratée. La même organisation de la séparation, la même administration de la misère par le shit, la télé, le sport, et le porno règne partout ailleurs avec certes moins de méthode. Pour finir, ces hauts murs ne dérobent aux regards que cette vérité d'une banalité explosive : ce sont des vies et des âmes en tout point semblables qui se traînent de part et d'autre des barbelés et à cause d'eux.
Si l'on traque avec tant d'avidité les témoignages "de l'intérieur" qui exposeraient enfin les secrets que la prison recèle, c'est pour mieux occulter le secret qu'elle est : celui de votre servitude, à vous qui êtes réputés libres tandis que sa menace pèse invisiblement sur chacun de vos gestes.
Toute l'indignation vertueuse qui entoure la noirceur des geôles françaises et leurs suicides à répétition, toute la grossière contre-propagande de l'administration pénitentiaire qui met en scène pour les caméras des matons dévoués au bien-être du détenu et des directeurs de tôle soucieux du "sens de la peine", bref : tout ce débat sur l'horreur de l'incarcération et la nécessaire humanisation de la détention est vieux comme la prison. Il fait même partie de son efficace, permettant de combiner la terreur qu'elle doit inspirer avec son hypocrite statut de châtiment "civilisé". Le petit système d'espionnage, d'humiliation et de ravage que l'Etat français dispose plus fanatiquement qu'aucun autre en Europe autour du détenu n'est même pas scandaleux. L'Etat le paie chaque jour au centuple dans ses banlieues, et ce n'est de toute évidence qu'un début : la vengeance est l'hygiène de la plèbe.
Mais la plus remarquable imposture du système judiciaro-pénitentiaire consiste certainement à prétendre qu'il serait là pour punir les criminels quand il ne fait que gérer les illégalismes. N'importe quel patron – et pas seulement celui de Total –, n'importe quel président de conseil général – et pas seulement celui des Hauts-de-Seine–, n'importe quel flic sait ce qu'il faut d'illégalismes pour exercer correctement son métier. Le chaos des lois est tel, de nos jours, que l'on fait bien de ne pas trop chercher à les faire respecter et les stups, eux aussi, font bien de seulement réguler le trafic, et non de le réprimer, ce qui serait socialement et politiquement suicidaire.
Le partage ne passe donc pas, comme le voudrait la fiction judiciaire, entre le légal et l'illégal, entre les innocents et les criminels, mais entre les criminels que l'on juge opportun de poursuivre et ceux qu'on laisse en paix comme le requiert la police générale de la société. La race des innocents est éteinte depuis longtemps, et la peine n'est pas à ce à quoi vous condamne la justice : la peine, c'est la justice elle-même, il n'est donc pas question pour mes camarades et moi de "clamer notre innocence", ainsi que la presse s'est rituellement laissée aller à l'écrire, mais de mettre en déroute l'hasardeuse offensive politique que constitue toute cette infecte procédure. Voilà quelques-unes des conclusions auxquelles l'esprit est porté à relire Surveiller et punir depuis la Santé. On ne saurait trop suggérer, au vu de ce que les Foucaliens font, depuis vingt ans, des travaux de Foucault, de les expédier en pension, quelque temps, par ici.
Comment analysez-vous ce qui vous arrive?
Détrompez-vous : ce qui nous arrive, à mes camarades et à moi, vous arrive aussi bien. C'est d'ailleurs, ici, la première mystification du pouvoir : neuf personnes seraient poursuivies dans le cadre d'une procédure judiciaire "d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste", et devraient se sentir particulièrement concernées par cette grave accusation. Mais il n'y a pas d'"affaire de Tarnac" pas plus que d'"affaire Coupat", ou d'"affaire Hazan" [éditeur de L'insurrection qui vient]. Ce qu'il y a, c'est une oligarchie vacillante sous tous rapports, et qui devient féroce comme tout pouvoir devient féroce lorsqu'il se sent réellement menacé. Le Prince n'a plus d'autre soutien que la peur qu'il inspire quand sa vue n'excite plus dans le peuple que la haine et le mépris.
Ce qu'il y a, c'est, devant nous, une bifurcation, à la fois historique et métaphysique: soit nous passons d'un paradigme de gouvernement à un paradigme de l'habiter au prix d'une révolte cruelle mais bouleversante, soit nous laissons s'instaurer, à l'échelle planétaire, ce désastre climatisé où coexistent, sous la férule d'une gestion "décomplexée", une élite impériale de citoyens et des masses plébéiennes tenues en marge de tout. Il y a donc, bel et bien, une guerre, une guerre entre les bénéficiaires de la catastrophe et ceux qui se font de la vie une idée moins squelettique. Il ne s'est jamais vu qu'une classe dominante se suicide de bon cœur.
La révolte a des conditions, elle n'a pas de cause. Combien faut-il de ministères de l'Identité nationale, de licenciements à la mode Continental, de rafles de sans-papiers ou d'opposants politiques, de gamins bousillés par la police dans les banlieues, ou de ministres menaçant de priver de diplôme ceux qui osent encore occuper leur fac, pour décider qu'un tel régime, même installé par un plébiscite aux apparences démocratiques, n'a aucun titre à exister et mérite seulement d'être mis à bas ? C'est une affaire de sensibilité.
La servitude est l'intolérable qui peut être infiniment tolérée. Parce que c'est une affaire de sensibilité et que cette sensibilité-là est immédiatement politique (non en ce qu'elle se demande "pour qui vais-je voter ?", mais "mon existence est-elle compatible avec cela ?"), c'est pour le pouvoir une question d'anesthésie à quoi il répond par l'administration de doses sans cesse plus massives de divertissement, de peur et de bêtise. Et là où l'anesthésie n'opère plus, cet ordre qui a réuni contre lui toutes les raisons de se révolter tente de nous en dissuader par une petite terreur ajustée.
Nous ne sommes, mes camarades et moi, qu'une variable de cet ajustement-là. On nous suspecte comme tant d'autres, comme tant de "jeunes", comme tant de "bandes", de nous désolidariser d'un monde qui s'effondre. Sur ce seul point, on ne ment pas. Heureusement, le ramassis d'escrocs, d'imposteurs, d'industriels, de financiers et de filles, toute cette cour de Mazarin sous neuroleptiques, de Louis Napoléon en version Disney, de Fouché du dimanche qui pour l'heure tient le pays, manque du plus élémentaire sens dialectique. Chaque pas qu'ils font vers le contrôle de tout les rapproche de leur perte. Chaque nouvelle "victoire" dont ils se flattent répand un peu plus vastement le désir de les voir à leur tour vaincus. Chaque manœuvre par quoi ils se figurent conforter leur pouvoir achève de le rendre haïssable. En d'autres termes : la situation est excellente. Ce n'est pas le moment de perdre courage.
Propos recueillis par Isabelle Mandraud et Caroline Monnot
Article paru dans Le Monde du 26.05.09
15:06 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
04/04/2009
OTAN, le choix ontologique
Le choix de notre pleine réintégration du commandement "intégré" de l'OTAN soulève non seulement des questions stratégiques mais une interrogation relative à notre être. Qui sommes-nous, la France et l'Europe par la France? Un continent à la recherche de son identité et de sa puissance, ou la mémère de l'Occident à la remorque d'un fils vigoureux mais un peu con? Il est regrettable de conclure que la seconde réponse est sans doute la plus réaliste et que notre grand garçon boutonneux et spermatique est mieux à même que nous d'assurer notre défense... en attendant les Jaunes (ou les Verts, ou la grande dégrinrigolade).
05:28 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
03/11/2008
Nouvelle stratégie militaire américaine
19:54 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
18/07/2008
Le droit des enfants de voter
 Qu'est-ce que le suffrage universel? La question a été régulièrement posée depuis que le principe et sa différance, forment l'horizon de notre démocratie. Au nom du peuple, oui, mais lequel? Condorcet avait déjà fait ce rêve, fou, de vouloir reconnaître le droit de suffrage aux femmes et de préparer les enfants, ce véritable dauphin démocratique, à leurs charges futures. Au nom du droit des génération future, cette anticipation de la souveraineté populaire, à la pointe de la flêche du temps, un groupe de députés allemands. Intitulée "Donner une voix à l'avenir Pour le droit de vote dès la naissance", a introduit une motion introduite au Bundestag proposant le droit de vote des nouveaux-nés. Les 46 élus sociaux-démocrates (SPD), conservateurs (CDU-CSU) et libéraux (FDP) demandent que le gouvernement soumette une proposition de loi pour mettre fin à une situation où "14 millions de citoyens allemands sont exclus du droit de vote, et ce en raison de leur âge uniquement". Il appartiendrait aux parents de l'exercer en leur nom jusqu'à ce que les jeunes se sentent assez "mûrs".
Qu'est-ce que le suffrage universel? La question a été régulièrement posée depuis que le principe et sa différance, forment l'horizon de notre démocratie. Au nom du peuple, oui, mais lequel? Condorcet avait déjà fait ce rêve, fou, de vouloir reconnaître le droit de suffrage aux femmes et de préparer les enfants, ce véritable dauphin démocratique, à leurs charges futures. Au nom du droit des génération future, cette anticipation de la souveraineté populaire, à la pointe de la flêche du temps, un groupe de députés allemands. Intitulée "Donner une voix à l'avenir Pour le droit de vote dès la naissance", a introduit une motion introduite au Bundestag proposant le droit de vote des nouveaux-nés. Les 46 élus sociaux-démocrates (SPD), conservateurs (CDU-CSU) et libéraux (FDP) demandent que le gouvernement soumette une proposition de loi pour mettre fin à une situation où "14 millions de citoyens allemands sont exclus du droit de vote, et ce en raison de leur âge uniquement". Il appartiendrait aux parents de l'exercer en leur nom jusqu'à ce que les jeunes se sentent assez "mûrs".
L'idée n'est pas nouvelle. Elle a pour la première fois été esquissée par Carl Friedrich Goerdeler (un résistant antinazi décapité en février 1945), dans un manifeste sur l'avenir politique de l'Allemagne rédigé en prison. Elle participe d'une volonté d'émancipation des enfants qui va de l'abaissement de la majorité sexuelle, au droit des enfants d'avoir des relations sexuelles avec des adultes (Pays-Bas) ou du droit pour les enfants malades en stade terminal de décider de leur euthanasie (Pays-Bas encore). Bref, elle participe d'une émancipation des enfants et d'une relativisation de leur minorité (en l'occurence, il n'y en aurait plus).
Mais en Allemagne cette revendication des enfants pour l'exercice des droits civiques complet a fait l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle. En 1995, Benjamin Kiesewetter et Rainer Kintzel, qui avaient alors 15 et 12 ans, ont saisi la Cour constitutionnelle d'une plainte dans laquelle ils faisaient valoir que la limitation de l'âge du droit de vote à "dix-huit ans révolus" dans l'article 38 de la loi fondamentale contredisait l'article 20, de portée plus générale, aux termes duquel "tout pouvoir d'État émane du peuple", en arguant qu'ils étaient aussi "du peuple". La discrimination contre les jeunes de leur naissance à leur majorité était ici mise en cause. Les juges de Karlsruhe avaient refusé d'examiner leur plainte, mais pour des raisons de forme, la contestation d'une loi devant intervenir au plus tard un an après son adoption.
Nouvel essai en 1998, avant les législatives. Robert Rostoski, avant ses 18 ans, essaie de se faire inscrire sur les listes électorales à Berlin. Il fait appel du refus et, cette fois-ci, la Cour constitutionnelle le déboute sur le fond.
Le Bundestag entre en jeu en 2003 lorsque 47 députés dont le président Wolfgang Thierse (SPD) relancent l'idée. Ils font notamment valoir l'inéluctable vieillissement démographique de la population qui, disent-ils, conduira les responsables politiques à délaisser les intérêts des jeunes pour satisfaire les desiderata d'un électorat vieux de plus en plus important. "Il y a deux cents ans, relevait alors le député FDP Klaus Haupt, personne ne pouvait imaginer que tout citoyen mâle aurait le droit de vote, il y a cent ans personne ne pensait que les femmes allaient l'obtenir."
La discussion au Bundestag qui a suivi cette initiative, tout comme l'introduction d'un projet de loi en 2005 par le même groupe n'ont cependant pas fait avancer la cause de ceux que l'hebdomadaire Der Spiegel a appelés les "électeurs en Pampers". Sauf miracle, ce sera encore le cas cette fois-ci.
Si le droit de vote était un jour reconnu aux enfants, plusieurs conséquences paradoxales en découleraient. D'abord, l'exercice de ce vote, du moins pour les plus petits, serait assuré par les parents ou par le titulaire de l'autorité parentale. On ressuciterait l suffrage plural, en vigueur en Belgique en 1899, et permettant au chef de famille de voter plusieurs fois, selon un coéficient qui égalerait le nombre de ses enfants. Dans l'hypothèse d'un divorce, la femme étant le plus souvent titulaire du droit de garde, exercerait le droit de vote, de sorte que l'on aboutirait à une féminisation du vote contraire au principe de la parité. Mais surtout, ne serait-on pas ammené à étendre le droit de vote aux embryons, en application de l'adage bien connu et ici même rappelé il y a quelques semaines: infans conceptus pro nato habetur, l'enfant conçu est présumé né (chaque fois qu'il y va de son intérêt). Ainsi, ce ne sont plus les morts que l'on ferait voter, comme autrefois Barrès, ce ventriloque des tombeaux, ou, avec moins de talent, Tiberi, mais des âmes sans corps, de purs esprits invoqués le jour du suffrage, des idées d'enfants. Isoloirs, isoloirs, avez-vous donc une âme? La fiction de la démocratie apparait enfin au grand jours...
14:45 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
16/07/2008
Le droit de porter la burqa
 "La burqa est-elle incompatible avec la nationalité française ?" Posée ainsi, comme le fait Le Monde dans son édition du jour, la question est polémique. Mais ainsi: "une certaine pratique de la religion est-elle incompatible avec les principes de la République ?" La réponse est évidente. Pas besoin d'être bon républicain ou militant laïcard pour y répondre. Une Marocaine de 32 ans, mariée à un Français et mère de trois enfants nés en France, s'est récemment heurtée à cette barrière conceptuelle et s'est vue refuser la nationalité au motif qu'elle "a adopté, au nom d'une pratique radicale de sa religion, un comportement en société incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment le principe d'égalité des sexes". Ce n'est pas la première fois que le degré de pratique religieuse est pris en compte pour se prononcer sur la capacité d'assimilation d'une personne étrangère, mais c'est la première fois qu'une pratique purement privée, sans menace de trouble à l'ordre public, est prise en compte de manière aussi caractérisée. Jusqu'à présent seules des personnes jugées proches de mouvements fondamentalistes ou ayant publiquement tenu des propos relevant de l'islam radical se sont vu refuser la nationalité française. Mais dans le cas de Faiza M., ce sont sa tenue vestimentaire et sa vie privée qui sont seules prises en considération pour lui refuser la nationalité française. Alors que depuis son arrivée en France elle n'a jamais "jamais cherché à remettre en cause les valeurs fondamentales de la République ", qu'elle n'a pris aucune position publique, qu'elle ne s'est pas non plus refusé à être examinée par un gynécologue homme lors de ses deux grossesses, mais sur le seul fait objectif de son adhésion aux principes de l'islam radical, M. M. se voit refuser l'acquisition de la nationalité française alors que, par ailleurs, elle remplit toutes les autres conditions, y compris de maîtrise de la langue française. La liberté de conscience trouve ici sa limite dans un défaut d'assimilation qui lui est reproché.
"La burqa est-elle incompatible avec la nationalité française ?" Posée ainsi, comme le fait Le Monde dans son édition du jour, la question est polémique. Mais ainsi: "une certaine pratique de la religion est-elle incompatible avec les principes de la République ?" La réponse est évidente. Pas besoin d'être bon républicain ou militant laïcard pour y répondre. Une Marocaine de 32 ans, mariée à un Français et mère de trois enfants nés en France, s'est récemment heurtée à cette barrière conceptuelle et s'est vue refuser la nationalité au motif qu'elle "a adopté, au nom d'une pratique radicale de sa religion, un comportement en société incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté française, et notamment le principe d'égalité des sexes". Ce n'est pas la première fois que le degré de pratique religieuse est pris en compte pour se prononcer sur la capacité d'assimilation d'une personne étrangère, mais c'est la première fois qu'une pratique purement privée, sans menace de trouble à l'ordre public, est prise en compte de manière aussi caractérisée. Jusqu'à présent seules des personnes jugées proches de mouvements fondamentalistes ou ayant publiquement tenu des propos relevant de l'islam radical se sont vu refuser la nationalité française. Mais dans le cas de Faiza M., ce sont sa tenue vestimentaire et sa vie privée qui sont seules prises en considération pour lui refuser la nationalité française. Alors que depuis son arrivée en France elle n'a jamais "jamais cherché à remettre en cause les valeurs fondamentales de la République ", qu'elle n'a pris aucune position publique, qu'elle ne s'est pas non plus refusé à être examinée par un gynécologue homme lors de ses deux grossesses, mais sur le seul fait objectif de son adhésion aux principes de l'islam radical, M. M. se voit refuser l'acquisition de la nationalité française alors que, par ailleurs, elle remplit toutes les autres conditions, y compris de maîtrise de la langue française. La liberté de conscience trouve ici sa limite dans un défaut d'assimilation qui lui est reproché.
Quels sont les éléments constitutifs de ce défaut d'assimilation? D'après le commissaire du gouvernement, Emmanuelle Prada-Bordenave, la tenue de Faiza M est un premier élément. A trois reprises, Faiza M. se serait présentée "recouverte du vêtement des femmes de la péninsule arabique, longue robe tombant jusqu'aux pieds, voile masquant les cheveux, le front et le menton et une pièce de tissu masquant le visage et ne laissant voir les yeux que par une fente". Par ailleurs, le couple reconnaît "spontanément" son appartenance au salafisme. Mais c'est peut être l'évolution même de Faiza M. qui a retenu l'attention du commissaire du gouvernement, une évolution personnelle qui ne va pas dans le sens d'une adhésion aux principes de la République. Faiza M. a en effet reconnu qu'elle n'était pas voilée quand elle vivait au Maroc et a indiqué "qu'elle n'a adopté ce costume qu'après son arrivée en France à la demande de son mari et qu'elle le porte plus par habitude que par conviction". Enfin "D'après ses propres déclarations, a souligné la commissaire du gouvernement, elle mène une vie presque recluse et retranchée de la société française. Elle n'a aucune idée sur la laïcité ou le droit de vote. Elle vit dans la soumission totale aux hommes de sa famille ." Faiza M. semble "trouver cela normal et l'idée même de contester cette soumission ne l'effleure même pas", a ajouté Mme Prada-Bordenave, estimant que ces déclarations sont "révélatrices de l'absence d'adhésion à certaines valeurs fondamentales de la société française".
Cette décision montre bien que la liberté de conscience, comme l'ensemble des libertés, que l'on présente généralement comme des droits fondamentaux, inaliénables, naturels, intangibles, irrévocables, etc, ne sont que des permissions de l'Etat. D'un Etat plus ou moins tolérant, certes, plus ou moins libéral, mais qui n'accorde de libertés qu'autant qu'elles sont compatibles avec l'ordre public, lequel ne s'entend pas seulement comme un ordre matériel mais comme un ordre spirituel. La brave Faiza M. ne fait de tort à personne en vivant chez elle recluse et soumise, mais elle porte atteinte aux consciences et à l'ordre public spirituel qui découle de nos principes républicains et cette seule interférence avec le monde des idées suffit à justifier son exclusion de la communauté nationale.
On ajoutera que dans la présente affaire, la nationalité française a été refusée à Faiza M. mais que rien, absolument rien ne s'opposerait demain à ce que la nationalité française soit retirée à une personne portant un tel trouble à l'ordre public spirituel et aux consciences. Toute communauté, pour se définir comme communauté, génère ses propres limites et trace une frontière spirituelle qui réfute tous les cosmopolitismes. Le Conseil d'Etat vient de retrouver ainsi, dans les méandre d'une jurisprudence compliquée mais en pleine évolution, le vieux principe de la constitution des solidarités: Mme Faiza n'est pas des nôtres. Il n'en a pas tiré les conclusions qu'il aurait pu en tirer parce que la velléité succède à la décision: "sa vie n'est pas ici". Mais, dans la stupeur de notre déclin, il a rappelé le vieux principe de l'amitié et de l'inimitié.
17:08 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
25/08/2007
L'égalité des mamifrères
 Une initiative populaire fédérale propose la modification de la Constitution et l’inscription dans le texte fondamental d’une obligation de protéger les animaux et d’assurer la défense de leurs droits par un avocat.
Une initiative populaire fédérale propose la modification de la Constitution et l’inscription dans le texte fondamental d’une obligation de protéger les animaux et d’assurer la défense de leurs droits par un avocat.
Cette initiative, dont la date limite était fixée au 15 mai 2007, a réuni plus de 100.000 suffrages et vient d’être déclarée valable par la Chancellerie fédérale. Elle propose l’insertion d’un article 80, al. 4 et 5 (nouveaux) dans le texte constitutionnel :
Art. 80 al. 4 - La Confédération édicte des dispositions sur la protection des animaux en tant qu'êtres vivants doués de sensations.
Art. 80 al. 5 - En cas de procédures pénales motivées par des mauvais traitements envers des animaux ou par d'autres violations de la législation sur la protection des animaux, un avocat de la protection des animaux défendra les intérêts des animaux maltraités. Plusieurs cantons peuvent désigner un avocat de la protection des animaux commun.
10:00 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)
15/11/2005
Au nom du peuple
Au nom du peuple
Qui a le dernier mot en matière constitutionnelle ?
Larry Kramer
Publié dans le numéro de février-mars 2004 de la Boston Review
trad. fçse Valentine Fouache
[Cet article de Larry Kramer, l’un des plus grands constitutionnalistes américains actuels, doyen de la Law School de l’Université de Stanford, offre au lecteur français une véritable réflexion sur le rôle de la Cour Suprême américaine ainsi qu’une violente remise en cause de son autorité. L’auteur ne se permet une telle remise en cause qu’au terme d’une étude approfondie de la conception du rôle de la Cour-Suprême aux Etats-Unis de 1787 à nos jours, fondée à la fois sur l’histoire, le droit, la politique et la doctrine. Larry Kramer constate en effet que l’ensemble du peuple américain accepte aujourd’hui que cette juridiction possède l’autorité ultime en matière constitutionnelle, ce qui lui permet de rendre des décisions dont les conséquences sur la vie quotidienne des américains sont essentielles. Mais il s’emploie à démontrer qu’une telle conviction est tout sauf ancrée dans son histoire et qu’elle a en réalité toujours été au service de ceux qui souhaitaient, pour des motifs idéologiques, refuser au peuple l’exercice du pouvoir. Selon lui, il est étonnant que, de nos jours, elle rencontre une telle adhésion et il invite par conséquent les américains à s’interroger sur leur rôle politique, ainsi que sur leur passivité à l’égard d’une juridiction dont l’autorité ultime en matière constitutionnelle n’est pas pour lui une nécessité.]
Qui a le dernier mot lorsqu’il s’agit de déterminer le sens du texte constitutionnel ? Qui décide en dernier ressort si un Etat est compétent pour réglementer ou interdire l’avortement ? Ou si le Congrès peut légiférer en matière de protection des personnes âgées ou des handicapés ? Qui détermine quel est le vainqueur d’une élection présidentielle contestée ? Sur ces sujets et bien d’autres, d’une importance essentielle pour la société, la réponse, ces dernières années, a été la Cour Suprême. En effet, si l’on en croit des études récentes, telle était, selon la plupart des individus, l’intention de nos Pères fondateurs. Et la plupart des américains semblent désireux, et même satisfaits, d’en rester là. Ce que les avocats dénomment la " suprématie judiciaire ", - c’est à dire l’idée selon laquelle les juges décident en dernier ressort et pour l’ensemble de la population ce que la Constitution signifie - rencontre aujourd’hui largement les faveurs du public. Bien sûr, d’autres intervenants ont leur mot à dire. Le sens du texte constitutionnel peut faire l’objet d’opinions de la part du Président, du Congrès, des Etats et des citoyens. Mais les juges décident si ces derniers ont raison ou tort, et les arrêts des juges sont censés régler les questions pour tout le monde, ne s’inclinant que devant la procédure formelle de l’amendement, impossible en pratique.
Il n’en a pas toujours été ainsi. Au contraire, et étonnamment, la suprématie judiciaire n’est largement acceptée que depuis peu de temps, puisqu’il s’agit d’une évolution qui ne date véritablement que du début des années soixante et qui ne parvint à maturité que dans les années quatre-vingts. Il ne fait aucun doute que les hommes et les femmes qui vécurent à l'époque de l’élaboration de la Constitution n’auraient pas accepté – et n’acceptaient pas – l’idée que la Constitution soit confiée à une élite juridique, et auraient douté si on leur avait dit (ce que l’on nous dit fréquemment aujourd’hui) que la principale raison de s’inquiéter de l’issue de l’élection présidentielle était la possibilité offerte au vainqueur de contrôler les nominations des juges. James Madison songeait en 1788 que le fait de confier à un corps de juges non-élus une telle importance et de les traiter avec tant d'égards " rend le pouvoir judiciaire suprême dans les faits ", " ce qui n’a jamais été prévu et ne pourra jamais être approprié ". La Constitution de la génération qui fut le témoin de son élaboration était une Constitution populaire : la charte du peuple, élaborée par le peuple. Et elle était, selon les propres termes de Madison, " le peuple lui-même " - œuvrant par l’intermédiaire de ses représentants au gouvernement et leur répondant - qui " seul peut énoncer le sens véritable [de la Constitution] et imposer son respect ". L’idée de transférer cette responsabilité à des juges était tout simplement inimaginable.
21:25 Publié dans Au nom du peuple | Lien permanent | Commentaires (0)



















