23/11/2014
Euthanasie
« L’euthanasie peut être un bon choix pour les pauvres, qui en raison de leur pauvreté n’ont pas accès à l’aide médicale », telle est la « solution » du problème des patients démunis proposée par le nouveau Ministre de la Santé de Lituanie Rimante Šalaševičiūtė, entrée en fonctions début juin. Elle a immédiatement engagé une discussion sur la légalisation de l’euthanasie en Lituanie, et a déclaré dans une interview que la Lituanie n’étant pas un Etat social, les soins palliatifs n’étaient pas accessibles à tous. C’est pourquoi l’euthanasie peut être un bon choix pour des gens qui « ne veulent pas infliger à leurs proches le spectacle de leurs souffrances ».
12:11 | Lien permanent | Commentaires (0)
05/11/2014
La Grande Europe entravée
 Le conflit qui se déroule depuis plusieurs mois en Ukraine est une parfaite illustration d’une constante de la géopolitique anglo-saxonne : s’opposer par tous les moyens à la constitution d’un bloc continental euro-russe.
Le conflit qui se déroule depuis plusieurs mois en Ukraine est une parfaite illustration d’une constante de la géopolitique anglo-saxonne : s’opposer par tous les moyens à la constitution d’un bloc continental euro-russe.
Cette stratégie très ancienne – elle remonte, en effet, au XVIIIe siècle, a été théorisée dès 1904 par H.J. Mackinder et complétée, beaucoup plus tard, par N. Spykman – s’est manifestée dans la politique de « containment » (« endiguement »), définie pendant la guerre froide par John Foster Dulles et appliquée sans interruption depuis lors. Elle est sous-jacente dans la pensée de Zbigniew Brzeziński telle qu’elle est exprimée dans Le Grand Échiquier. C’est elle qui inspire également le récent article de George Soros publié dans la presse européenne le 24 octobre dernier et qui présente l’Union européenne, selon ses propres termes, comme « de facto en guerre ». L’arrimage de l’Ukraine à l’Occident, son intégration dans l’OTAN et dans l’Union européenne sont alors conçus comme des moyens de déstabilisation et, à terme, de dislocation de la Russie.
Elle vise à organiser un cordon sanitaire continu depuis le Royaume-Uni jusqu’au Japon en passant par le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est. Elle a été conçue, bien avant la naissance de l’Union soviétique, et s’est poursuivie voire renforcée après sa chute.
Fondamentalement, c’est une stratégie d’interdiction de puissance et d’indépendance tournée contre l’avènement d’une « Grande Europe ».
Cette politique entraîne plusieurs conséquences.
La première est le maintien de l’isolement de la Russie post-soviétique toujours considérée chez certains responsables politiques américains comme étant potentiellement l’ennemi principal par :
– la diabolisation de ses dirigeants, Vladimir Poutine en particulier ;
– le renforcement technologique et militaire (bouclier antimissile, cyberdéfense, etc.) ;
– l’élargissement, ou plus précisément l’épaississement territorial du cordon sanitaire (extension continue de l’OTAN et recherche d’un contact direct avec la frontière russe, contrairement aux engagements qui semblent avoir été pris vis-à-vis du gouvernement soviétique lors de la chute du mur de Berlin).
En deuxième lieu, le renforcement, en réaction à cet encerclement, des relations terrestres continentales entre la Russie et la Chine (réseaux d’hydrocarbures, réseaux ferroviaires, TGV Pékin-Moscou, nouvelle route de la soie).
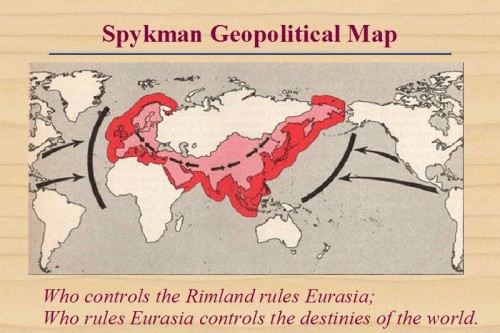 Troisièmement, la justification et sur-légitimation des liens naissants encore fragiles entre les BRICS en particulier par une stratégie de dédollarisation dans les échanges entre les différents partenaires préfigurant un contre-encerclement de revers : les assiégeants devenant assiégés.
Troisièmement, la justification et sur-légitimation des liens naissants encore fragiles entre les BRICS en particulier par une stratégie de dédollarisation dans les échanges entre les différents partenaires préfigurant un contre-encerclement de revers : les assiégeants devenant assiégés.
L’Europe, solidaire, puissante, indépendante et souveraine que nous appelons de nos vœux doit se construire en rupture avec cette situation en relançant le projet de partenariat euro-russe.
Ce partenariat prenant appui sur la continuité territoriale, la profondeur stratégique, la tradition, l’unité culturelle, l’immensité et la diversité des ressources, doit fonder l’un des éléments essentiels de la vision géopolitique d’une Europe redevenue souveraine.
Enfin, au-delà de ce partenariat strictement continental, une alliance plus vaste dans un cadre euro-BRICS doit être envisagée
Dans cette perspective, il ne s’agit pas, bien entendu, de passer d’une soumission à l’autre, mais de retrouver autonomie et liberté de manœuvre entre atlantisme béat et eurasisme angélique.
Il est consternant de constater que l’Union européenne, soixante-dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, confrontée à cette mutation économique et géopolitique majeure qui affecte le monde, n’ait pas été encore capable de saisir cette occasion pour se rendre maître d’un destin confisqué, de fait, depuis un siècle, et ait au contraire choisi de s’enfoncer un peu plus dans la vassalité.
Une fois de plus, le comportement chaotique et ambigu de la diplomatie des membres de l’Union européenne traduit l’absence totale de vision géopolitique de celle-ci. Pourtant, cette compétition multipolaire acharnée – le véritable visage de la mondialisation – n’est autre que la confrontation permanente des différentes visions géopolitiques des grands acteurs mondiaux.
Jean-Claude Empereur
16:17 | Lien permanent | Commentaires (0)
22/10/2014
Alain de Benoist appelle à une deuxième Révolution française
 La Manif pour tous (LMPT), dans sa dernière édition, a récemment rassemblé entre 80.000 et 500.000 personnes à Paris. Une bonne nouvelle, à votre avis ?
La Manif pour tous (LMPT), dans sa dernière édition, a récemment rassemblé entre 80.000 et 500.000 personnes à Paris. Une bonne nouvelle, à votre avis ?
On ne peut que se réjouir de voir défiler dans la rue des foules hostiles à un gouvernement dont la nocivité n’est plus à démontrer. Mais au-delà du spectacle ? Béatrice Bourges, fondatrice du Printemps français, était à la manifestation. « J’en suis revenue, a-t-elle déclaré, non pas galvanisée comme je l’espérais, mais triste et mal à l’aise ». Je la comprends. Toute la question, en effet, est de savoir si les manifestations sont une fin ou un moyen. Si c’est un moyen, le plus élémentaire des réalismes oblige à constater que celle de ces dernières semaines, tout comme les précédentes, n’a strictement rien obtenu : « La vérité oblige même à dire que nous avons tout perdu », dit encore Béatrice Bourges.
Je vois à cela deux raisons. La première est l’indécrottable naïveté, typiquement droitière et révélatrice d’une absence totale de sens politique, qui porte les animateurs de la Manif à mettre tous leurs espoirs dans « l’aile droite » de l’UMP – cette même UMP qui vient de porter à la tête de la commission des Affaires sociales du Sénat un partisan résolu du mariage gay, de la procréation médicalement assistée pour les lesbiennes et de la gestation pour autrui, en l’occurrence le sénateur Alain Milon. En oubliant que pratiquement toutes les réformes « sociétales » dont se plaignent aujourd’hui les membres de la Manif pour Tous ont historiquement été réalisées par la droite ! Qu’on en soit encore aujourd’hui à attendre de l’UMP qu’elle « sauve la famille » est plus que pathétique, c’est consternant.
L’autre raison va de pair avec la première. La Manif pour Tous est de plus en plus familiale et confessionnelle. Elle aligne de gentils manifestants bien corrects et se flatte « d’éviter tout débordement ». Si, ce qu’à Dieu ne plaise, elle se proposait de faire un sauter un train, je suis sûr que ses représentants commenceraient par acheter un ticket de quai ! Le problème, c’est que les braves gens ne sont pas forcément des gens braves, et qu’on ne fait pas la révolution avec des Bisounours bien élevés qui, après avoir défilé, rentrent sagement chez eux. Ce n’est pas en évitant les « débordements » que les Bonnets rouges ont fini par faire céder le gouvernement, mais au contraire en les multipliant ! Ce n’est pas en faisant des révérences (ou des génuflexions) que Farida Belghoul, désormais tenue à l’écart de la Manif pour Tous, a réussi ses « Journées de retrait de l’école ». Et ce n’est pas non plus avec des prières qu’on a dégonflé le grotesque plug anal géant érigé place Vendôme avec la bénédiction de la mairie de Paris !
Vous voulez dire que la Manif pour tous devrait être plus radicale ?
Je dis qu’il faut savoir ce que l’on veut, et surtout ce qui donne la possibilité d’obtenir ce que l’on veut. Etant de ceux qui pensent que nous avons moins besoin d’une VIe République que d’une seconde Révolution française, je crois aussi qu’il y a des jours où, plutôt que d’ouvrir son missel, on pourrait utilement relire les Réflexions sur la violence de Georges Sorel. On se rendrait alors compte que laisser les gens manifester, c’est aussi leur donner un exutoire permettant de faire l’économie d’une révolte populaire, et que ce n’est pas en tentant de créer un « lobby de la famille » qu’on peut faire émerger un mouvement social susceptible de s’imposer comme sujet historique.
Les mots d’ordre LMPT contre la marchandisation du corps humain trouvent quand même votre assentiment ?
J’applaudis même des deux mains. Mais encore faudrait-il comprendre que cette marchandisation n’est jamais que le point d’aboutissement d’un vaste processus entamé depuis plus d’un siècle, sur lequel les gens de droite sont en général restés parfaitement aveugles. À l’époque moderne, le capitalisme libéral a progressivement imposé dans les esprits le primat des valeurs marchandes sur toute autre sorte de valeur. La terre, le travail, l’art, le sport, la solidarité ont été peu à peu intégrés dans la sphère du calculable, du quantifiable et de l’évaluation comptable. La brevetabilité du vivant, la marchandisation de la procréation, la location des utérus, étaient déjà en germe dans cette évolution qui a conduit à considérer toutes les sphères de l’activité humaine comme assimilables à des marchés. Le capitalisme, bien avant d’être un système économique, est un « fait social total » (Marcel Mauss), qui véhicule avec lui toute une anthropologie fondée sur l’Homo œconomicus, c’est-à-dire sur un producteur-consommateur censé chercher en toute circonstance à maximiser son meilleur avantage matériel. Un tel être n’obéit qu’à des considérations égoïstes gouvernées par l’utilitarisme et l’axiomatique de l’intérêt. Or, la famille est l’un des derniers endroits où la logique du don l’emporte encore sur celle de l’échange. C’est bien de dénoncer la marchandisation du corps humain. Il serait encore mieux de réaliser qu’elle n’est jamais qu’une conséquence du fétichisme de la marchandise et du règne de l’argent.
12:49 | Lien permanent | Commentaires (0)
18/10/2014
Les mensonges de l'expérience Milgram
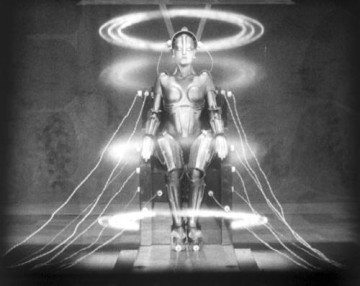 L’art de l’électrochoc: les mensonges de l’«expérience de Milgram»
L’art de l’électrochoc: les mensonges de l’«expérience de Milgram»
En poussant des quidams à électrocuter des innocents, Stanley Milgram réalisa en 1960 la plus célèbre des expériences psychologiques. Mais en plongeant dans ses archives, on découvre une réalité très différente de celle que le chercheur avait fabriquée…
Votre élève – un adulte de sexe masculin, de corpulence moyenne – est attaché à une chaise, des électrodes sont fixées à ses poignets. Il doit réussir un exercice de mémorisation portant sur des mots que vous prononcez à voix haute. Lorsqu’il se trompe, vous êtes prié de le corriger par des décharges électriques d’intensité croissante, de 15 à 450 volts, en actionnant une série d’interrupteurs. Telle est la mission pour laquelle vous avez été engagé, pour un salaire de 4,50 dollars (l’équivalent de 35 dollars actuels), un jour de 1960, de 1961 ou de 1962. Vous appuyez. L’élève crie. L’homme qui vous dirige, en blouse blanche, vous assure que c’est douloureux, mais pas dangereux: «Continuez», demande-t-il. L’expérience porte – vous a-t-il dit – sur le lien entre apprentissage et punition. En réalité, l’«élève» est un acteur, les chocs sont faux, tout comme les cris, et le sujet de l’expérience, c’est vous: jusqu’où ira votre obéissance?
En mettant sur pied ce dispositif, le dénommé Stanley Milgram, assistant en psychologie à l’Université Yale, acquiert un ticket gagnant pour la célébrité. Au propre comme au figuré, son expérience est en effet un électrochoc. Elle dévoile, selon son auteur, la facilité avec laquelle n’importe qui peut glisser dans un état d’obéissance aveugle à l’autorité, se convertissant en tortionnaire sur demande, sans presque s’en rendre compte. C’est du moins ainsi que se décline l’histoire officielle de l’«expérience de Milgram» telle qu’elle est propagée par les manuels scolaires et par la culture populaire: on en trouve des échos dans le dessin animé Les Simpson, dans la chanson We Do What We’re Told (Milgram’s 37) de Peter Gabriel ou dans le thriller conspirationniste I… comme Icare d’Henri Verneuil.
Depuis que les chercheurs ont commencé à plonger dans les archives de Stanley Milgram, parcourant ses enregistrements et ses journaux de bord, on découvre que la réalité de l’expérience était très différente. Selon une étude publiée en septembre dernier par une équipe de psychologues écossais, états-uniens et australiens, les résultats des quelque 700 essais menés à Yale montrent bien quelque chose, mais pas du tout ce que l’on croyait. Les sujets qui poussent la punition jusqu’au voltage maximum – qui ne sont pas la majorité, contrairement aux affirmations de Milgram – «ne sont pas des gens qui obéissent comme des robots et qui somnambulent dans la tyrannie: ils agissent parce qu’ils ont pris une décision, et ils sont activement engagés dans le processus», explique au téléphone Alexander Haslam, de l’Université du Queensland à Brisbane (Australie), coauteur de l’étude. Dans ce processus, Milgram lui-même joue un rôle crucial et inavoué, celui d’un leader qui crée un mécanisme d’identification à un bien supérieur – la science – lequel vaut bien, au passage, quelques cruautés.
Auteure du livre Behind the Shock Machine. The Untold Story of the Notorious Milgram Psychology Experiments , forte de quatre ans d’immersion dans les archives de Yale et d’une série de rencontres avec d’anciens participants, la psychologue australienne Gina Perry est plus radicale. «La méthodologie des expériences présente tellement de failles qu’il est extrêmement difficile d’en tirer une conclusion quelconque», souligne-t-elle, jointe sur son mobile. Il n’y eut, pour commencer, pas une, mais 24 expériences, avec des dispositifs très variés et des résultats qui l’étaient tout autant: le taux d’obéissance de 65%, mis en avant par Milgram comme un résultat global, porte, par exemple, sur une variation où l’«élève» électrocuté ne se plaignait pas.
«Il faudra à Milgram douze ans pour mettre au point une explication théorique de ce qui s’est passé dans son laboratoire, relève Gina Perry. C’est seulement en rédigeant son livre La Soumission à l’autorité, publié en 1974, qu’il aboutit à la notion d’«état agentique»: une sorte de zone crépusculaire où la conscience serait endormie et où l’on obéirait servilement, «dépourvu de culpabilité», selon ses termes. D’après Milgram, on entre dans cet état lorsqu’on se trouve en relation avec une figure de pouvoir qui donne des ordres: notre volonté fusionne alors avec cette autorité, dont on devient l’agent.»
Pour étayer son point de vue, le récit de Milgram fait l’impasse sur plusieurs points. L’étendue de la désobéissance, par exemple: «En réexaminant les résultats, on voit que lorsque les sujets étaient clairement confrontés à l’idée que les chocs faisaient du mal, ils arrêtaient.» Mais aussi le fait que de nombreux participants perçaient l’illusion et ne croyaient pas à la réalité des décharges.
Que démontre, alors, l’expérience de Milgram? Probablement rien au sujet de la nature humaine. Son fabuleux destin en tant que récit met en lumière, en revanche, le pouvoir du storytelling et de la science-spectacle. «Milgram était un grand admirateur de Candid Camera (caméra cachée) – l’émission de télé la plus populaire aux Etats-Unis dans les années 1950 et au début des années 1960 – et de son créateur, Allen Funt. Ce dernier avait travaillé en tant qu’assistant en psychologie à l’Université Cornell. D’une certaine façon, les expériences de Milgram avaient leurs racines dans la téléréalité. Elles ont nourri à leur tour beaucoup d’émissions de ce type. J’ai vu récemment un épisode de Big Brother où les participants s’administraient des électrochocs en cas de mauvaise réponse à un test d’orthographe», reprend Gina Perry. Liaisons dangereuses? «Beaucoup de psychologues travaillent aujourd’hui comme conseils pour la téléréalité. Il y a toujours eu ce lien fort entre la recherche en psychologie sociale, impliquant la mise en scène et la duperie, et la téléréalité. Milgram en est un exemple.» Ses étudiants se souviennent d’ailleurs d’un «très bon showman, avec un sens très fort du drame».
Après l’expérience, les sujets sont congédiés avec un débriefing qui, dans les documents, apparaît loin d’être systématique et complet. La violence psychologique endurée par les participants, et son prolongement dans la confusion sur ce qui s’est réellement passé, sont les points principaux sur lesquels s’abattent les critiques après que Milgram a publié son premier article sur l’expérience, en 1963. Le débat qui s’ensuit conduit la psychologie expérimentale à renforcer son code d’éthique, bannissant les méthodes basées sur la mystification et introduisant la notion de «consentement éclairé». Certains, entre-temps, seront restés traumatisés toute leur vie. «J’ai rencontré des gens qui, encore aujourd’hui, sont extrêmement troublés d’avoir vu leur vécu dans le laboratoire de Milgram être assimilé au comportement des gardes des camps de concentration nazis», raconte Gina Perry.
 Le lien avec le nazisme est au cœur du discours de Milgram. Il s’explique notamment par le contexte de l’expérience: pendant que le chercheur met ses sujets à l’épreuve, la philosophe allemande Hannah Arendt chronique le procès du chef SS Adolf Eichmann pour le magazine The New Yorker. En observant l’accusé, elle croit découvrir la «banalité du mal». Jeu d’échos: «Milgram entre en résonance avec l’idée selon laquelle Eichmann et les gens comme lui étaient des rouages dans une machine bureaucratique, au sein de laquelle ils devenaient des agents des actions d’autrui, plutôt que les acteurs à plein titre de leurs propres actes.»
Le lien avec le nazisme est au cœur du discours de Milgram. Il s’explique notamment par le contexte de l’expérience: pendant que le chercheur met ses sujets à l’épreuve, la philosophe allemande Hannah Arendt chronique le procès du chef SS Adolf Eichmann pour le magazine The New Yorker. En observant l’accusé, elle croit découvrir la «banalité du mal». Jeu d’échos: «Milgram entre en résonance avec l’idée selon laquelle Eichmann et les gens comme lui étaient des rouages dans une machine bureaucratique, au sein de laquelle ils devenaient des agents des actions d’autrui, plutôt que les acteurs à plein titre de leurs propres actes.»
Le problème, c’est que la notion de la «banalité du mal» présente, elle aussi, un défaut de fabrication majeur. «Comme le montre l’historien David Cesarani dans sa biographie d’Eichmann, Hannah Arendt n’était présente que lors des journées d’ouverture du procès, dans lesquelles la défense présentait son point de vue. Après son départ, les pièces à conviction et les témoignages présentés montraient Eichmann comme beaucoup plus activement engagé. La vision de Hannah Arendt est liée au matériel partiel auquel elle a été exposée», avance Gina Perry. Le livre récent de Bettina Stangneth Eichmann vor Jerusalem: Das unbehelligte Leben eines Massenmörders (qui vient de paraître en traduction anglaise) enfonce aujourd’hui le clou, montrant un Eichmann engagé de manière virulente et dépourvu de repentir.
Pas de repentir, si l’on ose la transition, chez Milgram non plus. «En réalité, il était conscient, et très lucide, à propos des failles de son expérience. Les documents le montrent s’avouant à lui-même que sa méthodologie est viciée. Mais ces confessions à usage personnel s’arrêtent lorsque l’expérience devient célèbre. Il adopte alors une attitude purement défensive et ne s’accorde plus aucune place pour les ruminations», constate Gina Perry.
Que conclure? Si l’expérience de Milgram ne démontre rien sur l’obéissance, ses faux-semblants et le succès de son récit pointent vers une autre vérité: face aux explications simples et sidérantes, mieux vaut, sans doute, toujours y regarder de près.
23:48 | Lien permanent | Commentaires (0)
Féminisation des noms
 À la suite du récent incident qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale, les immortels ont tenu à rappeler le bon usage.
À la suite du récent incident qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale, les immortels ont tenu à rappeler le bon usage.
Le document est titré: «La féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres - Mise au point de l'Académie française». La vénérable institution, «fidèle à la mission que lui assignent ses statuts depuis 1635», a tenu à rappeler les règles qui s'imposent dans notre langue. Voici le document dans son intégralité avec les cinq points importants.
● Rejet de «professeure, recteure, sapeuse-pompière, auteure, ingénieure, procureure»
1. L'Académie française n'entend nullement rompre avec la tradition de féminisation des noms de métiers et fonctions, qui découle de l'usage même: c'est ainsi qu'elle a fait accueil dans la 8e édition de son Dictionnaire (1935) à artisane et à postière, à aviatrice et à pharmacienne, à avocate, bûcheronne, factrice, compositrice, éditrice et exploratrice. Dans la 9e édition, en cours de publication, figurent par dizaines des formes féminines correspondant à des noms de métiers. Ces mots sont entrés naturellement dans l'usage, sans qu'ils aient été prescrits par décret: l'Académie les a enregistrés pourvu qu'ils soient de formation correcte et que leur emploi se soit imposé.
Mais, conformément à sa mission, défendant l'esprit de la langue et les règles qui président à l'enrichissement du vocabulaire, elle rejette un esprit de système qui tend à imposer, parfois contre le vœu des intéressées, des formes telles que professeure, recteure, sapeuse-pompière, auteure, ingénieure, procureure, etc., pour ne rien dire de chercheure, qui sont contraires aux règles ordinaires de dérivation et constituent de véritables barbarismes.
Le français ne dispose pas d'un suffixe unique permettant de féminiser automatiquement les substantifs. S'agissant des métiers, très peu de noms s'avèrent en réalité, du point de vue morphologique, rebelles à la féminisation quand elle paraît utile. Comme bien d'autres langues, le français peut par ailleurs, quand le sexe de la personne n'est pas plus à prendre en considération que ses autres particularités individuelles, faire appel au masculin à valeur générique, ou «non marquée».
● Le masculin, valeur générique
2. En 1984, après que le gouvernement eut pris une première initiative en faveur de «la féminisation des titres et fonctions et, d'une manière générale, du vocabulaire concernant les activités des femmes», l'Académie française fit publier une déclaration rappelant le rôle des genres grammaticaux en français. Les règles qui régissent dans notre langue la distribution des genres remontent au bas latin et constituent des contraintes internes avec lesquelles il faut composer. L'une des contraintes propres à la langue française est qu'elle n'a que deux genres: pour désigner les qualités communes aux deux sexes, il a donc fallu qu'à l'un des deux genres soit conférée une valeur générique afin qu'il puisse neutraliser la différence entre les sexes.
L'héritage latin a opté pour le masculin. Les professeurs Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss, à qui la Compagnie avait confié la rédaction de ce texte, adopté à l'unanimité dans la séance du 14 juin 1984, concluaient ainsi: «En français, la marque du féminin ne sert qu'accessoirement à rendre la distinction entre mâle et femelle. La distribution des substantifs en deux genres institue, dans la totalité du lexique, un principe de classification permettant éventuellement de distinguer des homonymes, de souligner des orthographes différentes, de classer des suffixes, d'indiquer des grandeurs relatives, des rapports de dérivation, et favorisant, par le jeu de l'accord des adjectifs, la variété des constructions nominales… Tous ces emplois du genre grammatical constituent un réseau complexe où la désignation contrastée des sexes ne joue qu'un rôle mineur. Des changements, faits de propos délibéré dans un secteur, peuvent avoir sur les autres des répercussions insoupçonnées. Ils risquent de mettre la confusion et le désordre dans un équilibre subtil né de l'usage, et qu'il paraîtrait mieux avisé de laisser à l'usage le soin de modifier» (déclaration faite en séance, le 14 juin 1984).
● Refus de la féminisation systématique
3. Le 21 mars 2002, l'Académie française publie une nouvelle déclaration pour rappeler sa position, et, en particulier, pour souligner le contresens linguistique sur lequel repose l'entreprise de féminisation systématique. Elle insiste sur les nombreuses incohérences linguistiques qui en découlent (ainsi une recteure nommée directrice d'un service du ministère de l'Éducation nationale, ou la concurrence des formes recteure et rectrice - préférée par certaines titulaires de cette fonction). La Compagnie fait valoir que brusquer et forcer l'usage revient à porter atteinte au génie même de la langue française et à ouvrir une période d'incertitude linguistique.
«Un catalogue de métiers, titres et fonctions systématiquement et arbitrairement “féminisés” a été publié par la Documentation française, avec une préface du premier ministre. La presse, la télévision ont suivi avec empressement ce qui pouvait passer pour une directive régalienne et légale» (déclaration adoptée à l'unanimité dans la séance du 25 mars 2002). Or aucun texte ne donne au gouvernement «le pouvoir de modifier de sa seule autorité le vocabulaire et la grammaire du français».
Nul ne peut régenter la langue, ni prescrire des règles qui violeraient la grammaire ou la syntaxe: elle n'est pas en effet un outil qui se modèle au gré des désirs et des projets politiques. Les compétences du pouvoir politique sont limitées par le statut juridique de la langue, expression de la souveraineté nationale et de la liberté individuelle, et par l'autorité de l'usage qui restreint la portée de toute terminologie officielle et obligatoire. Et de l'usage, seule l'Académie française a été instituée «la gardienne».
● Distinguer noms de métiers et fonctions officielles
4. Il convient par ailleurs de distinguer des noms de métiers les termes désignant des fonctions officielles et les titres correspondants. Dans ce cas, les particularités de la personne ne doivent pas empiéter sur le caractère abstrait de la fonction dont elle est investie, mais au contraire s'effacer derrière lui: c'est ce que mettait en lumière un rapport remis, à sa demande, au premier ministre en octobre 1998 par la Commission générale de terminologie et de néologie, qui déconseillait formellement la féminisation des noms de titres, grades et fonctions officielles, par distinction avec les noms de métiers, dont le féminin s'impose naturellement dans l'usage.
Ce texte marquait une grande convergence de vues avec l'Académie française et complétait utilement les déclarations sur cette question que la Compagnie avait elle-même rendues publiques. En 2002, l'Académie française constate que, «de ce rapport, le gouvernement n'a pas plus tenu compte» que de l'«analyse scientifique irréfutable» des professeurs Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss.
La Commission générale rappelle que, si l'usage féminise aisément les métiers, «il résiste cependant à étendre cette féminisation aux fonctions qui sont des mandats publics ou des rôles sociaux distincts de leurs titulaires et accessibles aux hommes et aux femmes à égalité, sans considération de leur spécificité. […] Pour nommer le sujet de droit, indifférent par nature au sexe de l'individu qu'il désigne, il faut se résoudre à utiliser le masculin, le français ne disposant pas de neutre». Elle ajoute que «cette indifférence juridique et politique doit être préservée dans la règlementation, dans les statuts et pour la désignation des fonctions». Elle affirme «son opposition à la féminisation des noms de fonction dans les textes juridiques en général, pour lesquels seule la dénomination statutaire de la personne doit être utilisée.»
Elle «estime que les textes règlementaires doivent respecter strictement la règle de neutralité des fonctions. L'usage générique du masculin est une règle simple à laquelle il ne doit pas être dérogé» dans les décrets, les instructions, les arrêtés et les avis de concours. Les fonctions n'appartiennent pas en effet à l'intéressé: elles définissent une charge dont il s'acquitte, un rôle qu'il assume, une mission qu'il accomplit. Ainsi ce n'est pas en effet Madame X qui signe une circulaire, mais le ministre, qui se trouve être pour un temps une personne de sexe féminin; mais la circulaire restera en vigueur alors que Madame X ne sera plus titulaire de ce portefeuille ministériel. La dénomination de la fonction s'entend donc comme un neutre et, logiquement, ne se conforme pas au sexe de l'individu qui l'incarne à un moment donné.
Il en va de même pour les grades de la fonction publique, distincts de leur détenteur et définis dans un statut, et ceux qui sont des désignations honorifiques exprimant une distinction de rang ou une dignité. Comme le soutient la Commission générale, «pour que la continuité des fonctions à laquelle renvoient ces appellations soit assurée par-delà la singularité des personnes, il ne faut pas que la terminologie signale l'individu qui occupe ces fonctions. La neutralité doit souligner l'identité du rôle et du titre indépendamment du sexe de son titulaire.»
● «L'épreuve du temps»
5. Cependant, la Commission générale de terminologie et de néologie considère - et l'Académie française a fait siennes ces conclusions - que cette indifférence juridique et politique au sexe des individus «peut s'incliner, toutefois, devant le désir légitime des individus de mettre en accord, pour les communications qui leur sont personnellement destinées, leur appellation avec leur identité propre.» Elle estime que, «s'agissant des appellations utilisées dans la vie courante (entretiens, correspondances, relations personnelles) concernant les fonctions et les grades, rien ne s'oppose, à la demande expresse des individus, à ce qu'elles soient mises en accord avec le sexe de ceux qui les portent et soient féminisées ou maintenues au masculin générique selon le cas».
La Commission générale conclut justement que «cette souplesse de l'appellation est sans incidence sur le statut du sujet juridique et devrait permettre de concilier l'aspiration à la reconnaissance de la différence avec l'impersonnalité exigée par l'égalité juridique».
En 2002, l'Académie française, opposée à toute détermination autoritaire de l'usage, rappelait qu'elle avait tenu à «soumettre à l'épreuve du temps» les «recommandations» du Conseil supérieur de la langue française publiées en 1990 au Journal officiel au lieu de les imposer par décret, bien qu'elle les ait approuvées et enregistrées dans la 9e édition de son Dictionnaire: elle a en quelque sorte libéré l'usage, en laissant rivaliser des formes différentes sans chercher à en proscrire autoritairement aucune, jusqu'à ce que la meilleure l'emporte. C'est à cette attitude, conforme à la manière dont elle a exercé continûment son magistère depuis près de quatre siècles, qu'elle entend demeurer fidèle.
16:04 | Lien permanent | Commentaires (0)
15/10/2014
Sex, Toys et vidéos
 Une compagnie taïwanaise lance un site de rencontre qui permettra à ses internautes d'avoir des relations sexuelles virtuelles en contrôlant le jouet coquin d'un(e) parfait(e) inconnu(e).
Une compagnie taïwanaise lance un site de rencontre qui permettra à ses internautes d'avoir des relations sexuelles virtuelles en contrôlant le jouet coquin d'un(e) parfait(e) inconnu(e).
Les rencontres sur internet ne se limiteront plus à de simples discussions. Un nouveau réseau social appelé "LovePalz Club" devrait ouvrir lundi prochain. Il propose à ses membres de contrôler le sex toys d'un(e) inconnu(e) et vice versa. A l'origine, ce concept était destiné aux personnes qui vivent une "relation longue-distance." Mais selon Viv Lu, porte-parole du réseau social, interrogée par le site BetaBeat "beaucoup de gens rêvent d'avoir une relation sexuelle avec un(e) parfait(e) inconnu(e).
Une relation sexuelle par vidéoconférence
Sur la boutique du site internet, les internautes pourront acheter un jouet coquin à connexion bluetooth pour la somme de 150 euros. Après avoir créé son profil, l'abonné choisit parmi les autres membres celui/celle qui lui plait le plus, lui envoie un message et si l'autre est d'accord la rencontre peut commencer. Pour les plus timides, il y a le choix. "L’interaction peut avoir lieu à travers le chat ou une vidéo conférence", ajoute la porte-parole. Si les deux personnes décident d'utiliser leur sex toys, chacun peut contrôler la vitesse et le type de vibrations sur le jouet de l'autre.
14:25 | Lien permanent | Commentaires (0)
L'horloge du jugement dernier
Ebola et notre inconscience
 Sans avoir encore explosé aussi exponentiellement que ne le prévoyaient certains modèles (que nous avions précédemment cités dans nos article) l'épidémie d'Ebola se développe rapidement et pourrait très bien atteindre non seulement l'ensemble des pays dits pauvres, mais aussi à un moindre degré (voire peut-être à un degré voisin) les pays dits riches, Europe, Etats-Unis notamment.
Sans avoir encore explosé aussi exponentiellement que ne le prévoyaient certains modèles (que nous avions précédemment cités dans nos article) l'épidémie d'Ebola se développe rapidement et pourrait très bien atteindre non seulement l'ensemble des pays dits pauvres, mais aussi à un moindre degré (voire peut-être à un degré voisin) les pays dits riches, Europe, Etats-Unis notamment.
Il en est de même des taux de mortalité. Loin de s'atténuer, comme lors des précédentes épidémies d'Ebola, ils paraissent s'accroitre. Les statistiques venant des pays actuellement touchés minorent sans doute d'ailleurs la réalité, tant en ce qui concerne les cas que les décès, compte tenu de la difficulté d'identifier ce qui se passe en brousse, comme dans les bidonvilles des mégapoles africaines où le virus se répand actuellement.
La communauté internationale, selon l'expression classique, n'a manifestement pas pris conscience de l'ampleur et des taux de progression de l'épidémie. Ceci tient à diverses raisons: la croyance (fausse) que le virus resterait confiné dans les pays pauvres, des croyances également fausses concernant la contagiosité, laquelle paraît plus grande qu'il n'est dit généralement, d'autres illusions, relatives aux capacités de réaction rapide des institutions sanitaires.
Il apparaît ainsi de plus en plus évident que les autorités politiques et de santé ne sont pas suffisamment informées et averties pour prévoir les grands changements systémiques que l'humanité devra dorénavant affronter. Ces changements découleront de phénomènes désormais irréversibles comme le réchauffement climatique et la destruction des écosystèmes. Il serait ainsi tout à fait probable que si une grande majorité d'espèces vivantes complexes disparaissaient dans le siècle ou le demi-siècle, des espèces moins complexes mais tout à fait bien organisées pour faire face prendraient le relais. Ce serait le cas des virus et microbes. Ou bien ceux déjà existants muteraient pour profiter des nouveaux espaces à eux ouverts, ou bien de nouvelles espèces mieux organisées émergeraient, la nature ayant horreur du vide. Il faudra aussi tenir compte du fait que si les sociétés humaines s'appauvrissaient à l'occasion de ces changements, les taux de natalité pourraient continuer à croître à court terme, aggravant les problèmes rencontrés par les adultes survivants.
Plus immédiatement, les observateurs considèrent qu'Ebola est le fruit de la « croissance » croissance elle-même incontrôlable. De la forêt où le virus restait confiné chez certaines chauves-souris ou primates, il s'étendra dorénavant sans limites aujourd'hui perceptibles à l'ensemble des continents, du fait de la densité des transports aériens et de la multiplication des mégapoles où devraient résider prochainement, selon les prévisions, au moins les trois quarts des humains. La Chine et l'Inde, à cet égard, auront des soucis à se faire.
Nous ne pouvons prétendre traiter d'aussi graves problèmes dans un simple article. Abordons cependant quelques points qui sont à l'ordre du jour, complétant ce qui avait été indiqué dans nos articles précédents. Le lecteur voulant approfondir le sujet trouvera sur le web anglophone toutes les informations nécessaires.
La contagiosité
Sans évidemment être virologue ou épidémiologue, mais en faisant appel au simple bon sens, nous ne comprenons pas comment les pays destinataires des vols en provenance de l'Afrique, comme plus généralement les pays recevant des voyageurs provenant de zones infectées, puissent se rassurer en affirmant que la détection des températures ( à condition d'ailleurs qu'elle soit bien faite) suffirait à identifier les malades contagieux. Il est dit que la contagiosité ne se produirait pas avant les premier symptômes, dont celui de la fièvre. A supposer que ceci soit vrai et le demeure, comme l'on sait que ces symptômes, notamment la fièvre, n'apparaissent que quelques jours après la contamination, le risque est grand de voir des voyageurs déjà contaminés mais non encore symptomatiques pénétrer sur le territoire, sans être détectés par les filtres aux frontières.
Si ensuite, ces personnes, ou des personnes avec lesquelles elles auront été en contact, manifestent des symptômes identifiés comme ceux d'Ebola, elles auront eu le temps, avant d'être mises en isolement , de contaminer des dizaines d'autres contacts. On ne pourra pas en effet considérer que les millions de personnes atteintes de grippes ou d'entérites, fréquentes en cette saison, devraient passer des tests ou être isolées. Lorsque le virus sera installé, même faiblement, dans les pays jusqu'alors indemnes, le prédiagnostic, consistant à demander si le sujet provient d'un pays africain contaminé, ne sera plus applicable. Faudra-t-il alors faire passer des tests approfondis à tous les grippés, afin de séparer les faux-positifs des positifs? Le système de santé sera vite débordé, non seulement par le nombre des malades déclarés, mais par la nécessité de multiplier par prudence des milliers ou millions d'examens qui se révélerait ensuite inutiles.
Un autre problème est désormais à l'ordre du jour, concernant la prévention de la contagiosité. Celle-ci suppose des équipements spéciaux coûteux, devant en principe être détruits rapidement après usage. Or ils commencent à manquer dans les pays infectés. Il en sera rapidement de même dans les pays menacés d'infection. Qui paiera et plus spécifiquement qui lancera les actions de production et de distribution susceptibles de pallier ces ruptures de stocks
L'appel à l'armée
En cas d'urgence nationale, un gouvernement pourrait considérer qu'il doive faire appel à la police ou à l'armée pour mettre un semblant d'ordre dans une situation devenue incontrôlable. Mais ce serait courir le risque de contaminer rapidement les policiers ou militaires. De plus, aussi disciplinés et dévoués que soient ces personnels, il serait compréhensible que certains d'entre refusent d'obéir à des ordres dépassant évidemment ceux auxquels ils considéraient de leur devoir d'obéir.
Par ailleurs, comme beaucoup des Etats atteints, aujourd'hui en Afrique, verront très vite s'écrouler le peu qu'ils possédaient de structures institutionnelles, les pays riches devront-ils envoyer des troupes prétendument au secours de ces Etats en faillite. D'ores et déjà, Barack Obama, qui vient de décider l'envoi de quelques 5.000 hommes en Afrique de l'ouest, s'est fait (non sans de bonnes raisons selon nous) accuser de vouloir introduire dans ces pays la présence de l'Africa Command dont les gouvernements avaient précédemment déclaré vouloir se passer. Même s'il s'agissait de troupes sous mandat de l'ONU, elles seraient nécessairement très mal accueillies au vu des mesures de prophylaxie qu'elles seraient obligées d'imposer. Les ONG occidentales ne le seront pas mieux. Ainsi l'USAID, principale ONG américaine, est souvent à juste titre considérée comme un faux-nez de la CIA ou du Pentagone . Seule, Médecins sans frontières (MSF) semble échapper à ces critiques. Mais elle le paiera durement du fait de la mortalité qui frappera nécessairement ses volontaires.
Vaccins et sérums
L'appel aux vaccins, destinés à prévenir la contagion, et aux sérums, destinés à soigner des malades déjà infectés, est présenté comme la solution la plus efficace permettant de bloquer la diffusion du virus. Mais généralement ceux qui en parlent dans les médias ne se rendent pas compte des difficultés qu'il faudra résoudre, ni des obstacles pratiques qu'il faudra surmonter, pour que de tels remèdes surviennent à temps. Une course de vitesse est désormais engagée entre les recherches médicales et la diffusion du virus. Rien ne dit que l'humanité pourra la gagner, malgré les ressources de la science.
Jusqu'à présent, le virus Ebola avait été considéré comme de diffusion locale, dans des pays dont l'état sanitaire ne mobilisait pas les grands industriels de la recherche médico-pharmaceutique (les « big Pharma », selon le jargon). Quelques recherches avaient été mollement menées au début des années 2000 à l'instigation du département américain de la défense, étudiant les risques de bio-terrorisme. Mais rien de grande ampleur n'en était sorti. A ce jour, dans la suite de ces recherches, deux vaccins comportant l'ajout de protéines d'Ebola dans un virus inoffensif, ont été annoncés.
L'un par une petite entreprise américaine nommée Newlink Genetics l'autre par le géant britannique GSK. Ils semblent agir chez des macaques, mais n'ont pas encore été testés chez des humains.
Or des tests, généralement impérativement requis dans des situations normales, paraissent en ce cas impraticables. Il faudrait selon les informations données par les experts, administrer le sérum à au moins 5000 personnes avant de placer ceux-ci dans des situations à risque. Il a été dit que les travailleurs médicaux travaillant déjà sur le terrain pourraient accepter de courir ce risque, mais cela parait improbable. Pour bien faire, ils devraient en effet accepter de ne pas se protéger. De toutes façons, le temps nécessaire à ces tests sera beaucoup trop long pour que des enseignements utiles puissent en être tirés.
Certains spécialistes considèrent aujourd'hui que le taux de mortalité est si important qu'il faudrait sans attendre vacciner le plus grand nombre possible de personnes, soit à partir des vaccins cités ci-dessus, soit à partir d'autres souches qui seront par ailleurs présentées (La Russie vient d'annoncer pouvoir disposer de 3 vaccins expérimentaux d'ici 6 mois),. Ceci sans se préoccuper des risques. Ceux-ci ne seront pas plus élevés que ceux découlant du parti pris de ne rien faire.
L'organisation mondiale de la Santé vient de se réunir en urgence le 5 septembre à Genève (http://www.who.int/mediacentre/events/meetings/2014/ebola-interventions/en/). Il y a été dit que pour bloquer l'épidémie, face au million de cas prévu à la fin de l'année, il faudrait plusieurs milliers de doses de vaccins (non testés) à cette date pour commencer à agir. En fait, il en faudrait plusieurs millions, davantage encore si l'on voulait vacciner des populations non encore en risque immédiat.
Or, il ne suffit pas de décider d'une telle politique pour qu'elle devienne immédiatement applicable, ceci dans les délais de quelques semaines qui seraient nécessaires. Les grosses firmes pharmaceutiques, même abondamment subventionnées, ne pourraient pas fabriquer en temps utile les doses nécessaires. Si elles le pouvaient, manquerait alors le personnel de santé, ou les civils formés à cette fin, nécessaires aux opérations de vaccination sur le terrain. Et que se passerait-il si les vaccins utilisés, comme certains anti-rétroviraux auxquels on pense par ailleurs, se révélaient finalement sans action. Et que se passerait-il si le virus mutait dans l'intervalle, en acquérant davantage de virulence, au lieu d'en perdre comme il avait semblé le faire lors des épidémies précédentes.
Alors ne survivrait qu'une petite moitié de l'humanité, faite d'individus semblables à ceux qui, pour des raisons encore inconnues, survivent d'ores et déjà à l'infection. On voit que les économistes, qui pour le moment ne s'inquiètent que des pertes commerciales en provenance d'Etats africains de plus en plus paralysés par l'Ebola, sont loin du compte.
Jean Paul Baquiast
12/10/2014
11:19 | Lien permanent | Commentaires (0)
13/10/2014
En attendant le jugement dernier...
Le droit pénal n'a pas pour fonction de perpétuer un tabou social
 L'amour entre frère et sœur bientôt autorisé outre-Rhin ? Le Conseil d'éthique allemand a brisé un tabou et donné le 24 septembre un avis en faveur de la dépénalisation des relations sexuelles entre des frères et sœurs adultes consentants. Ses recommandations, sans aucune valeur contraignante, vont à l'encontre de l'article 173 du Code pénal selon lequel l'inceste entre frères et sœurs est passible de deux ans de prison – et qui date de 1871.
L'amour entre frère et sœur bientôt autorisé outre-Rhin ? Le Conseil d'éthique allemand a brisé un tabou et donné le 24 septembre un avis en faveur de la dépénalisation des relations sexuelles entre des frères et sœurs adultes consentants. Ses recommandations, sans aucune valeur contraignante, vont à l'encontre de l'article 173 du Code pénal selon lequel l'inceste entre frères et sœurs est passible de deux ans de prison – et qui date de 1871.
En auditionnant plusieurs couples de frères et sœurs, "les membres du Conseil d'éthique ont été touchés par la misère sociale des personnes vivant dans l'inceste", souligne la Süddeutsche Zeitung.Ils rejettent du reste l'argument médical, évoqué jusqu'à présent pour interdire les relations consanguines, selon lequel les enfants d'un couple incestueux ont davantage de risques de présenter des problèmes de santé : ces risques sont bien plus importants chez les personnes porteuses des gènes de maladies génétiques et nul ne songerait à leur interdire d'avoir des relations sexuelles ni de fonder une famille.
"Cette loi a-t-elle encore lieu d'être ?"
Sur les 25 membres de cet organe qui assiste le gouvernement et le Parlement sur les questions éthiques, 14 se sont prononcés pour l'évolution de la loi, 9 contre, et 2 se sont abstenus, rapporte Der Spiegel. "La majorité du Conseil d'éthique est d'avis que le droit pénal n'a pas pour fonction de perpétuer un tabou social", explique le Conseil, cité par le magazine de Hambourg.
En Allemagne, le débat est lancé, et la Süddeutsche Zeitung s'interroge : "Cette loi a-t-elle encore lieu d'être en cette époque d'émancipation et de liberté sexuelle ?"
La circoncision interdite
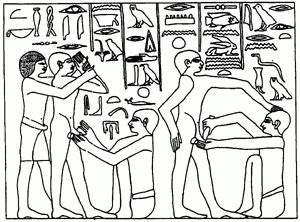 Le jugement devrait faire jurisprudence. Le tribunal de grande instance de Cologne (Allemagne) a estimé que la circoncision d'un enfant pour des motifs religieux était une blessure corporelle passible d'une condamnation. Mardi, la communauté juive a dénoncé une atteinte à la liberté religieuse. Le Conseil central des juifs d'Allemagne estime qu'il s'agit d'«une intervention gravissime et sans précédent dans les prérogatives des communautés religieuses».
Le jugement devrait faire jurisprudence. Le tribunal de grande instance de Cologne (Allemagne) a estimé que la circoncision d'un enfant pour des motifs religieux était une blessure corporelle passible d'une condamnation. Mardi, la communauté juive a dénoncé une atteinte à la liberté religieuse. Le Conseil central des juifs d'Allemagne estime qu'il s'agit d'«une intervention gravissime et sans précédent dans les prérogatives des communautés religieuses».
Son président, Dieter Graumann, a exigé que les députés allemands légifèrent sur la question pour éviter des atteintes à la liberté religieuse.
La communauté musulmane, qui compte plus de 4 millions de membres, est également montée au créneau. Le Conseil de coordination des musulmans en Allemagne (KRM) voit dans ce jugement une «grave atteinte» à la liberté religieuse. Ali Kizilkaya, porte-parole du KRM, a déploré le fait que l'Allemagne «criminalisait» des coutumes millénaires.
La cour saisie après qu'un médecin a été mis en cause
A l'origine, la justice allemande avait été saisie du cas d'un médecin généraliste de Cologne qui avait circoncis un petit garçon de 4 ans à la demande de ses parents musulmans. Quelques jours après l'intervention, l'enfant avait dû être admis aux urgences pour des saignements. Le parquet de la ville avait alors engagé des poursuites contre le médecin. Ce dernier avait été relaxé en première instance puis en appel, le tribunal arguant du fait qu'à l'époque des faits il n'était pas en mesure de déterminer s'il agissait illégalement.
«L'erreur (du médecin) était inévitable», la littérature juridique livrant jusqu'à présent des réponses différentes, selon le jugement du tribunal de Cologne. Selon des estimations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 30% des garçons de 15 ans et plus sont circoncis. Aux Etats-Unis, par exemple, une majorité de garçons subissent cette intervention, au nom de l'hygiène autant que du conformisme social.
Ce que dit le jugement
Le tribunal a jugé que «le corps d'un enfant était modifié durablement et de manière irréparable par la circoncision» et que «cette modification est contraire à l'intérêt de l'enfant qui doit décider plus tard par lui même de son appartenance religieuse». Cette décision n'interdit toutefois pas l'acte à des fins médicales. Les droits des parents en matière d'éducation et de liberté religieuse ne sont pas bafoués s'ils attendent que l'enfant soit en mesure de décider d'une circoncision comme «signe visible d'appartenance à l'islam», poursuit le tribunal.
Cette décision judiciaire est «extrêmement importante pour les médecins car ils ont pour la première fois une base légale sur laquelle s'appuyer», a assuré un expert en droit, Holm Putzke, dans le Financial Times Deutschland (FTD). «Aucun médecin ne pourra plus à l'avenir prétendre avoir cru qu'il devait circoncire un enfant pas encore en âge de décider pour des raisons religieuses», selon ce professeur de l'Université de Passau (sud) qui voit dans ce jugement une "césure". «A la différence de nombreux responsables politiques, le tribunal ne s'est pas laissé dissuader par la crainte d'être critiqué comme étant antisémite ou antireligieux», a ajouté cet expert.
18:54 | Lien permanent | Commentaires (0)
09/09/2014
C'est bien l'Ouest qui porte la responsabilité de la crise en Ukraine
C'est bien l'Ouest qui porte la responsabilité de la crise en Ukraine - Explications
Foreign Affairs, le 5 septembre 2014
Par John J. Mearsheimer
article original : Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault
 Selon l'avis le plus répandu à l'Ouest, la crise en Ukraine est presque entièrement imputable à l'agression russe. Selon cette accusation, le Président russe Vladimir Poutine a annexé la Crimée dans son désir de longue date de ressusciter l'empire soviétique, et il pourrait finir par essayer de prendre le reste de l'Ukraine, de même que d'autres pays en Europe de l'Est. Selon ce point de vue, la destitution du Président ukrainien Victor Ianoukovitch, en février 2014, a simplement fourni un prétexte à Poutine pour qu'il ordonne aux forces russes de prendre une partie de l'Ukraine.
Selon l'avis le plus répandu à l'Ouest, la crise en Ukraine est presque entièrement imputable à l'agression russe. Selon cette accusation, le Président russe Vladimir Poutine a annexé la Crimée dans son désir de longue date de ressusciter l'empire soviétique, et il pourrait finir par essayer de prendre le reste de l'Ukraine, de même que d'autres pays en Europe de l'Est. Selon ce point de vue, la destitution du Président ukrainien Victor Ianoukovitch, en février 2014, a simplement fourni un prétexte à Poutine pour qu'il ordonne aux forces russes de prendre une partie de l'Ukraine.
Mais cette interprétation est fausse : les Etats-Unis et leurs alliés européens partagent l'essentiel de la responsabilité de cette crise. Le noud du problème est l'élargissement de l'OTAN, l'élément central d'une stratégie plus large de sortir l'Ukraine de l'orbite russe et de l'intégrer à l'Ouest. En même temps, l'expansion de l'Union Européenne [UE] vers l'Est et le soutien occidental au mouvement pro-démocratie en Ukraine - qui a commencé avec la révolution orange en 2004 - ont été aussi des éléments capitaux. Depuis le milieu des années 1990, les dirigeants russes se sont catégoriquement opposés à l'élargissement de l'OTAN et, ces dernières années, ils ont bien fait comprendre qu'ils ne resteraient pas les bras croisés en voyant leur partenaire d'importance stratégique transformé en bastion occidental. Pour Poutine, le renversement illégal du président ukrainien pro-russe démocratiquement élu - dont il a dit à juste titre que c'était un « coup d'Etat » - a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a riposté en prenant la Crimée, une péninsule qu'il craignait voir abriter une future base navale de l'OTAN, et il a œvré à déstabiliser l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle renonce à rejoindre l'Ouest.
La réaction de Poutine n'aurait pas dû surprendre. Après tout, l'Ouest s'était immiscé dans l'arrière-cour de la Russie et menaçait ses intérêts stratégiques essentiels, une chose que Poutine a fait remarquer avec insistance et à maintes reprises. Les élites aux Etats-Unis et en Europe ont été prises de court par les événements pour la seule raison qu'elles souscrivaient à une vision faussée de la politique internationale. Elles tendent à croire que la logique du réalisme a peu de pertinence au 21ème siècle et que l'Europe peut être maintenue entière et libre sur la base de principes libéraux tels que l'Etat de droit, l'interdépendance économique et la démocratie.
Mais ce grand projet est allé de travers en Ukraine. La crise là-bas montre que la realpolitik reste pertinente - et les Etats qui l'ignorent le font à leur propre péril. Les dirigeants étasuniens et européens ont commis un impair en tentant de transformer l'Ukraine en un bastion occidental à la frontière russe. A présent que les conséquences se sont crûment révélées, ce serait une erreur encore plus grande de poursuivre cette politique mal inspirée.
Les dirigeants étasuniens et européens ont commis un impair en tentant de transformer l'Ukraine en un bastion occidental à la frontière russe
L'affront des pays occidentaux
Tandis que la Guerre Froide arrivait à son terme, les dirigeants soviétiques préféraient que les forces américaines restent en Europe et que l'Otan reste intacte, un arrangement, pensaient-ils, qui maintiendrait pacifiée une Allemagne réunifiée. Mais, ainsi que leurs successeurs en Russie, ils ne voulaient pas que l'OTAN grandisse plus et ils supposaient que les diplomates occidentaux comprenaient leurs préoccupations. L'administration Clinton pensait évidemment de façon contraire, et au milieu des années 1990, elle a commencé à pousser l'OTAN à s'étendre.
La première série d'élargissement a eu lieu en 1999 avec l'entrée de la République Tchèque, de la Hongrie et de la Pologne. La deuxième série a eu lieu en 2004 : elle comprenait la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. Dès le début, Moscou s'en est plaint âprement. Par exemple, durant la campagne de bombardement des Serbes bosniaques par l'OTAN, en 1995, le Président russe Boris Ieltsine déclarait : « C'est le premier signe de ce qui pourrait se produire si l'OTAN arrive jusqu'aux frontières de la Fédération de Russie. [.] Les flammes de la guerre pourraient incendier toute l'Europe ». Mais les Russes étaient trop faibles à ce moment-là pour faire dérailler le mouvement de l'OTAN vers l'Est - lequel, de toute façon, ne paraissait pas si menaçant, puisque aucun des nouveaux membres de l'OTAN, à l'exception des Etats Baltes, ne partageait de frontières avec la Russie.
Et puis, l'OTAN a commencé à projeter son regard un peu plus loin vers l'Est. Lors de son sommet d'avril 2008, à Bucarest, l'alliance a envisagé d'admettre en son sein la Géorgie et l'Ukraine. L'administration de George W. Bush soutenait cette idée, mais la France et l'Allemagne s'y opposèrent de crainte que cela ne contrarie un peu trop la Russie. Finalement, les membres de l'OTAN sont arrivés à un compromis : l'alliance n'entamera pas la procédure officielle conduisant à leur admission, mais émit une déclaration soutenant les aspirations de la Géorgie et de l'Ukraine, en déclarant avec impudence : « Ces pays deviendront membres de l'OTAN ».
Cependant, Moscou ne vit pas vraiment ce résultat comme un compromis. Alexander Grushko, alors vice-ministre russe des Affaires étrangères, déclara : « L'admission de la Géorgie et de l'Ukraine dans l'alliance est une énorme erreur stratégique qui aurait les conséquences les plus graves pour la sécurité paneuropéenne ». Poutine a maintenu cette position en disant que l'admission de ces pays dans l'OTAN représenterait une « menace directe » contre la Russie. Un quotidien russe rapporta que Poutine, s'entretenant avec Bush, « a indiqué à Bush de façon très claire que si l'Ukraine était admise dans l'OTAN, elle cesserait d'exister ».
L'invasion russe de la Géorgie en août 2008 aurait dû dissiper tout doute subsistant sur la détermination de Poutine à empêcher la Géorgie et l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Le Président géorgien Mikhaïl Saakachvili, qui était très engagé à faire entrer son pays dans l'OTAN, avait décidé au cours de l'été 2008, de réincorporer deux régions séparatistes, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Mais Poutine chercha à maintenir la Géorgie faible et divisée - et hors de l'OTAN. Après que les combat éclatèrent entre le gouvernement géorgien et les séparatistes de l'Ossétie du Sud, les forces russes prirent le contrôle de ces deux régions. Moscou s'était fait comprendre. Pourtant, malgré cette mise en garde on ne peut plus claire, l'OTAN n'a jamais publiquement abandonné son objectif de faire entrer la Géorgie et l'Ukraine dans l'alliance. Et l'expansion de l'OTAN a poursuivi sa marche en avant, avec l'Albanie et la Croatie qui sont devenues membres en 2009.
L'UE, également, a poursuivi sa marche vers l'Est. En mai 2008, elle a dévoilé son initiative de partenariat oriental, un programme destiné à favoriser la prospérité dans des pays comme l'Ukraine et à les intégrer dans l'économie de l'UE. Il n'est pas surprenant que les dirigeants russes aient vu ce plan comme étant hostile aux intérêts de leur pays. En février dernier, avant que Ianoukovitch ne soit chassé du pouvoir par la force, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, accusa l'UE d'essayer de créer une « sphère d'influence » en Europe orientale. Aux yeux des dirigeants russes, l'expansion de l'Union européenne est un cheval de Troie pour l'expansion de l'OTAN.
Le tout dernier outil de l'Ouest pour détacher Kiev de Moscou a été ses efforts pour répandre les valeurs occidentales et promouvoir la démocratie en Ukraine et dans les autres Etats post-soviétiques, un plan qui comporte souvent le financement de particuliers et d'organisations pro-occidentales. Victoria Nuland, la ministre américaine des Affaires étrangères déléguée aux affaires européennes et eurasiatiques, estimait en décembre 2013 que les Etats-Unis avaient investi plus de 5 milliards de dollars depuis 1991 pour aider l'Ukraine à réaliser « l'avenir qu'elle mérite ». Dans le cadre de cet effort, le gouvernement américain a financé le National Endowment for Democracy [NED]. Cette fondation à but non lucratif a financé plus de 60 projets destinés à promouvoir la société civile en Ukraine, et le président de la NED, Carl Gershman, a dit de ce pays qu'il était « la plus grosse récompense ». Après que Ianoukovitch remporta l'élection présidentielle en février 2010, la NED décida que ce dernier sapait ses objectifs et elle a donc accru ses efforts pour soutenir l'opposition et renforcer les institutions démocratiques de ce pays.
Lorsque les dirigeants russes observent l'ingénierie sociale en Ukraine, ils s'inquiètent de ce que leur pays pourrait être le prochain sur la liste. Et de telles craintes ne sont guère sans fondement. En septembre 2013, Gershman a écrit dans le Washington Post, « Le choix de l'Ukraine de rejoindre l'Europe accélérera avec la disparition de l'idéologie de l'impérialisme russe que représente Poutine ». Il ajouta : « Les Russes sont aussi confrontés à un choix, et Poutine pourrait se retrouver du côté des perdants, non seulement dans son voisinage immédiat, mais également en Russie elle-même ».
 La création d'une crise
La création d'une crise
Imaginez l'indignation américaine si la Chine construisait une alliance stratégique impressionnante et essayait d'y inclure le Canada et le Mexique.
Le triple ensemble de mesures politiques de l'Ouest - l'élargissement de l'OTAN, l'expansion de l'UE et la promotion de la démocratie - a mis de l'huile sur un feu qui couvait. L'étincelle est venue en novembre 2013, lorsque Ianoukovitch rejeta un accord économique majeur qu'il avait négocié avec l'UE et décida à la place d'accepter la contre-proposition de 15 milliards de dollars des Russes. Cette décision fit naître des manifestations anti-gouvernementales qui se sont intensifiées au cours des trois mois suivants et qui, à partir de la mi-février, conduisirent à la mort d'une centaine de manifestants. Les émissaires occidentaux se précipitèrent à Kiev pour résoudre la crise. Le 21 février, le gouvernement et l'opposition passèrent un accord qui permettait à Yanoukovitch de rester au pouvoir jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Mais cet accord vola en éclat et Ianoukovitch s'enfuit en Russie le jour suivant.[1] Le nouveau gouvernement à Kiev était pro-occidental et anti-russe jusqu'à la moelle, et comportait quatre membres de haut rang qui pourraient être légitimement étiquetés de néo-fascistes.
Bien que toute l'étendue de l'implication des Etats-Unis n'ait pas encore dévoilée, il est clair que Washington a soutenu ce coup d'Etat. Nuland et le sénateur républicain John McCain ont participé aux manifestations anti-gouvernementales, et Geofrrey Pyatt, l'ambassadeur des Etats-Unis en Ukraine, proclama après la destitution de Ianoukovitch que c'était « une journée historique pour les livres d'Histoire ». Ainsi qu'un enregistrement téléphonique l'a révélé, Nuland s'était faite l'avocate du changement de régime et voulait que le politicien ukrainien Arseni Iatseniouk devienne le Premier ministre du nouveau gouvernement, ce qui fut fait. Il ne faut pas s'étonner que les Russes de tous les courants politiques pensent que l'Ouest ait joué un rôle dans la destitution de Ianoukovitch.
Pour Poutine, le temps d'agir contre l'Ukraine et l'Ouest est arrivé. Peu après le 22 février, il a ordonné aux forces russes de prendre la Crimée, et l'a rapidement incorporée dans la Russie. Grâce aux milliers de soldats russes déjà stationnés sur la base navale du port criméen de Sébastopol, cette tâche s'est révélée plutôt facile. La Crimée constituait également une cible facile puisque les habitants d'origine russe composent approximativement 60% de sa population. La plupart d'entre eux voulaient que la Crimée sorte de l'Ukraine.
Ensuite, Poutine a placé une énorme pression sur le nouveau gouvernement à Kiev pour le décourager de se mettre du côté de l'Ouest contre Moscou, faisant bien comprendre qu'il détruirait l'Ukraine en sa qualité d'Etat avant de lui permettre de devenir un bastion occidental au seuil de la Russie. A cette fin, il a fourni des conseillers, des armes et un soutien diplomatique aux séparatistes russes en Ukraine orientale, qui poussent le pays vers la guerre civile. Il a massé une armée importante à la frontière ukrainienne, menaçant d'envahir si le gouvernement sévit contre les rebelles. Et il a augmenté brutalement le prix du gaz naturel que la Russie vend à l'Ukraine, tout en exigeant le paiement des arriérés. Poutine emploie les grands moyens.
Le diagnostic
Les actions de Poutine devraient être faciles à comprendre. Une immense étendue de terres que la France napoléonienne, l'Allemagne impériale et l'Allemagne nazie ont toutes traversée pour frapper la Russie elle-même. L'Ukraine sert d'Etat tampon d'une énorme importance stratégique pour la Russie. Aucun dirigeant russe ne tolèrerait une alliance militaire qui était l'ennemi juré de Moscou jusqu'à ce qu'elle pénètre en Ukraine récemment. Aucun dirigeant russe ne resterait non plus les bras croisés pendant que l'Ouest aide à installer là-bas un gouvernement déterminé à intégrer l'Ukraine à l'Ouest.
Washington n'aime peut-être pas la position de Moscou, mais devrait comprendre la logique qui se trouve derrière elle. C'est l'alpha et l'oméga de la géopolitique : les grandes puissances sont toujours sensibles aux menaces potentielles à proximité de leur territoire national. Après tout, les Etats-Unis ne tolèrent pas que des puissances éloignées déploient des forces militaires où que ce soit dans l'hémisphère nord, et encore moins à proximité de leurs frontières. Imaginez l'indignation à Washington si la Chine construisait une alliance militaire impressionnante et essayer d'y inclure le Canada et le Mexique. Laissons de côté la question de la logique et contentons-nous de dire que les dirigeants russes ont déclaré à maintes occasions à leurs homologues occidentaux qu'ils considèrent l'expansion de l'OTAN en Géorgie et en Ukraine comme étant inacceptable, en même temps que tout effort visant à tourner ces pays contre la Russie - un message que la guerre russo-géorgienne de 2008 avait rendu également clair comme de l'eau de roche.
Les responsables étasuniens et leurs alliés européens soutiennent qu'ils ont essayé de toutes leurs forces d'apaiser les craintes de la Russie et que Moscou devrait comprendre que l'Otan n'a aucun plan contre la Russie. En plus de nier continuellement que son expansion est destinée à endiguer la Russie, l'alliance n'a jamais déployé de façon permanente de forces militaires dans ses nouveaux Etats membres. En 2002, elle a même créé un corps appelé le Conseil OTAN-Russie dans un effort pour encourager la coopération. Pour amadouer un peu plus la Russie, les Etats-Unis ont annoncé en 2009 qu'ils déploieraient leur nouveau bouclier antimissile sur des bâtiments de guerre dans les eaux européennes, du moins initialement, plutôt qu'en territoire tchèque ou polonais. Mais aucune de ces mesures n'a marché : les Russes sont resté fermement opposés à l'élargissement de l'Otan, en particulier en Géorgie et en Ukraine. Et c'est aux Russes, et non à l'Ouest, de décider en fin de compte ce qui compte comme menace pour eux.
Pour comprendre pourquoi l'Ouest, en particulier les Etats-Unis, n'ont pas réussi à comprendre que sa politique ukrainienne jetait les bases d'un affrontement majeur avec la Russie, il nous faut nous reporter au milieu des années 1990, lorsque l'administration Clinton a commencé à encourager l'expansion de l'Otan. Les experts ont avancé une variété d'arguments pour et contre l'élargissement, mais il n'y avait aucun consensus sur ce qu'il fallait faire. La plupart des émigrés d'Europe de l'Est aux Etats-Unis et leurs familles, par exemple, soutenaient fortement l'expansion parce qu'ils voulaient que l'Otan protège des pays comme la Hongrie et la Pologne. Quelques réalistes privilégiaient également cette politique parce qu'ils pensaient que la Russie avait toujours besoin d'être endiguée.
Mais la plupart des réalistes s'opposaient à l'expansion car ils pensaient qu'une grande puissance en déclin avec une population vieillissante et une économie unidimensionnelle n'avait en fait pas besoin d'être endiguée. Et, ils craignaient que l'élargissement ne fournisse à Moscou une incitation à provoquer des troubles en Europe de l'Est. Le diplomate américain George Kennan a formulé ce point vue dans une interview qu'il a donnée en 1998, peu après que le Sénat des Etats-Unis eut approuvé la première série d'expansion de l'Otan. « Je pense que les Russes réagiront graduellement de façon assez hostile et que cela affectera leur politique », avait-il déclaré. « Je pense que c'est une erreur tragique. Il n'y avait aucune raison que ce soit à faire cela cela. Personne ne menaçait personne ».
Les Etats-Unis et leurs alliés devraient abandonner leur projet d'occidentaliser l'Ukraine et, à la place, avoir comme objectif d'en faire un tampon neutre.
D'un autre côté, la plupart des libéraux, dont des membres clés de l'administration Clinton, privilégiaient l'élargissement. Ils pensaient que la fin de la Guerre froide avait transformé fondamentalement la politique internationale et qu'un nouvel ordre mondial post-national avait remplacé la logique réaliste qui gouvernait habituellement l'Europe. Les Etats-Unis étaient non seulement la « nation indispensable », ainsi que la ministre des Affaires étrangères Madeleine Albright l'e formula, ils étaient aussi un hégémon bienveillant et, par conséquent, ne pouvaient certainement pas être considérés comme une menace par Moscou. Pour l'essentiel, l'objectif était de faire en sorte que tout le continent ressemble à l'Europe occidentale.
Et, les Etats-Unis et leurs alliés ont donc cherché à promouvoir la démocratie dans les pays d'Europe de l'Est, à accroître l'interdépendance économique entre eux et à les intégrer dans les institutions internationales. Ayant remporté le débat aux Etats-Unis, les libéraux n'eurent pas de mal à convaincre leurs alliés européens de soutenir l'élargissement de l'Otan. Après tout, vu les accomplissements passés des Etats-Unis, les Européens épousaient encore plus que les Américains l'idée que la géopolitique ne comptait plus et qu'un ordre libéral global pourrait maintenir la paix en Europe.
Les libéraux ont tellement dominé le discours sur la sécurité européenne au cours des dix premières années du 21ème siècle que même lorsque l'alliance a adopté une politique de croissance de la porte ouverte, l'expansion de l'OTAN a rencontré peu d'opposition réaliste. La vision libérale du monde est à présent le dogme accepté parmi les responsables américains. En mars, par exemple, le Président Barack Obama a prononcé un discours sur l'Ukraine dans lequel il a parlé à plusieurs reprises des « idéaux » qui motivent la politique occidentale et comment ces idéaux « ont souvent été menacés par une vision du pouvoir ancienne et plus traditionnelle ». La réponse du ministre des Affaires étrangères John Kerry à la crise de Crimée reflétait ce même point de vue : « On ne se comporte tout simplement pas au 21ème siècle à la manière du 19ème siècle en envahissant un autre pays sur des prétextes complètement fallacieux ». Surtout, les deux camps ont agi selon un éventail de tactiques différentes : Poutine et ses compatriotes ont pensé et agi selon des préceptes réalistes, alors que leurs homologues occidentaux ont adhéré aux idées libérales en matière de politique internationale. Le résultat est que les Etats-Unis et leurs alliés ont provoqué sans le savoir une crise majeure à propos de l'Ukraine.
C'est pas moi, c'est toi qui as commencé.
Dans cette même interview de 1998, Kennan prédisait que l'expansion de l'Otan provoquerait une crise, à la suite de laquelle les partisans de l'expansion diraient « nous vous avions toujours dit que les Russes sont ainsi ». Comme par enchantement, la plupart des responsables occidentaux ont dépeint Poutine comme le véritable coupable de la situation difficile que connaît l'Ukraine. En mars, selon le New York Times, la Chancelière allemande Angela Merkel a laissé entendre que Poutine était irrationnel, disant à Obama qu'il vivait « dans un autre monde ». Bien que Poutine ait sans nul doute des tendances autocratiques, aucune preuve ne soutient l'accusation selon laquelle il serait mentalement déséquilibré. Au contraire, il est un stratège de premier ordre, qui devrait être craint et respecté par quiconque le défie en matière de politique étrangère.
D'autres analystes affirment, ce qui est plus plausible, que Poutine regrette la disparition de l'Union soviétique et qu'il est déterminé à inverser les choses par l'expansion des frontières de la Russie. Selon cette interprétation, Poutine, ayant pris la Crimée, tâte à présent le terrain pour voir si le temps est venu de conquérir l'Ukraine, ou du moins sa partie orientale, et qu'il se comportera en fin de compte agressivement envers les autres pays dans le voisinage de la Russie. Pour certaines personnes qui épousent cette pensée, Poutine représente un Adolf Hitler des temps modernes, et passer quelque sorte d'accord que ce soit avec lui répèterait l'erreur de Munich. Ainsi, l'OTAN doit admettre la Géorgie et l'Ukraine en son sein pour endiguer la Russie avant qu'elle ne domine ses voisins et ne menace l'Europe de l'Ouest.
En y regardant de près, cet argument ne tient pas. Si Poutine était déterminé à créer une plus grande Russie, des signes de ses intentions se seraient fait jour quasi-certainement avant le 22 février 2014. Mais il n'y a visiblement aucune preuve qu'il était décidé à prendre la Crimée, et encore moins d'autres territoires en Ukraine, avant cette date. Même les dirigeants occidentaux qui soutenaient l'expansion de l'OTAN ne le faisaient pas de crainte que la Russie soit prête à utiliser la force militaire. Les actions de Poutine en Crimée les ont pris complètement par surprise et celles-ci semblent avoir été une réaction spontanée à la destitution de Ianoukovitch. Juste après cette destitution, Poutine a même dit qu'il s'opposait à la sécession de la Crimée, avant de changer rapidement d'avis.
Par ailleurs, même s'il le voulait, la Russie ne dispose pas de la capacité à conquérir et annexer facilement l'Ukraine orientale, et encore moins l'ensemble du pays. 15 millions de personnes environ - un tiers de la population ukrainienne - vit entre le Dniepr, qui coupe le pays en deux, et la frontière russe. Une majorité écrasante de ces gens veulent continuer à faire partie de l'Ukraine et résisteraient sûrement à une occupation russe. De plus, la médiocre armée russe, qui montre peu de signes de se transformer en une Wehrmacht moderne, aurait peu de chance de pacifier l'ensemble de l'Ukraine. Moscou est également mal placée pour financer une occupation coûteuse ; son économie déjà faible souffrirait encore plus face aux sanctions qui en résulteraient.
Mais même si la Russie s'enorgueillissait d'une machine militaire puissante et d'une économie impressionnante, elle s'avèrerait probablement toujours incapable d'occuper l'Ukraine avec succès. On doit seulement prendre en compte les expériences soviétique et américaine en Afghanistan, celles des Etats-Unis au Vietnam et en Irak, ainsi que l'expérience russe en Tchétchénie, pour se souvenir que les occupations militaires se terminent mal en général. Poutine comprend assurément qu'essayer de soumettre l'Ukraine serait comme avaler un porc-épic. Là, sa réponse aux événements a été défensive, et non offensive.
 Une voie de sortie
Une voie de sortie
Etant donné que la plupart des dirigeants occidentaux continuent de nier que l'attitude de Poutine pourrait être motivée par des préoccupations légitimes de sécurité, il n'est pas surprenant qu'ils aient essayé de modifier son attitude en doublant la mise par rapport à leur politique existante et qu'ils aient puni la Russie pour la dissuader de nouvelles agressions. Bien que Kerry ait maintenu que « toutes les options sont sur la table », ni les Etats-Unis ni leurs alliés de l'OTAN ne sont prêts à utiliser la force pour défendre l'Ukraine. L'Ouest compte à la place sur les sanctions économiques pour obliger la Russie à mettre fin à son soutien à l'insurrection dans l'Est de l'Ukraine. En juillet, les Etats-Unis et l'UE ont mis en place leur troisième série de sanctions limitées, visant essentiellement des personnes de haut rang étroitement liées au gouvernement russe, ainsi que quelques banques, entreprises d'énergie et de défense très en vue. Ils ont aussi menacé de lancer une autre série de sanctions, destinées à des secteurs entiers de l'économie russe.
De telles mesures auront peu d'effet. De toutes les manières, des sanctions sévères ne sont probablement pas à l'ordre du jour ; les pays d'Europe de l'Ouest, en particulier l'Allemagne, ont résisté à l'imposition de telles sanctions de crainte que la Russie ne riposte et provoque de sérieux dégâts économiques au sein de l'UE. Mais même si les Etats-Unis parvenaient à convaincre leurs alliés d'adopter des mesures sévères, Poutine ne changerait probablement pas ses décisions. L'Histoire montre que les pays absorberont des quantités énormes de punition afin de protéger leurs intérêts stratégiques vitaux. Il n'y a aucune raison de penser que la Russie représente une exception à cette règle.
Les dirigeants occidentaux se sont aussi accrochés à cette politique provocatrice qui a précipité la crise en premier lieu. En avril, le vice-président Joseph Biden a rencontré des parlementaires ukrainiens et leur a dit, « C'est votre seconde chance d'honorer la promesse d'origine faite par la Révolution orange ». John Brennan, le directeur de la CIA, n'a pas aidé lorsque, le même mois, il s'est rendu à Kiev, un voyage que la Maison Blanche disait être destiné à améliorer la coopération avec le gouvernement ukrainien dans le domaine de la sécurité.
Pendant ce temps, l'UE a continué d'appuyer son partenariat oriental. En mars, José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, a résumé la pensée de l'Union sur l'Ukraine, en disant : « Nous avons une dette, un devoir de solidarité avec ce pays, et nous ouvrerons pour le rapprocher de nous autant que possible ». Et effectivement, le 27 juin 2014, l'UE et l'Ukraine ont signé l'accord économique que Ianoukovitch avait fatidiquement rejeté sept mois plus tôt. Toujours en juin, lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, il fut convenu que l'alliance resterait ouverte à de nouveaux membres, bien que les ministres se soient bien gardés de mentionner l'Ukraine. « Aucun pays tiers n'a de droit de veto sur l'élargissement de l'Otan », a annoncé son secrétaire général, Anders Fogh Rasmussen. Les ministres des Affaires étrangères ont également convenu de soutenir diverses mesures pour améliorer les capacités militaires de l'Ukraine dans des domaines tels que le commandement, la logistique et la cyber-défense. Les dirigeants russes ont naturellement vu ces actions d'un mauvais oil ; la réponse de l'Ouest à cette crise ne fera qu'aggraver une situation déjà mauvaise.
Il y a toutefois une solution à la crise ukrainienne - bien que celle-ci nécessite que l'Ouest pense de façon fondamentalement différente par rapport à ce pays. Les Etats-Unis et leurs alliés devraient abandonner leur projet d'occidentaliser l'Ukraine et à la place en faire un tampon neutre entre l'Otan et la Russie, à l'instar de la position de l'Autriche durant la Guerre froide. Les dirigeants occidentaux devraient reconnaître que l'Ukraine importe tant à Poutine qu'ils ne peuvent pas y soutenir un régime anti-russe. Cela ne signifierait pas qu'un futur gouvernement ukrainien devrait être pro-russe ou anti-OTAN. Au contraire, le but devrait être une Ukraine souveraine qui ne tombe ni dans le camp russe ni dans le camp occidental.
Pour parvenir à cette fin, les Etats-Unis et leurs alliés devraient publiquement écarter l'expansion de l'Otan, à la fois en Géorgie et en Ukraine. L'Ouest devrait également aider à élaborer un plan de sauvetage économique pour l'Ukraine financé conjointement par l'UE, le FMI, la Russie et les Etats-Unis - une proposition que Moscou accueillerait favorablement, étant donné ses intérêts à avoir une Ukraine prospère sur son flanc occidental. Et l'Ouest devrait limiter considérablement ses efforts d'ingénierie sociale en Ukraine. Il est temps de mettre un terme au soutien occidental à une nouvelle Révolution orange. Néanmoins, les dirigeants étasuniens et européens devraient encourager l'Ukraine à respecter les droits des minorités, en particulier les droits linguistiques de ses ressortissants russophones.
On peut toujours arguer que changer de politique vis-à-vis de l'Ukraine aussi tardivement nuirait gravement à la crédibilité des Etats-Unis dans le monde. Cela aurait sans aucun doute certains coûts, mais ceux liés à la poursuite d'une stratégie mal inspirée seraient beaucoup plus élevés. En outre, les autres pays seraient plus enclins à respecter un Etat qui tire les leçons de ses erreurs et qui finit par concevoir une politique qui traite efficacement le problème. Cette option est clairement ouverte pour les Etats-Unis.
On entend également la revendication de l'Ukraine qui a le droit de déterminer avec qui elle veut s'allier et que les Russes n'ont aucun droit d'empêcher Kiev de rejoindre l'Ouest. C'est une façon dangereuse pour l'Ukraine de penser ses choix stratégiques. La triste vérité est que la force a souvent le dernier mot lorsque la politique des grandes puissances est en jeu. Des droits abstraits tels que l'autodétermination ne veulent bien souvent rien dire lorsque des Etats puissants se bagarrent avec des Etats plus faibles. Cuba avait-il le droit de former une alliance militaire avec l'Union soviétique durant la Guerre froide ? Les Etats-Unis ne le pensaient certainement pas, et les Russes pensent de la même façon à propos de l'Ukraine qui rejoindrait l'OTAN. C'est dans l'intérêt de l'Ukraine de comprendre ces faits de la vie et d'avancer prudemment lorsqu'elle a affaire à son voisin plus puissant.
Même si l'on rejète toutefois cette analyse et que l'on considère que l'Ukraine a le droit de demander de rejoindre l'UE et l'OTAN, le fait est que les Etats-Unis et leurs alliés européens ont le droit de rejeter ces demandes. Il n'y a pas de raison à ce que l'Ouest doive satisfaire l'Ukraine si celle-ci est déterminée à poursuivre une politique étrangère entêtée, en particulier si sa défense n'est pas d'un intérêt vital. Céder aux rêves de certains Ukrainiens ne vaut pas l'animosité et les conflits que cela provoquera, en particulier pour les Ukrainiens.
Bien sûr, certains analystes peuvent concéder que l'OTAN a mal géré ses relations avec l'Ukraine et pourtant continuer à maintenir que la Russie constitue un ennemi qui ne fera qu'être plus redoutable avec le temps - et que l'Ouest n'a par conséquent d'autre choix que de poursuivre sa politique actuelle. Mais ce point de vue est gravement défaillant. La Russie est une puissance en déclin et elle ne fera qu'être plus faible avec le temps. Même si la Russie était une puissance émergente, cela n'aurait en outre aucun sens d'incorporer l'Ukraine dans l'OTAN. La raison est simple : les Etats-Unis et leurs alliés européens ne considèrent pas l'Ukraine comme d'un intérêt stratégique capital, ainsi que leur réticence à utiliser la force militaire pour lui venir en aide l'a prouvé. Par conséquent, ce serait la plus grande des folies de créer un nouveau membre de l'Otan que les autres membres n'ont pas l'intention de défendre. L'OTAN s'est étendue dans le passé parce que les libéraux supposaient que l'alliance n'aurait jamais besoin d'honorer ses nouvelles garanties en matière de sécurité, mais le récent tour de force de la Russie montre qu'en accordant la qualité de membre de l'OTAN à l'Ukraine pourrait conduire la Russie et l'Ouest sur une trajectoire de collision.
Coller à la politique actuelle compliquerait également les relations entre l'Ouest et la Russie sur d'autres fronts. Les Etats-Unis ont besoin de l'aide de la Russie pour rapatrier les équipements américains d'Afghanistan en passant par le territoire russe, parvenir à un accord avec l'Iran sur le nucléaire et stabiliser la situation en Syrie. En fait, Moscou a aidé Washington sur ces trois problèmes dans le passé ; durant l'été 2013, ce fut Poutine qui a tiré les marrons du feu à Obama en élaborant l'accord en vertu duquel la Syrie a accepté de renoncer à ses armes chimiques, évitant par-là même la frappe militaire américaine dont Obama avait menacé la Syrie. Les Etats-Unis auront également besoin un jour ou l'autre de l'aide de la Russie pour endiguer une Chine en plein essor. La politique américaine actuelle ne fait toutefois que rapprocher Moscou et Pékin.
Les Etats-Unis et leurs alliés européens sont à présent confrontés à un choix concernant l'Ukraine. Ils peuvent poursuivre leur politique actuelle, qui exacerbera les hostilités avec la Russie et dévastera l'Ukraine dans le processus - un scénario dans lequel tout le monde serait perdant. Ou ils peuvent changer leur fusil d'épaule et ouvrer à créer une Ukraine prospère mais neutre, qui ne menace pas la Russie et qui permette à l'Ouest de réparer ses relations avec Moscou. Avec cette approche, tous les camps seront gagnants.
John Mearsheimer est professeur de sciences politiques à l'université de Chicago.
Traduction [JFG-QuestionsCritiques]
_______
Note du traducteur:
[1] L'accord passé entre le gouvernement de Ianoukovitch et l'opposition ukrainienne, le 21 février, le fut sous l'égide des Etats-Unis, de l'UE et de la Russie. Il stipulait la tenue prochaine d'élections législatives et présidentielles, le retour à la constitution de 2004 et le retrait des forces anti-émeutes de Kiev. Ianoukovitch accepta ces conditions et ordonna sur-le-champ aux forces anti-émeutes de se retirer de Kiev. Le lendemain, le 22 février, alors que Ianoukovitch se rendait à Kharkov pour rencontrer des membres de son parti politique, le Parti des régions, l'opposition, faisant fi de l'accord passé, destitua Ianoukovitch, nomma le président du parlement ukrainien, Olexander Tourtchinov, président par intérim, puis fit voter « à l'unanimité » par les parlementaires la nomination d'Arseni Iatseniouk au poste de Premier ministre. Ianoukovitch, menacé, s'est alors enfui vers la Russie. On rappellera que Victor Ianoukovitch n'était pas particulièrement « pro-russe », puisqu'il s'est opposé à maintes reprises à la Russie afin de préserver l'indépendance de l'Ukraine en matière économique. C'est d'ailleurs lui qui mena campagne pour négocier un accord de libre-échange avec l'UE, accord dont il jugea les conditions inacceptables pour son pays et qui le conduisirent à accepter la contre-proposition russe. Lire la déclaration de Victor Ianoukovitch après les événements du 22 février 2014.
12:41 | Lien permanent | Commentaires (0)
27/04/2014
La violence des riches
Monique Pinçon-Charlot : « La violence des riches atteint les gens au plus profond de leur esprit et de leur corps »
par Agnès Rousseaux 5 novembre 2013
Qui sont les riches aujourd’hui ? Quel impact ont-ils sur la société française ? Pour la sociologue Monique Pinçon-Charlot, les riches font subir au reste de la société une violence inouïe. Une violence banalisée grâce à un renversement du langage : les riches seraient des victimes, menacées par l’avidité du peuple. Elle dénonce un processus de déshumanisation, une logique de prédation, une caste qui casse le reste de la société. Et invite à organiser une « vigilance oligarchique » : montrer aux puissants que leur pouvoir n’est pas éternel.
 Basta ! : Qu’est-ce qu’un riche, en France, aujourd’hui ?
Basta ! : Qu’est-ce qu’un riche, en France, aujourd’hui ?
Monique Pinçon-Charlot [1] : Près de 10 millions de Français vivent aujourd’hui en-dessous du seuil de pauvreté. Celui-ci est défini très précisément. Mais il n’existe pas de « seuil de richesse ». C’est très relatif, chacun peut trouver que son voisin est riche. Et pour être dans les 10 % les plus riches en France, il suffit que dans un couple chacun gagne 3000 euros.
Nous nous sommes intéressés aux plus riches parmi les riches. Sociologiquement, le terme « riche » est un amalgame. Il mélange des milieux très différents, et regroupe ceux qui sont au top de tous les univers économiques et sociaux : grands patrons, financiers, hommes politiques, propriétaires de journaux, gens de lettres... Mais nous utilisons délibérément ce terme. Car malgré son hétérogénéité, ces « riches » sont une « classe », mobilisée pour la défense de ses intérêts. Et nous voulons aujourd’hui contribuer à créer une contre-offensive dans cette guerre des classes que mènent les riches et qu’ils veulent gagner.
Pourquoi est-il si difficile de définir cette classe ?
La richesse est multidimensionnelle. Bourdieu parlait très justement de capital – capital économique, culturel, symbolique –, c’est ce qui donne du pouvoir sur les autres. A côté de la richesse économique, il y a la richesse culturelle : c’est le monde des musées, des ventes aux enchères, des collectionneurs, des premières d’opéra... Jean-Jacques Aillagon, président du comité des Arts décoratifs, vient d’être remplacé par un associé-gérant de la banque Lazard. Dans l’association des amis de l’Opéra, on retrouve Maryvonne Pinault (épouse de François Pinault, 6ème fortune de France), Ernest-Antoine Seillière (ancien président du Medef, 37ème fortune de France avec sa famille) [2]...
A cela s’ajoute la richesse sociale, le « portefeuille » de relations sociales que l’on peut mobiliser. C’est ce qui se passe dans les cercles, les clubs, les rallyes pour les jeunes. Cette sociabilité mondaine est une sociabilité de tous les instants : déjeuners, cocktails, vernissages, premières d’opéra. C’est un véritable travail social, qui explique la solidarité de classe. La quatrième forme est la richesse symbolique, qui vient symboliser toutes les autres. Cela peut être le patronyme familial : si vous vous appelez Rothschild, vous n’avez pas besoin d’en dire davantage... Cela peut être aussi votre château classé monument historique, ou votre élégance de classe.
Il existe aussi une grande disparité entre les très riches...
Bernard Arnault, propriétaire du groupe de luxe LVMH, est en tête du palmarès des grandes fortunes professionnelles de France, publié chaque année par la revue Challenges. Il possède 370 fois la fortune du 500ème de ce classement. Et le 501ème est encore très riche ! Comparez : le Smic à 1120 euros, le revenu médian à 1600 euros, les bons salaires autour de 3000 euros, et même si on inclut les salaires allant jusque 10 000 euros, on est toujours dans un rapport de 1 à 10 entre ces bas et hauts salaires. Par comparaison, la fortune des plus riches est un puits sans fond, un iceberg dont on ne peut pas imaginer l’étendue.
Malgré l’hétérogénéité de cette classe sociale, les « riches » forment, selon vous, un cercle très restreint.
 On trouve partout les mêmes personnes dans une consanguinité tout à fait extraordinaire. Le CAC 40 est plus qu’un indice boursier, c’est un espace social. Seules 445 personnes font partie des conseils d’administration des entreprises du CAC 40. Et 98 d’entre eux détiennent au total 43 % des droits de vote [3] ! Dans le conseil d’administration de GDF Suez, dont l’État français possède 36 % du capital, il y a des représentants des salariés. Ceux-ci peuvent être présents dans divers comités ou commissions, sauf dans le comité des rémunérations. Cela leur est interdit. Qui décide des rémunérations de Gérard Mestrallet, le PDG ? Jean-Louis Beffa, président de Saint-Gobain, notamment. C’est l’entre-soi oligarchique.
On trouve partout les mêmes personnes dans une consanguinité tout à fait extraordinaire. Le CAC 40 est plus qu’un indice boursier, c’est un espace social. Seules 445 personnes font partie des conseils d’administration des entreprises du CAC 40. Et 98 d’entre eux détiennent au total 43 % des droits de vote [3] ! Dans le conseil d’administration de GDF Suez, dont l’État français possède 36 % du capital, il y a des représentants des salariés. Ceux-ci peuvent être présents dans divers comités ou commissions, sauf dans le comité des rémunérations. Cela leur est interdit. Qui décide des rémunérations de Gérard Mestrallet, le PDG ? Jean-Louis Beffa, président de Saint-Gobain, notamment. C’est l’entre-soi oligarchique.
Cela semble si éloigné qu’on peut avoir l’impression de riches vivant dans un monde parallèle, sans impact sur notre vie quotidienne. Vous parlez à propos des riches de « vrais casseurs ». Quel impact ont-ils sur nos vies ?
Avec la financiarisation de l’économie, les entreprises sont devenues des marchandises qui peuvent se vendre, s’acheter, avec des actionnaires qui exigent toujours plus de dividendes. Selon l’Insee, les entreprises industrielles (non financières) ont versé 196 milliards d’euros de dividendes en 2007 contre 40 milliards en 1993. Vous imaginez à quel niveau nous devons être sept ans plus tard ! Notre livre s’ouvre sur une région particulièrement fracassée des Ardennes, avec l’histoire d’une entreprise de métallurgie, qui était le numéro un mondial des pôles d’alternateur pour automobiles (les usines Thomé-Génot). Une petite entreprise familiale avec 400 salariés, à qui les banques ont arrêté de prêter de l’argent, du jour au lendemain, et demandé des remboursements, parce que cette PME refusait de s’ouvrir à des fonds d’investissement. L’entreprise a été placée en redressement judiciaire. Un fonds de pension l’a récupéré pour un euro symbolique, et, en deux ans, a pillé tous les savoir-faire, tous les actifs immobiliers, puis fermé le site. 400 ouvriers se sont retrouvés au chômage. C’est un exemple parmi tant d’autres ! Si vous vous promenez dans les Ardennes aujourd’hui, c’est un décor de mort. Il n’y a que des friches industrielles, qui disent chaque jour aux ouvriers : « Vous êtes hors-jeu, vous n’êtes plus rien. On ne va même pas prendre la peine de démolir vos usines, pour faire des parcs de loisirs pour vos enfants, ou pour planter des arbres, pour que vous ayez une fin de vie heureuse. Vous allez crever. »
Comment s’exerce aujourd’hui ce que vous nommez « la violence des riches » ?
C’est une violence inouïe. Qui brise des vies, qui atteint les gens au plus profond de leur corps, de leur estime, de leur fierté du travail. Être premier dans les pôles d’alternateur pour automobiles, c’est faire un travail de précision, c’est participer à la construction des TGV, à l’une des fiertés françaises. Casser cela est une violence objective, qui n’est ni sournoise ni cachée, mais qui n’est pas relayée comme telle par les politiques, par les médias, par ces chiens de garde qui instillent le néolibéralisme dans les cerveaux des Français. Pour que ceux-ci acceptent que les intérêts spécifiques des oligarques, des dominants, des riches, deviennent l’intérêt général.
Comment cette violence objective se transforme-t-elle en assujettissement ?
C’est une forme d’esclavage dans la liberté. Chacun est persuadé qu’il est libre d’organiser son destin, d’acheter tel téléphone portable, d’emprunter à la banque pendant 30 ans pour s’acheter un petit appartement, de regarder n’importe quelle émission stupide à la télévision. Nous essayons de montrer à quel système totalitaire cette violence aboutit. Un système totalitaire qui n’apparaît pas comme tel, qui se renouvelle chaque jour sous le masque de la démocratie et des droits de l’homme. Il est extraordinaire que cette classe, notamment les spéculateurs, ait réussi à faire passer la crise financière de 2008 – une crise financière à l’état pur – pour une crise globale. Leur crise, est devenue la crise. Ce n’est pas une crise, mais une phase de la guerre des classes sans merci qui est menée actuellement par les riches. Et ils demandent au peuple français, par l’intermédiaire de la gauche libérale, de payer. Et quand on dit aux gens : « Ce n’est quand même pas à nous de payer ! », ils répondent : « Ah, mais c’est la crise »...
Pourquoi et comment les classes populaires ont-elles intégré cette domination ?
 C’est une domination dans les têtes : les gens sont travaillés en profondeur dans leurs représentations du monde. Cela rend le changement difficile, parce qu’on se construit en intériorisant le social. Ce que vous êtes, ce que je suis, est le résultat de multiples intériorisations, qui fait que je sais que j’occupe cette place-là dans la société. Cette intériorisation entraîne une servitude involontaire, aggravée par la phase que nous vivons. Avec le néolibéralisme, une manipulation des esprits, des cerveaux, se met en place via la publicité, via les médias, dont les plus importants appartiennent tous à des patrons du CAC 40.
C’est une domination dans les têtes : les gens sont travaillés en profondeur dans leurs représentations du monde. Cela rend le changement difficile, parce qu’on se construit en intériorisant le social. Ce que vous êtes, ce que je suis, est le résultat de multiples intériorisations, qui fait que je sais que j’occupe cette place-là dans la société. Cette intériorisation entraîne une servitude involontaire, aggravée par la phase que nous vivons. Avec le néolibéralisme, une manipulation des esprits, des cerveaux, se met en place via la publicité, via les médias, dont les plus importants appartiennent tous à des patrons du CAC 40.
Sommes-nous prêts à tout accepter ? Jusqu’où peut aller cette domination ?
Dans une chocolaterie qu’il possède en Italie, le groupe Nestlé a proposé aux salariés de plus de cinquante ans de diminuer leur temps de travail [4], en échange de l’embauche d’un de leurs enfants dans cette même entreprise. C’est une position perverse, cruelle. Une incarnation de ce management néolibéral, qui est basé sur le harcèlement, la culpabilisation, la destruction. Notre livre est un cri d’alerte face à ce processus de déshumanisation. On imagine souvent que l’humanité est intemporelle, éternelle. Mais on ne pense pas à la manipulation des cerveaux, à la corruption du langage qui peut corrompre profondément la pensée. Le gouvernement français pratique la novlangue : « flexi-sécurité » pour ne pas parler de précarisation, « partenaires sociaux » au lieu de syndicats ouvriers et patronat, « solidarité conflictuelle ». Le pouvoir socialiste pratique systématiquement une pensée de type oxymorique, qui empêche de penser. Qui nous bloque.
Les riches entretiennent une fiction de « surhommes » sans qui il n’y aurait pas travail en France, estimez-vous. Menacer les riches signifie-t-il menacer l’emploi ?
Cette menace est complètement fallacieuse. Dans la guerre des classes, il y a une guerre psychologique, dont fait partie ce chantage. Mais que les riches s’en aillent ! Ils ne partiront pas avec les bâtiments, les entreprises, les autoroutes, les aéroports... Quand ils disent que l’argent partira avec eux, c’est pareil. L’argent est déjà parti : il est dans les paradis fiscaux ! Cette fiction des surhommes fonctionne à cause de cet assujettissement, totalitaire. Quand on voit le niveau des journaux télévisés, comme celui de David Pujadas, il n’y a pas de réflexion possible. En 10 ans, les faits divers dans les JT ont augmenté de 73 % !
Certains se plaignent d’une stigmatisation des « élites productives ». Les riches ont-ils eux aussi intériorisé ce discours, cette représentation ?
Notre livre s’ouvre sur une citation extraordinaire de Paul Nizan [5] : « Travaillant pour elle seule, exploitant pour elle seule, massacrant pour elle seule, il est nécessaire [à la bourgeoisie] de faire croire qu’elle travaille, qu’elle exploite, qu’elle massacre pour le bien final de l’humanité. Elle doit faire croire qu’elle est juste. Et elle-même doit le croire. M. Michelin doit faire croire qu’il ne fabrique des pneus que pour donner du travail à des ouvriers qui mourraient sans lui ». C’est pour cela que cette classe est tout le temps mobilisée : les riches ont sans cesse besoin de légitimer leur fortune, l’arbitraire de leurs richesses et de leur pouvoir. Ce n’est pas de tout repos ! Ils sont obligés de se construire en martyrs. Un pervers narcissique, un manipulateur, passe en permanence du statut de bourreau à celui de victime, et y croit lui-même. C’est ce que fait l’oligarchie aujourd’hui, par un renversement du discours économique : les riches seraient menacées par l’avidité d’un peuple dont les coûts (salaires, cotisations...) deviennent insupportables. On stigmatise le peuple, alors que les déficits et la dette sont liés à la baisse des impôts et à l’optimisation fiscale.
 Depuis que le parti socialiste est au pouvoir, qu’est-ce qui a changé ? Y a-t-il eu des améliorations concernant cette violence des riches que vous dénoncez ?
Depuis que le parti socialiste est au pouvoir, qu’est-ce qui a changé ? Y a-t-il eu des améliorations concernant cette violence des riches que vous dénoncez ?
On ne peut pas parler d’amélioration : nous sommes toujours dans un système oligarchique. Nos dirigeants sont tous formés dans les mêmes écoles. Quelle différence entre Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy ? Je ne suis pas capable de vous le dire. L’histoire bégaye. Un exemple : le secrétaire général adjoint de l’Élysée est actuellement Emmanuel Macron, qui arrive directement de la banque d’affaires Rothschild. Sous Nicolas Sarkozy, ce poste était occupé par François Pérol, qui venait aussi de chez Rothschild. Les banques Lazard et Rothschild sont comme des ministères bis [6] et conseillent en permanence le ministre de l’Économie et des Finances. La mission de constituer la Banque publique d’investissement (BPI) a été confiée par le gouvernement à la banque Lazard... Et la publicité sur le crédit d’impôt lancé par le gouvernement a été confiée à l’agence Publicis. Qui après avoir conseillé Nicolas Sarkozy conseille maintenant Jean-Marc Ayrault. On se moque de nous !
Pierre Moscovici et François Hollande avait promis une loi pour plafonner les salaires de grands patrons [7]. Ils y ont renoncé. Pierre Moscovici a annoncé, sans rire, qu’il préférait « l’autorégulation exigeante ». Des exemples de renoncement, nous en avons à la pelle ! Le taux de rémunération du livret A est passé de 1,75 % à 1,25 %, le 1er août. Le même jour, Henri Emmanuelli, président de la commission qui gère les livrets A [8], a cédé au lobby bancaire, en donnant accès aux banques à 30 milliards d’euros supplémentaires sur ces dépôts. Alors qu’elles ont déjà reçu des centaines de milliards avec Nicolas Sarkozy ! Elles peuvent prêter à la Grèce, au Portugal, avec un taux d’intérêt de 8 ou 10 %... Avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), entré en vigueur le 1er janvier 2013, c’est encore 20 milliards d’euros de recettes fiscales en moins chaque année, offerts aux entreprises, et qui plombent le déficit public de façon absolument considérable.
Le Front national a un discours virulent contre les « élites » françaises. N’avez-vous pas peur que votre analyse soit récupérée par l’extrême-droite ?
Nous ne disons pas que les politiques sont « tous pourris », comme le fait le FN. Nous proposons une analyse en terme de classes, pour donner à voir des mécanismes sociaux. Nous cherchons à dévoiler le fonctionnement de cette caste qui casse le reste de la société, dans une logique de prédation qui va se poursuivre dans une spirale infernale. Le Front National désigne comme bouc émissaire l’immigré ou le Rom, donnant en pâture ce qui est visible. Le Rom est d’ailleurs devenu un bouc émissaire transversal à l’échiquier politique, depuis la gauche libérale avec Manuel Valls jusqu’au Front National. Si on doit pointer précisément un responsable à la situation actuelle, c’est plutôt une classe sociale – les riches – et un système économique, le néolibéralisme. Puisqu’il faut des formules fortes : le banquier plutôt que l’immigré !
Vous parlez dans votre ouvrage d’une guerre des classes qui n’est pas sans visage. N’y a-t-il pas un enjeu justement à « donner des visages » à cette classe, comme vous le faites ?
C’est une nécessité absolue. Il faut s’imposer d’acheter chaque année ce bijou sociologique qu’est le palmarès du magazine Challenges. Et s’efforcer d’incarner, de mettre des visages sur cette oligarchie... C’est une curiosité nécessaire, les gens doivent être à l’affût de cette consanguinité, de cette opacité, de la délinquance financière. Nos lecteurs doivent se servir de notre travail pour organiser une « vigilance oligarchique » : montrer aux puissants que leur pouvoir n’est pas éternel, empêcher ce sentiment d’impunité qu’ils ont aujourd’hui, car ils savent que personne n’ira mettre son nez dans leurs opérations financières totalement opaques.
Nous avons aussi expérimenté des visites ethnographiques dans les quartiers riches, pour vaincre nos « timidités sociales ». Se promener dans les beaux quartiers, leurs cinémas, leurs magasins, leurs cafés, est un voyage dans un espace social. Il faut avoir de l’humilité pour accepter d’être remis à sa place, ne pas se sentir à l’aise, se sentir pauvre car vous ne pouvez pas vous payer une bière à six euros. Mais c’est une expérience émotionnelle, existentielle, qui permet des prises de conscience. Une forme de dévoilement de cette violence de classe.
Propos recueillis par Agnès Rousseaux
(@AgnesRousseaux)
Photo de une : complexe de Paraisópolis, à proximité d’une favela, au sud de São Paulo (Brésil) / Tuca Vieira
A lire : Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, La violence des riches, Chronique d’une immense casse sociale, Éditions Zones / La découverte, 2013, 256 pages, 17 euros. Pour le commander chez une librairie proche de chez vous, rendez-vous sur La librairie.com.
12:55 | Lien permanent | Commentaires (1)
18/03/2014
La guerre contre la Russie
La guerre contre la Russie dans sa dimension idéologique
Une analyse à la lumière de la Quatrième Théorie Politique
Alexandre Dugin
La guerre à venir comme concept
La guerre contre la Russie est actuellement la problématique la plus discutée en Occident. Il ne s’agit encore que d’une suggestion et d’une possibilité. Cela peut devenir une réalité en fonction des décisions prises par les différentes parties impliquées dans le conflit ukrainien (Moscou, Washington, Kiev, Bruxelles). Je n’entends pas discuter ici tous les aspects de ce conflit ainsi que son histoire. J’aimerais proposer à la place une analyse de ses racines idéologiques profondes. Ma vision des principaux événements s’appuie sur la Quatrième Théorie Politique dont j’ai exposé les principes dans mon ouvrage du même nom (publié en français aux éditions Ars Magna). Je ne vais ainsi pas étudier la guerre de l’Occident contre la Russie en évaluant ses risques, dangers, problèmes, coûts et conséquences mais plutôt sa signification idéologique à l’échelle du monde. Je vais ainsi réfléchir sur le sens d’une telle guerre et non sur la guerre elle-même (réelle ou virtuelle).
L’essence du libéralisme
L’Occident moderne ne connaît qu’une seule et unique idéologie dominante : le libéralisme. Il en existe bien des formes aux nombreuses nuances mais l’essence demeure toujours identique. La structure interne fondamentale du libéralisme est composée des principes axiomatiques suivants :
- -Individualisme anthropologique (l’individu est la mesure de toute chose) ;
- -Progressisme (le monde se dirige vers un futur meilleur, le passé est toujours pire que présent) ;
- -Technocratie (le développement technologique et sa performance effective sont perçuscomme les meilleurs outils pour juger de la nature d’une société) ;
- -Eurocentrisme (les sociétés euro-américaines sont considérées comme l’unité de mesurefondamentale pour le reste de l’humanité) ;
- -L’économie comme destin (l’économie basée sur le libre marché est l’unique modèleéconomique valable, toutes les autres alternatives sont à réformer ou à détruire) ;
- -La démocratie comme règne des minorités (qui se défendent contre la majorité qui seraittoujours prompte à dégénérer en totalitarisme ou en « populisme ») ;
- -La classe moyenne est le seul acteur social existant et devient la norme universelle(indépendamment du fait que la personne ait déjà atteint ce statut ou soit sur le point de l’atteindre) ;
- -Un monde unique, mondialisme (les êtres humains sont essentiellement identiques. Il ne peut exister que des différences individuelles. Le monde devrait être unifié sur une baseindividualiste : cosmopolitisme, citoyenneté mondiale).
Telles sont les valeurs centrales du libéralisme, qui n’est qu’une des trois tendances nées de la philosophie des Lumières, aux côtés du communisme et du fascisme, qui ont proposé des interprétations alternatives de l’esprit authentique de la Modernité. Au cours du XXème siècle, le libéralisme a vaincu ses deux rivaux et acquis, après 1991, le rôle d’unique idéologie dominante à l’échelle mondiale. Au Royaume du libéralisme, la seule liberté de choix était entre le libéralisme de gauche ou d’extrême gauche ou bien entre le libéralisme de droite ou d’extrême droite. Le libéralisme agissait ainsi comme le système opérationnel des societies occidentales et de toutes les sociétés placées sous l’influence de l’Occident. Le libéralisme est ainsi devenu à partir d’un certain moment le dénominateur commun à tout discours politiquement correct, le critère permettant de distinguer les discours acceptés par l’idéologie dominante de ceux rejetés dans la marginalité. La sagesse populaire est elle-même devenue libérale.
Sur un plan géopolitique, le libéralisme s’est inscrit dans un modèle américano-centré où les anglo-saxons constituaient le coeur et où l’OTAN, le partenariat atlantiste entre l’Europe et l’Amérique, représentait le noyau stratégique du système de sécurité mondiale. La sécurité du monde était assimilée à la sécurité de l’Occident et, en dernière instance, à la sécurité de l’Amérique. Le libéralisme n’est ainsi pas qu’un pouvoir idéologique mais également un pouvoir politique, militaire et stratégique. L’OTAN est profondément libéral. Il défend les sociétés libérales. Il combat pour le libéralisme.
Le libéralisme comme nihilisme
Un élément de l’idéologie libérale est responsable de sa crise actuelle. Le libéralisme est profondément nihiliste dans ses fondements mêmes. L’ensemble des valeurs défendues par le libéralisme est lié à l’idée centrale de liberté, de libération. Cependant, la liberté dans la vision libérale est essentiellement une catégorie négative : on exige d’être libre par rapport à (John Suart Mill), et non pas d’être libre pour. Cela n’est pas un point secondaire, il s’agit de l’essence même du libéralisme.
Le libéralisme est une lutte contre toute forme d’identité collective, contre tout type de valeurs, projets, stratégies, buts et fins qui s’établiraient sur une base collectiviste, ou à tout le moins non-individualiste. C’est la raison pour laquelle l’un des plus importants théoriciens du libéralisme, Karl Popper (suivant Friedrich van Hayek), affirme dans son important livre « La société ouverte et ses ennemis » (considéré par George Soros comme sa bible personnel) que les libéraux doivent combattre toute idéologie ou philosophie politique (de Platon et Aristoteà Hegel et Marx) qui proposerait aux sociétés humaines un but commun, une valeur commune, un sens commun. Tout but, toute valeur, tout sens doit être, dans la société libérale (la « société ouverte »), strictement individuel. Les ennemis de la « société ouverte » (toute la société occidentale post-guerre froide qui est considérée comme la norme de référence pour le reste du monde est précisément ce modèle libéral de société ouverte) sont ainsi faciles à identifier. Les ennemis principaux sont le communisme et le fascisme qui sont tous deux issus de la philosophie des Lumières et basés sur un concept fondateur non-individuel : la classe dans le marxisme, la race dans le national-socialisme, l’Etat national dans le fascisme. Le sens du combat libéral contre les alternatives modernes (fascisme ou communisme) est par ailleurs assez évident. Les libéraux prétendent libérer la société du fascisme et du communisme, des deux versions majeures du totalitarisme (explicitement non-individualiste). Le combat du libéralisme pour la liquidation des sociétés non-libérales est assez significatif : le libéralisme acquiert son sens par l’existence même d’idéologies qui se refusent à admettre l’individu comme valeur suprême. Il apparaît clairement contre quoi le combat a lieu, de quoi il faut se libérer. Le fait que la liberté telle que la conçoivent les libéraux est essentiellement une catégorie négative n’est ici pas clairement perçu. L’ennemi est ici et maintenant. Ce fait réel donne au libéralisme son contenu concret. Il est des sociétés « non ouvertes » et leur existence même suffit à justifier le processus de libération.
La période unipolaire : la menace d’implosion
En 1991, la chute de l’URSS, le dernier opposant au libéralisme occidental, a amené certains idéologues occidentaux à proclamer la fin de l’Histoire (p. ex : Francis Fukuyama). Assez logiquement : il n’y avait plus d’ennemi direct de la « société ouverte » et donc plus d’histoire au sens de la modernité, à savoir une lutte entre trois idéologies politiques (libéralisme, communisme, fascisme) pour l’héritage des Lumières. En termes stratégiques, ce fut le moment unipolaire (Charles Krauthammer). Cette période (1991-2014, avec en point d’orgue les attaques de Ben Laden sur le World Trade Center) fut réellement la période de domination mondiale du libéralisme. Les axiomes du libéralisme étaient acceptés par les principaux acteurs géopolitiques, y compris la Chine (dans son économie) et la Russie (dans son idéologie, son économie et son système politique). Il y avait alors des libéraux, des libéraux en devenir, des « pas assez » libéraux et ainsi de suite. Les exceptions réelles et explicites étaient rares (Iran, Corée du Nord). Le monde devint libéral par ses axiomes idéologiques.
Cela a été précisément le moment le plus important dans l’histoire du libéralisme. Il a vaincu ses ennemis mais les a en même temps perdus. Le libéralisme est essentiellement une libération, une lutte contre ce qui n’est (pas encore ou pas du tout) libéral. Le libéralisme a ainsi acquis son contenu, sa signification réelle par ses ennemis. Lorsque le choix porte entre la non-liberté (représentée par une société totalitaire donnée) et la liberté, beaucoup choisissent la liberté sans se demander sur quoi porte cette liberté. Lorsque des sociétés non- libérales existent, le libéralisme est positif. Il commence à manifester son essence négative qu’après sa victoire.
Après sa victoire en 1991, le libéralisme est entré dans sa phase implosive. Il est resté seul, sans ennemi à combattre, après avoir vaincu le communisme et le fascisme. Ce fut alors le moment pour débuter une lutte interne, une purge au sein même des sociétés libérales pour les débarrasser de tout élément non-libéral (le sexisme et les inégalités entre les sexes, le politiquement incorrect, toute dimension non-libérale qui imprègne des institutions comme l’Etat, l’Eglise et ainsi de suite). Le libéralisme a un besoin permanent d’ennemis pour s’en libérer. Autrement, il perd son contenu, son nihilisme implicite devient trop évident. Le triomphe absolu du libéralisme est sa mort.
C’est tout le sens idéologique de la crise financière du début des années 2000 et de 2008. Les succès et non les échecs de cette nouvelle économie totalement financiarisée (le turbocapitalisme selon G. Lytwak) sont responsable de son effondrement. La liberté de faire tout ce qu’il vous plaît – mais uniquement au niveau individuel – provoque l’implosion de la personnalité. L’humain passe dans le monde de l’infra-humain, dans le domaine infra- individuel. Il rencontre là la virtualité. Être libéré de tout est un rêve infra-individuel ; c’est l’évaporation de l’humain. L’Empire du Néant est le dernier mot de la victoire totale du libéralisme. Le post-modernisme prépare le terrain de ce cycle infini de non-sens auto- référencé et post-historique.
L’Occident en quête de l’Ennemi
Vous pourriez vous demander maintenant : mais en quoi tout ceci concerne la guerre (présumée) à venir contre la Russie ? Je suis à présent prêt à répondre.
Le libéralisme l’a emporté au niveau mondial. C’est un fait depuis 1991. Et il a commencé immédiatement à imploser. Il est arrivé à son stade terminal et a commencé à se liquider lui- même. L’immigration de masse, le choc des cultures et des civilisations, la crise financière, le terrorisme virtuel, la montée de l’ethnisme sont les marques d’un chaos qui s’approche. Ce chaos met en danger l’ordre, n’importe quel type d’ordre dont l’ordre libéral lui-même. Plus le libéralisme s’impose, plus il s’approche de sa fin, et donc de la fin du monde présent. Nous avons ici affaire à l’essence nihiliste de la philosophie libérale, où le néant apparaît comme le principe ontologique interne à la « liberté par rapport à ». L’anthropologue allemand Arnold Gehlen a justement défini l’homme comme une créature déficiente (Mängelwesen). L’homme en lui-même n’est rien. Tout ce qui compose son identité est issu de la société, de l’histoire, du peuple, de la politique. L’homme serait confronté au néant s’il retournait à sa pure essence. Cet abîme est dissimulé derrière des débris fragmentés de sentiments, des pensées vagues, des désirs obscurs. Derrière le voile fin de la virtualité des émotions infra-humaines ne se trouve qu’une pure obscurité. Ainsi, la découverte explicite du fondement nihiliste de la nature humaine est la dernière réalisation du libéralisme, mais aussi son ultime. Cela signifie également la fin pour ceux qui utilisent le libéralisme dans leur propre intérêt, qui sont les bénéficiaires de l’expansion libérale, les maîtres de la mondialisation. Tout ordre s’effondrerait devant un nihilisme aussi impérieux. L’ordre libéral également.
Les bénéficiaires du libéralisme ont ainsi besoin de prendre un certain recul afin de sauver leur domination. Le libéralisme doit acquérir son sens en affrontant à nouveau une société non-libérale. Faire un pas en arrière est l’unique façon de sauver les restes de l’ordre, de sauver le libéralisme de lui-même. La Russie de Poutine apparaît alors à l’horizon. Ni antilibérale, ni totalitaire, ni nationaliste, ni communiste, mais plutôt pas encore assez libérale, pas totalement libéral-démocrate, insuffisamment cosmopolite, pas assez radicalement anti- communiste. Mais sur la voie de devenir libérale, pas à pas, dans un processus gramscien d’ajustement de l’hégémonie (Transformismo). Dans l’agenda mondial du libéralisme (USA, OTAN), il y a un besoin d’un nouvel acteur, d’une Russie qui justifierait l’ordre dans le camp libéral, qui aiderait à mobiliser l’Occident en train de s’effondrer en raison de ses problèmes internes, qui repousserait l’irruption inévitable du nihilisme interne du libéralisme, le sauvant ainsi de sa logique fin apocalyptique. C’est pourquoi tous ces gens ont un besoin impérieux de Poutine, de la Russie, de la guerre. C’est la seule manière de prévenir le chaos en Occident et de sauver les restes de son ordre. Le rôle idéologique de la Russie est de justifier l’existence du libéralisme, car la Russie est l’ennemi qui donne un sens au combat pour la « société ouverte », qui l’aide à se consolider et à s’affirmer.
L’Islam radical (Al-Qaeda) était l’autre candidat pour ce rôle mais un tel ennemi manquait d’envergure. Il a été utilisé à un niveau uniquement local. Il a permis de justifier l’intervention en Afghanistan, l’occupation de l’Irak, le renversement de Kadhafi, et la provocation de la guerre civile en Syrie. L’islam radical était cependant trop faible et idéologiquement primitif pour constituer le défi réel dont les libéraux ont besoin. La Russie – ennemi géopolitique traditionnel des anglo-saxons – est un adversaire bien plus sérieux. Elle répond correctement à toutes les exigences : l’histoire et la mémoire de la guerre froide sont encore présentes dans les esprits et la haine de la Russie peut se susciter à l’aide de moyens relativement faibles. Pour cette raison, je pense que la guerre contre la Russie est possible. Elle est idéologiquement nécessaire en tant que moyen ultime de repousser l’implosion finale de l’Occident libéral. Un pas en arrière.
Sauver l’ordre libéral
En regardant les différents niveaux du concept de « guerre contre la Russie », je suis à même de soulever différents points.
1) La guerre contre la Russie aide à différer le désordre général au niveau mondial. La majorité des pays participant à l’économie libérale, qui partagent les axiomes et les institutions de la démocratie libérale et qui dépendent ou sous directement contrôlés par les Etats-Unis ou l’OTAN pourront une nouvelle fois s’unir sous la bannière de l’Occident libéral dans son combat contre le non-libéral Poutine. Cette guerre servira à réaffirmer le libéralisme comme une identité positive au moment même où cette identité se dissout en raison de son essence nihiliste.
2) La guerre contre la Russie renforcera l’OTAN et surtout ses membres européens qui seront obligés encore une fois de considérer que l’hyperpuissance américaine est positive et utile plutôt que d’y voir un reste obsolète de la guerre froide. Dans la peur de l’arrivée des méchants Russes, les Européens se sentiront à nouveau loyaux envers leur sauveur états- unien. Le rôle des Etats-Unis au sein de l’OTAN en sera d’autant plus renforcé.
3) L’UE est en train de s’effondrer. La menace générale représentée par la Russie pourrait prévenir une éventuelle scission en mobilisant les peuples pour leur faire défendre encore une fois leurs libertés et leurs valeurs menacées par l’Empire de Poutine.
4) L’Ukraine et la junte de Kiev ont besoin de la guerre pour justifier et couvrir toutes les forfaitures commises au niveau juridique et constitutionnel, pour suspendre la démocratie (qui entraverait leur domination dans les districts du sud-est majoritairement pro-russes) et pour installer un ordre nationaliste par des moyens extrêmes.
Le seul pays qui ne souhaite pas la guerre est la Russie. Cependant, Poutine ne peut laisser un gouvernement radicalement anti-russe gouverner un pays dont la moitié de la population est russe et qui est composé de nombreuses zones pro-russes. S’il laissait faire, il en serait fini de lui sur la scène internationale comme sur la scène de la politique intérieure. Il accepte donc la guerre à contrecœur. Une fois entrée en guerre, il n’y aura d’autre solution pour la Russie que la victoire. Je n’aime pas spéculer sur les aspects stratégiques de la guerre. Je laisse ça à des experts qualifiés. Je voudrais formuler plusieurs idées concernant la dimension idéologique de cette guerre.
La représentation de Poutine
Cette guerre contre la Russie est le dernier effort pour sauver le libéralisme de l’implosion. En ce sens, les libéraux doivent définir idéologiquement la Russie de Poutine comme l’ennemie de la société ouverte. Il n’existe que trois entrées dans le dictionnaire des idéologies modernes : le libéralisme, le communisme et le fascisme (nazisme). Il est assez clair que le libéralisme est représenté par tout sauf la Russie (Etats-Unis, OTAN, Euromaïdan, la junte de Kiev). Il reste donc le communisme et le fascisme. Ainsi Poutine est un Soviet, un communiste du KGB. Cette image sera vendue à la frange la plus stupide du public occidental. Certains aspects de la réaction patriotique de la population ukrainienne pro-russe et anti-banderiste pourront cependant confirmer cette idée (défense des monuments de Lénine, des portraits de Staline et de la mémoire de la seconde guerre mondiale). Le nazisme et le fascisme sont trop éloignés de Poutine et de la Russie moderne, mais le nationalisme et l’impérialisme russes seront invoqués dans la construction de l’image du grand Satan. Ainsi Poutine est nationaliste, fasciste et impérialiste. Cela fonctionnera sur d’autres occidentaux. Poutine peut aussi être les deux à la fois, communiste et fasciste en même temps, il sera ainsi dépeint comme un national-bolcheviste (mais cela sera un peu compliqué à vendre au public occidental post-moderne complètement ignorant). En réalité, il est évident que Poutine n’est rien de tout cela, ni communiste, ni fasciste, ni les deux. Il est politiquement réaliste (au sens que ce terme a dans les relations internationales, c’est pourquoi il apprécie Kissinger et que Kissinger l’apprécie en retour). Il n’a aucune idéologie d’aucune sorte. Mais il sera obligé de composer avec sa représentation idéologique. Il n’a pas le choix car telles sont les règles du jeu. Au cours de la guerre, Poutine fera l’objet de représentations et c’est là l’aspect le plus intéressant et passionné de la situation.
Les libéraux vont principalement tenter de définir Poutine idéologiquement comme une ombre du passé, un vampire « qui parfois revient ». C’est la véritable raison du recul visant à prévenir l’implosion finale du libéralisme. Le message principal sera que le libéralisme est réellement en vie et plein de force car il y a encore quelque chose dans le monde dont nous devons nous libérer. La Russie deviendra l’objet de la libération. Le but est de libérer l’Ukraine (et l’Europe, voire l’humanité) de la Russie et à la fin de libérer la Russie elle- même de son identité non-libérale. Ainsi nous avons l’Ennemi. Un tel ennemi donne au libéralisme une raison d’exister encore. La Russie est ainsi le défi que le passé pré-libéral jette au présent libéral. Sans un tel défi, il n’y a plus de vie dans le libéralisme, plus d’ordre dans le monde, tout se dissout et implose. Avec un tel défi, le géant décadent du mondialisme acquiert une vigueur nouvelle. La Russie est là pour sauver les libéraux.
A cette fin, la Russie doit idéologiquement être représentée comme quelque chose de pré- libérale. Il doit s’agir d’une Russie communiste, fasciste ou au moins national-bolcheviste. C’est la règle idéologique. Au-delà de combattre la Russie ou de juste considérer la possibilité de la combattre, il existe une tâche plus profonde qui consiste à qualifier idéologiquement la Russie. Cela se fera de l’intérieur et de l’extérieur. Ils essaieront de contraindre la Russie à accepter le communisme ou le nationalisme ou bien traiteront la Russie comme si elle était communiste ou nationaliste. C’est le jeu de la représentation.
La Russie post-libérale : la première guerre de la Quatrième Théorie Politique
En conclusion, je propose ce qui suit.
Nous devons consciencieusement combattre toute tentative visant à représenter la Russie comme une puissance pré-libérale. Nous ne devons pas laisser les libéraux se sauver de leur fin qui s’approche fatalement. Nous ne devons pas retarder cette fin mais l’accélérer. A cette fin, nous devons présenter la Russie non comme une entité pré-libérale mais comme une force révolutionnaire post-libérale combattant en faveur d’un futur alternatif pour tous les peuples de la planète. La guerre russe ne se fera pas pour les intérêts nationaux russes mais pour le monde multipolaire juste, pour la dignité authentique et la véritable liberté positive, non pas la liberté « par rapport à » mais la liberté « pour ». Dans cette guerre, la Russie deviendra le modèle de la défense de la Tradition, des valeurs conservatrices organiques et de la libération réelle de la société ouverte et de ses bénéficiaires : l’oligarchie financière mondiale. Cette guerre n’est pas contre les Ukrainiens ou une partie des Ukrainiens, ni contre l’Europe. C’est une guerre contre le (dés)ordre libéral mondial et nous n’allons pas sauver le libéralisme mais l’abattre une fois pour toutes. La Modernité était fausse pour l’essentiel. Nous sommes au stade terminal de la Modernité. Cela signifie la fin réelle de ceux qui ont fait de la Modernité leur propre destin ou qui l’ont inconsciemment laissé faire. En revanche, cela sera un nouveau commencement pour ceux qui sont du côté de la vérité éternelle de la Tradition, de la Foi, de l’essence humaine spirituelle et immortelle. Le combat le plus important actuellement est le combat pour la Quatrième Théorie Politique. C’est l’arme qui nous permettra d’empêcher que l’on représente Poutine comme les libéraux le voudraient. A l’aide de cette arme, nous pourrons réaffirmer que la Russie est la première puissance idéologique post-libérale combattant contre le libéralisme nihiliste pour le salut d’un futur ouvert, multipolaire et réellement libre.
06:53 | Lien permanent | Commentaires (0)
31/01/2014
Langues régionales: la cause des peuples
Pour défendre le français, la République doit renoncer au culte de l’uniformité
Frédéric Rouvillois
Le débat sur les langues régionales qui a eu lieu à l’Assemblée nationale les 22 et 23 janvier derniers confirme que le déboulonnage de la tradition républicaine se poursuit petit à petit – paradoxalement à l’instigation de ceux qui se proclament les héritiers les plus intransigeants de cette même tradition, et au grand dam des descendants de ceux qui en étaient jadis les adversaires les plus résolus.
Sous la Révolution française, la mise en place de cette « tradition » avait en effet consisté à escamoter systématiquement toutes les réalités naturelles, historiques, géographiques ou culturelles, remplacées par des institutions manifestant un pur volontarisme : l’objectif avoué étant de substituer aux vestiges d’un passé honni les artifices de la raison et de l’uniformisation – un néologisme inventé trois quarts de siècle plus tôt par l’un des inventeurs de l’idée de Progrès, l’abbé de Saint-Pierre – en vue de construire la République « une et indivisible ».
C’est ainsi qu’en décembre 1789, on établit la division départementale : pour des raisons pratiques, certes – permettre à chaque habitant des 83 départements d’arriver en moins d’une journée de cheval au chef-lieu de celui-ci -, mais surtout, idéologiques : car il s’agit d’abord, en inventant cette nouvelle carte, de briser des habitudes, des traditions, des attachements, des coutumes. Présentant la réforme le 3 novembre 1789, le conventionnel Thouret évoquait la nécessité de « détruire l’esprit de province, qui n’est dans l’État qu’un esprit individuel, ennemi du véritable esprit national. » Dans le même sens, on entreprend une véritable révolution toponymique, officialisée par un décret du 25 vendémiaire an II qui invite les communes à changer “les noms qui peuvent rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou de la superstition“.
Suivant la même logique, on (re)définit le peuple, en substituant aux « peuples » pluriels de l’Ancien régime, liés à un territoire, à une langue, à une culture spécifique – « les peuples de Provence, de Bretagne, de Bourgogne », etc.-, un Peuple unique, uniformisé, abstrait, formé d’individus indistincts et interchangeables, ce que l’on peut appeler un « Peuple légal », dans la mesure où il est défini par la constitution et n’existe que par elle. Selon l’article 7 de la constitution du 24 juin 1793, « le peuple est l’universalité des citoyens français » : il n’est plus désormais que l’ensemble de ceux qui, en vertu de la loi, ont le droit de participer à l’expression de la volonté générale – conformément aux thèses du Contrat social, où Rousseau affirmait que ce qui constitue le peuple n’est autre que le pacte par lequel les individus, quittant l’état de nature pour entrer ensemble dans l’état social, vont ce faisant, produire « un corps moral et collectif » appelé État dont les membres « prennent collectivement le nom de peuple, et s’appellent en particulier citoyens, comme participant à l’autorité souveraine. »
Enfin, on entreprend l’éradication des langues régionales : on connaît à ce propos le fameux Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française de l’abbé Grégoire, présenté à la Convention le 16 prairial an II (4 juin 1794). Un rapport qui s’organise autour d’un raisonnement très simple : le patois est un vestige du passé féodal, et un moyen de s’opposer au progrès, « un obstacle à la propagation des lumières », « un vecteur du fanatisme. » Par conséquent, il est indispensable de l’extirper si l’on veut fonder la République: « Avec trente patois différents, nous sommes encore, pour le langage, à la tour de Babel, tandis que, pour la liberté, nous formons l’avant-garde des nations. Mais au moins on peut uniformer le langage d’une grande nation, de manière que tous les citoyens qui la composent puissent sans obstacle se communiquer leurs pensées. Cette entreprise, qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l’organisation sociale et qui doit être jaloux de consacrer au plus tôt, dans une République une et indivisible, l’usage unique et invariable de la langue de la liberté. » Ainsi, pour « fondre tous les citoyens dans la masse nationale, simplifier le mécanisme et faciliter le jeu de la machine politique, il faut identité de langage. » Et donc, anéantissement des patois : « l’unité de l’idiome est une partie intégrante de la révolution. »
Or, ces trois « fondements granitiques » de la tradition républicaine – le découpage départemental, le Peuple conçu comme un ensemble de citoyens identiques et interchangeables, l’exclusivité de la langue française- sont tous en voie de déboulonnage. Et à chaque fois, c’est la gauche qui s’en charge, ou du moins, qui lance le processus, la droite défendant bec et ongles des principes et une logique qu’elle avait implacablement combattus pendant deux siècles.
Ainsi est-ce à la gauche socialiste que l’on doit la renaissance des régions en 1982, et peut être leur prochain renforcement, si François Hollande honore ses promesses ; c’est la gauche qui, en 1991, remet en avant la notion pré-révolutionnaire de peuple, avec la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse dont l’article premier dispose que « La République française garantit à la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français, les droits à la préservation de son identité culturelle et à la défense de ses intérêts économiques et sociaux spécifiques.» Et c’est encore la gauche qui, en déposant une proposition de loi constitutionnelle tendant à ratifier la Charte européenne des langues régionales, s’érige en promoteur des identités et des traditions, contre l’uniformisation archaïque inspirée de l’abbé Grégoire – « lui qui, notait Jean-Jacques Urvoas lors du débat parlementaire, disait, devant le comité d’instruction publique : « il faut extirper cette diversité d’idiomes grossiers qui prolonge l’enfance de la raison et la vieillesse des préjugés ». Une proposition suscitant la fureur d’Henri Guaino qui, lui, n’hésite pas à se réclamer du bon abbé, et s’étonner de « voir une partie de la gauche et de l’extrême gauche du XXIe siècle reprendre les arguments et les combats de l’extrême droite et des réactionnaires des XIXe et XXe siècles contre le legs de la Révolution française ».
Une fois de plus, on joue à fronts renversés. Est-ce à dire que les choses ont changé, au point de s’inverser, depuis 1951 et l’époque où Charles Maurras défendait, contre l’Académicien Georges Duhamel, une proposition de loi MRP visant à introduire à l’école l’enseignement des « dialectes » ? Pas vraiment : dans Jarres de Biot, l’essai qu’il consacrait à la question, le vieil écrivain royaliste notait déjà les menaces que l’hégémonie linguistique anglo-saxonne faisait peser sur le français. Et soulignait que l’objectif d’une revalorisation des langues régionales n’est pas de nuire, d’affaiblir ou de concurrencer la langue de Racine, mais au contraire, de la conforter et de l’enrichir – de même que la décentralisation a pour but de renforcer l’Etat, et que l’amour de la « petite patrie » préfigure celui qu’on doit à la grande.
Soixante trois ans plus tard, l’exposé des motifs de la proposition de loi prend acte que « la position de la République sur les langues régionales, traditionnellement réservée pour ne pas dire hostile, n’est plus tenable ». Qu’il n’y a plus lieu de considérer les préceptes de l’abbé Grégoire « comme la référence ultime et indépassable en matière de politique linguistique ». Bref, qu’il faut rompre avec le culte de l’uniformité, réconcilier la France « avec la multiplicité de ses racines », et ce faisant, adopter une position qui lui permettra de défendre de façon cohérente, au niveau international, la place du français face à l’anglais et aux langues dominantes.
10:41 | Lien permanent | Commentaires (0)
30/07/2013
Six naïvetés à propos du mot "race"

Par NATHALIE HEINICH Sociologue, CNRS
Libération du 25 juillet 2013
Le projet de suppression du mot «race» de la Constitution française repose sur plusieurs raisonnements implicites qui constituent autant de naïvetés, doublées d’un chantage sous-jacent à la rectitude morale. Tâchons d’y voir plus clair dans ces bêtises argumentatives.
1. S’insurger contre l’idée qu’existeraient des races humaines sous-entend que c’est leur réalité objective qui serait en question. Or, comme toute représentation, les races sont des conceptions de l’esprit humain consistant à agréger d’une certaine façon les faits observés (couleur de peau ou types de chevelures). Elles existent donc bien, mais seulement à titre de modes de catégorisation - exactement comme les «classes» sociales. Vouloir supprimer le mot pour tuer une chose qui n’existe que dans les esprits, c’est partir à la chasse aux fantômes (ou aux moulins à vent). Première naïveté.
2. Nier qu’il existerait des catégories «raciales» suppose de considérer que la notion de race renverrait à des regroupements non seulement réels (voir ci-dessus) mais aussi clairement différenciés, avec des frontières discontinues - de sorte qu’un être humain appartiendrait ou n’appartiendrait pas à telle ou telle race. C’est oublier qu’en matière de condition humaine les «catégories» sont rarissimes, alors qu’on a beaucoup plus souvent affaire à des «types», c’est-à-dire à des regroupements flous, de l’ordre du «plus ou moins» - de sorte qu’un être humain appartient plus ou moins à tel ou tel type racial (blanc, noir, asiatique, indien…). La notion de catégorie relève plutôt de la logique, alors que celle de type est plus adaptée à la réalité observée. Ceux qui «croient» à l’«existence» réelle de «catégories» raciales regardent aussi peu autour d’eux dans la rue que ceux qui n’y «croient» pas : les uns comme les autres confondent tant le type avec la catégorie que la réalité avec les représentations. Deuxième naïveté.
3. Vouloir supprimer le mot race parce qu’il ne renverrait pas à une réalité génétique, donc à un fait de «nature», n’a de sens qu’en vertu du raisonnement implicite selon lequel tout ce qui est «naturel» serait nécessaire et intangible, alors que tout ce qui est «social» serait arbitraire, donc modifiable. Pour pouvoir modifier un phénomène contraire à nos valeurs, il faudrait donc prouver qu’il est «socialement construit» - et donc, par exemple, que la race n’a aucun fondement génétique, ce qui rendrait cette notion arbitraire et le mot inutile. Classique méprise : en matière humaine, le «social», les institutions, les règles de vie commune, le langage etc., sont des réalités autrement plus contraignantes - ou «nécessaires» - que les réalités présumées «naturelles». Vouloir dénier tout fondement naturel à la perception des différences raciales (comme, sur un autre plan, des différences sexuées) n’enlève rien à la réalité, ni aux éventuels effets problématiques de ce phénomène social qu’est la perception des différences d’apparence. Troisième naïveté.
4. La dénégation des différences (de race, de sexe ou de catégorie sociale) repose sur un raisonnement implicite : toute différence impliquerait forcément une discrimination. C’est là la classique confusion entre similitude et égalité, qui plombe également une grande part du mouvement féministe actuel, persuadé qu’il faut nier la différence des sexes pour lutter contre les inégalités sexistes. Mais le racisme, contrairement à ce qu’on entend souvent, ne consiste pas à «croire que les hommes sont différents entre eux» : il consiste à croire qu’il existe entre eux des inégalités fondées sur la race. Vouloir remonter de l’inégalité à la différence pour mieux combattre la première est aussi intelligent que d’utiliser un marteau pour venir à bout d’une colonie de mouches dans un magasin de porcelaine. Quatrième naïveté.
5. Les opinions racistes ne sont pas fondées sur des arguments scientifiques, mais sur des affects, comme tout ce qui touche à l’amour et à la haine du prochain. Si ces opinions utilisent à l’occasion le langage de la «preuve» et la caution de la «science», ce n’est qu’à titre de rationalisation et d’argument de persuasion d’une opinion déjà constituée. Les spécialistes de psychosociologie des représentations savent bien qu’il ne sert à rien de combattre des croyances, des affects ou des rapports aux valeurs avec des contre-arguments scientifiques : on ne les combat qu’avec d’autres valeurs et, s’il le faut, avec des lois (qui, en matière de lutte contre le racisme, existent déjà). S’imaginer que la science génétique serait à même d’éradiquer le racisme est tout aussi irréaliste que d’imaginer qu’elle serait à même de le conforter. Cinquième naïveté.
6. Pour lutter contre une chose, il faut disposer de mots adéquats. Pour lutter contre la réalité du racisme, il faut bien pouvoir se considérer comme «antiraciste», stigmatiser les «racistes», et expliquer que quel que soit le degré d’existence ou de non-existence de différences fondées sur des types «raciaux», le comportement moral exige qu’on ne juge et traite les individus qu’en fonction des caractéristiques dont ils sont personnellement responsables, et non en fonction de propriétés avec lesquelles ils sont nés, telles que l’appartenance à un type racial, à un sexe, à une religion ou à un milieu social. Se priver de ces mots, c’est se priver des instruments pour combattre la chose. Sixième naïveté.
Arrivés à ce point, la conclusion s’impose : animé des meilleures intentions mais digne des pires régimes totalitaires, ce projet «politiquement correct» de modification autoritaire de la langue est simplement stupide.
Auteur du «Bêtisier du sociologue» (éd. Klincksieck, 2009). Dernier ouvrage paru : «Maisons perdues» (éd. Thierry Marchaisse).
16:15 | Lien permanent | Commentaires (2)
25/07/2013
La souveraineté européenne

Dans un article paru dans la revue Commentaire, il y a quelques années, Robert Kagan abordait de front l’opposition de l’Europe et des Etats-Unis au sujet de la représentation du statut de leur puissance. Il constatait avec lucidité que les cinquante dernières années, l'Europe a adopté un point de vue nouveau sur le rôle de la puissance dans les relations internationales, sous l’influence de la spécificité supposée de son histoire depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Rejetant les principes de la Machtpolitik des siècles de conquêtes qui ont fait sa grandeur, l’Europe a commencé à mettre l’accent surla négociation, la diplomatie et les liens commerciaux, la préférence donnée au droit international sur l'usage de la force, au multilatéralisme sur l'unilatéralisme. Cette évolution du discours stratégique européen s’accompagnait d’un ardent désir d’en finir à jamais avec la souveraineté, la hiérarchie, l’identité mais aussi la guerre, la peine de mort, l’autorité paternelle, la domination masculine…, c’est-à-dire avec toutes les déclinaisons de l’unilatéralisme d’une civilisation qui renonçait par-là à sa prétention à la supériorité, à l’impérialisme, à l’exemplarité ou à l’infaillibilité.
Ce renoncement a été longtemps mûri. Dans la poussière et les décombres d’une Allemagne sans autre identité que la défaite et la honte s’est forgée la terreuse pensée des vaincus de l’histoire : un attachement passionné aux droits fondamentaux et, comme on se méfiait tout de même de soi-même, la mise en place d’un dispositif interdisant d’y renoncer. La loyauté constitutionnelle est devenue le seul critère d’appartenance d’une nation qui a commencé par fêter la victoire de ses propres vainqueurs. L’orgueilleuse devise inscrite sur le fronton de l’Université de Fribourg-en-Brisgau, « Zum Ewigen Deutschtum », « A la germanité éternelle », faisait à présent officiellement honte aux Allemands.
Cet état d’esprit s’est progressivement propagé dans toute l’Europe occidentale.
10:54 | Lien permanent | Commentaires (0)
23/06/2013
Note sur la droite et la démocratie
Par Félix Morès
Forme d’organisation politique dans laquelle le pouvoir repose sur la volonté du peuple, la démocratie est aussi un projet, une valeur, un idéal. Quelles que soient les variations de son contenu dans le temps, elle ne se limite jamais à une seule opération formelle, au vox populi, vox dei des suffrages, mais recouvre un ensemble de droits, contenus dans les Déclarations des Droits de l’Homme successives, et se réalise dans l’exercice des libertés publiques (liberté d’opinion, de la presse, de réunion, d’association, etc.). Ce n’est pas la volonté brute du peuple, ce torrent révolutionnaire que redoutait Sieyès, qui est souveraine, mais bien son expression rationalisée, conformée - au moyen de la représentation ou du contrôle de la constitutionnalité des lois - aux exigences du droit constitutionnel « naturel » dérivé de la philosophie de « l’Ecole du droit naturel ». La démocratie ainsi entendue est indissociable du projet libéral. Sous un certain angle les deux notions paraissent s’opposer car, tandis que la démocratie invoque la volonté du peuple, le libéralisme se réfère à des valeurs raisonnables et immuables ; mais cette opposition, dialectique, se résout dans l’idée que l’individu accomplit pleinement son humanité dans sa capacité à formuler une volonté raisonnable. Le projet démocratique se confond ici avec le projet philosophique de la modernité.
01:55 | Lien permanent | Commentaires (0)
Petite généalogie du Pacte budgétaire européen
Par Félix Morès
Article paru dans Eléments, n° 146, Pacte budgétaire: la fin de la souveraineté.
« Dans le contexte de la montée générale du néo-libéralisme, écrit Perry Anderson, l’autosatisfaction des élites européennes et de leurs porte-parole accompagne le mépris des populations ».Ce mépris des populations n’est cependant pas de la condescendance mais un projet politique, qui transparait très clairement dans un rapport de la Commission Trilatérale, en 1975, intitulé The Crisis of Democracy. Invités à formuler un diagnostic, les experts, Michel Crozier, Samuel Huntington et Joji Watanuki, constataient que les gouvernants étaient devenus incapables de gouverner du fait de la trop grande implication des gouvernés dans la vie politique et sociale et se lamentaient de l’excès de démocratie. Le développement de l’Union européenne est depuis venu compenser cet excès démocratique par un déficit qui n’est donc pas un défaut mais un projet. Que le fonctionnement de l’Union ne doive pas être trop démocratique, c’est aussi ce que s’est attaché à démontrer et à justifier l’historien américain Andrew Moravcsik dans un ouvrage qui est aujourd’hui un classique de l’histoire de la construction européenne, The Choice for Europe. Nul doute que le Pacte budgétaire européen – un « Pacte contre la démocratie » - qui doit entrer bientôt en application illustre cette tendance.
01:41 | Lien permanent | Commentaires (0)
17/06/2013
La vie sexuelle de Christine L.
 L'ancienne ministre de l'économie, Christine Lagarde a été auditionnée le 23 mai par la Cour de justice de la République dans l'affaire Tapie-Lagarde. Lors de la perquisition que les enquêteurs ont effectuée à son domicile parisien, le 20 mars, ils ont trouvé une lettre manuscrite, non datée, destinée à Nicolas Sarkozy, en forme de serment d'allégeance.
L'ancienne ministre de l'économie, Christine Lagarde a été auditionnée le 23 mai par la Cour de justice de la République dans l'affaire Tapie-Lagarde. Lors de la perquisition que les enquêteurs ont effectuée à son domicile parisien, le 20 mars, ils ont trouvé une lettre manuscrite, non datée, destinée à Nicolas Sarkozy, en forme de serment d'allégeance.
"Cher Nicolas, très brièvement et respectueusement", écrit la patronne du FMI.
"1) Je suis à tes côtés pour te servir et servir tes projets pour la France.
2) J'ai fait de mon mieux et j'ai pu échouer périodiquement. Je t'en demande pardon.
3) Je n'ai pas d'ambitions politiques personnelles et je n'ai pas le désir de devenir une ambitieuse servile comme nombre de ceux qui t'entourent dont la loyauté est parfois récente et parfois peu durable.
4) Utilise-moi pendant le temps qui te convient et convient à ton action et à ton casting.
5) Si tu m'utilises, j'ai besoin de toi comme guide et comme soutien : sans guide, je risque d'être inefficace, sans soutien je risque d'être peu crédible. Avec mon immense admiration.
Christine L. "
13:27 | Lien permanent | Commentaires (0)
02/05/2013
e la nave va
 Marx, toujours d’actualité… Le grand retour à Marx : tel est l’incessant refrain des intellos vus-à-la-télé. Eh bien, chiche ! Qu’a dit Karl Marx au XIXe siècle, qui concerne aujourd’hui notre société ? “Les idées, les conceptions et les notions des hommes, en un mot, leur conscience, change avec tout changement survenu dans leurs conditions de vie, leurs relations sociales, leur existence sociale” : ainsi parlent Marx et Engels dans leur Manifeste du parti communiste ; ce, car “la production intellectuelle se transforme avec la production matérielle”. Conclusion :“Les idées dominantes d’une époque n’ont jamais été que les idées de la classe dominante.” Ainsi, les conditions sociales (l’infrastructure) déterminent-elles l’idéologie (la superstructure).
Marx, toujours d’actualité… Le grand retour à Marx : tel est l’incessant refrain des intellos vus-à-la-télé. Eh bien, chiche ! Qu’a dit Karl Marx au XIXe siècle, qui concerne aujourd’hui notre société ? “Les idées, les conceptions et les notions des hommes, en un mot, leur conscience, change avec tout changement survenu dans leurs conditions de vie, leurs relations sociales, leur existence sociale” : ainsi parlent Marx et Engels dans leur Manifeste du parti communiste ; ce, car “la production intellectuelle se transforme avec la production matérielle”. Conclusion :“Les idées dominantes d’une époque n’ont jamais été que les idées de la classe dominante.” Ainsi, les conditions sociales (l’infrastructure) déterminent-elles l’idéologie (la superstructure).
Une idée toujours juste en 2013. Voyons pourquoi.
Aujourd’hui, l’élite du capitalisme financier (banques, capital-risque, hedge-funds, etc.) forme une classe dominante qui possède la puissance matérielle, l’argent – l’infrastructure. Dans notre société “de l’information” (la superstructure), s’agrège à cette élite sa domesticité dans les médias, la communication, la publicité, l’intelligentsia et le spectacle.
Mais avant de voir pourquoi cette classe dominante, ses employés ou mercenaires, alarment professionnellement un criminologue, énonçons deux cruciaux préalables :
• La classe dominante est régie par une coalition de milliardaires-prédateurs dont les extravagantes rétributions et fortunes sont au-delà même de l’indécence. L’un de ces ploutocrates américains gagne ainsi un million de dollars par jour – 700 dollars la minute. Rappel : l’an passé, le salaire annuel moyen (masculin) est de 45 200 dollars aux Etats-Unis, où un diplômé du supérieur (cadre dirigeant, profession libérale) gagne dans sa vie 2,3 millions de dollars en moyenne.
• Depuis bientôt trente ans, la classe dominante nous vante une “mondialisation heureuse”, dont les résultats concrets sont bien plutôt :
- une précarité économique croissante,
- plus d’inégalités et d’aliénation,
- une exploitation désastreuse de la nature,
- un progressif dédain pour l’essentiel non immédiatement rentable (sanitaire, scientifique, etc.).
Retour à l’idéologie dominante.
Naguère, ce “progressisme transnational” (John Fonte, Hudson Institute) prônait déjà “les migrations et le multiculturalisme” et la “haine des histoires nationales et de leurs symboles”. Or désormais, cette idéologie tourne à l’anarchisme. Combinant les noms de son plus illustre acteur et de son haut-parleur fétiche, nous nommons cette forme dominante de nihilisme social “Davos-Goldman-Sachs Idéologie”, ou DGSI.
Et voilà où le criminologue se doit d’intervenir : toujours plus, la DGSI s’acharne à nier les ravages du crime organisé et l’aveuglante face noire de la mondialisation. Partout où s’exerce son pouvoir, la DGSI banalise ou folklorise le crime et dénigre ou ridiculise ses victimes.
De ce dédaigneux négationnisme, quelques accablantes preuves.
- En mars 2013, le Wall Street Journal et Citibank, deux chantres de la DGSI, décernent leur prix annuel de la “ville la plus innovante” à… Medellin (Colombie). Medellin ! L’une des “25 villes les plus dangereuses du monde”. 2013 y débute par un massacre entre “deux factions criminelles s’affrontant pour y dominer les trafics”, et autres jets de grenade dans les bus. Medellin où l’an passé “11 401 habitants ont dû fuir leurs logements du fait de la guerre des gangs”, et où “des centaines d’enfants renoncent à l’école, les rues étant transformées en stands de tir”. Medellin où, ces six derniers mois, les homicides ont bondi de 70 %.
- Et le Wall Street Journal, toujours, qui s’enthousiasme des “progrès de l’économie mexicaine”, sans jamais piper mot sur le moteur même dudit “progrès” : l’annuelle injection des dizaines de milliards du narcotrafic dans le système financier du pays.
- Et le fort glauque M. Soros dont la fortune est “estimée à 14 milliards de dollars par la revue Forbes” (le Monde, 9/09/2010) et qui en distribue les miettes à entretenir des provocateurs et des “sociologues critiques”, le tout bien sûr pour “détruire des clichés” et “combattre des idées reçues”. Récemment, les “fondations charitables” de M. Soros ont ainsi financé la campagne californienne pour la libéralisation du cannabis, le “collectif contre l’islamophobie en France” et des études sur les “contrôles au faciès” de divers Diafoirus-sociologues – destinées bien sûr à accabler la police. Diafoirus et agitateurs acceptant sans sourciller les prébendes d’un prédateur encore condamné en octobre 2011 à 2,2 millions d’euros d’amende pour “délit d’initié”.
- Et The Economist, organe quasi officiel de la DGSI, qui prône à tout-va la libéralisation des drogues.
- Et la Fondation Ford qui finance (72 724 euros, dernier bilan publié) ce pur et simple outil d’intimidation qu’est SOS Racisme.
Telles sont les idées dominantes d’aujourd’hui, imposées à coups de milliards par des prédateurs qui sont, au banquier du coin, ce que le Velociraptor est à Bambi.
Leur arme – Marx n’y avait pas songé – la “fondation charitable”. Selon la revue américaine The Atlantic, “pour la ploutocratie du XXIe siècle, le symbole majeur du prestige n’est pas le yacht, le cheval de course ou le titre de noblesse ; c’est la fondation philanthropique”. Générosité ? Vous voulez rire – un outil d’évasion fiscale. Le Monde, 19/04/2011 : “Cette philanthropie est en partie financée par l’optimisation fiscale qui permet de faire transiter les profits entre plusieurs pays d’activité par le truchement de places offshore”, d’où une fort légale et alléchante “réduction de l’argent acquitté au Trésor”.
Leur propagande mondialiste financée en truandant le fisc ! La vie des ploutocrates est un rêve. Ainsi grimés en dames patronnesses prétendant “faire le bien”, ces prédateurs disposent d’un second et puissant outil de propagande : leurs propres médias. Ce sera le sujet de notre prochaine chronique.
Xavier Raufer (Nouvel Economiste, 15 avril 2013)
07:59 | Lien permanent | Commentaires (0)
21/03/2013
Droits des chimères

Eléments de réflexions et d'analyse autour du statut juridique des "chimères réelles" et de l'animal, dans les xénogreffes et les biotechnologies
par Jordane SEGURA-CARISSIMI, docteur en Droit privé et sciences criminelles, juriste-chercheur, chargée d'études au CEPS/INSTEAD
1 - L'annonce récente, selon laquelle les députés britanniques ont autorisé des scientifiques à créer des embryons hybrides dédiés à la recherche médicale et issus de l'intégration d'ADN humain dans des ovules d'animaux, peut relancer l'interrogation et la réflexion portant sur le « mélange effectif» d'éléments biologiques d'origine humaine et animale.
2 - Le professeur Jean-Pierre Marguénaud s'est notamment intéressé à ces êtres vivants « dont on ne sait s'ils doivent ou devront être considérés comme des personnes humaines ou comme des choses animées, c'est-à-dire des animaux». Plus précisément, l'auteur envisage, d'une part, le cas des êtres considérés comme des monstres en raison de leur difformité et auxquels s'applique la règle selon laquelle la personnalité juridique est attribuée à des êtres humains nés vivants et viables et, d'autre part, le cas des êtres monstrueux qui vivent entre humanité et animalité (2) . Ces êtres monstrueux vivant entre humanité et animalité relèvent déjà de la mythologie et des légendes anciennes, voire de la science-fiction et de la littérature fantastique. Ils sont le fruit de l'imagination ou de la croyance des hommes et n'entrent pas dans les préoccupations juridiques contemporaines. Cependant, outre la découverte d'êtres appelés les « enfants-loups», « enfants-animaux» ou « hommes sauvages» (3) , vivant culturellement entre humanité et animalité, l'évolution de la science a rendu possible l'existence d'êtres réels, vivant entre humanité et animalité, et participant biologiquement des deux. La science peut donc donner naissance à des « chimères réelles». Ainsi, la création d'êtres hybrides hommes-singes est techniquement possible (4) . En février 2005, un scientifique américain a réalisé une telle « chimère», en «mélangeant» un embryon humain et un embryon singe, plaçant l'Office américain des brevets face à la difficulté de déterminer la frontière entre l'homme et l'animal (5) . De plus, depuis les années 1980, les scientifiques ont constaté qu'au début de son développement, alors que le système immunitaire n'est pas encore formé, un foetus animal pouvait recevoir des tissus provenant d'une autre espèce, sans les rejeter. Une fois né, l'animal constitue une « chimère», puisqu'il possède des cellules ayant les caractères génétiques d'une autre espèce animale. Cette technique pourrait être appliquée au foetus humain : « Les scientifiques sont convaincus que les recherches portant sur les foetus animaux et humains vont enfin offrir la possibilité de franchir la barrière des espèces dans les cas de transplantation d'organes animaux. Il suffirait pour cela de greffer des cellules animales sur l'organe malade du foetus humain, par exemple un coeur ou un foie, de façon à ce que ce dernier induise une tolérance. Sitôt après la naissance du bébé, on pourrait alors greffer un foie ou un coeur d'animal, sans risque de rejet. Sous réserve d'une manipulation dans l'oeuf, chacun d'entre nous pourrait subir une transplantation d'organe de porc ou de singe dans les premiers mois de sa vie» (6) .
3 - Plusieurs critères peuvent être proposés afin de qualifier juridiquement l'être issu de la fusion de cellules humaines et animales, implantée dans l'utérus d'une femme. Biologiquement, l'être humain peut être appréhendé comme « le produit de la rencontre des gamètes d'un homme et d'une femme». Cela conduit le professeur Gérard Mémeteau à considérer la chimère comme un produit d'une autre nature, devant être reconnu comme un être non-humain, dépourvu de personnalité (7) . Génétiquement, l'être humain peut se définir par rapport aux informations génétiques contenues dans son génome. Ainsi, la chimère, qui ne possèderait pas intégralement ces caractéristiques génétiques, serait là encore rejetée au-delà des frontières de l'humanité et assimilée à une chose. Cependant, ce critère génétique abandonne la définition juridique de l'homme aux seules données de la science, laissant de côté les dimensions culturelles, religieuses et philosophiques de l'être humain et permettant l'appropriation d'êtres se trouvant biologiquement entre l'humanité et l'animalité, mais dont on ne saurait totalement nier les caractéristiques humaines. Le professeur Eschbach nous invitait déjà, en 1847, à retenir comme critère le fait qu'un être doive être qualifié d'homme dès lors qu'il est issu d'une femme et ce, quelle que soit sa difformité (8) . Même si cette solution est antérieure à l'évolution récente de la science et des techniques de recherche, elle demeure toujours relativement pertinente et permet d'accorder la personnalité juridique ainsi que la protection issue des droits de l'homme à la « chimère» réelle créée par les scientifiques. Le respect de l'éthique doit bien évidemment conduire l'homme de science à ne pas transgresser de façon absolue les limites posées par la nature, en créant des êtres totalement chimériques, rappelant les « monstres» du passé ou des légendes. Toutefois, la législation la plus stricte ne peut prévenir toute transgression. Dans ce cas, accorder la personnalité et reconnaître l'humanité de tels êtres chimériques peut apparaître comme la solution la meilleure. Néanmoins, dans le texte récemment voté par les députés britanniques et qui autorise la création d'embryons hybrides, il est prévu que ces embryons ne pourront pas être implantés chez un animal ou un humain et qu'ils devront être détruits dans les quatorze jours.
4 - L'existence de « chimères réelles» renvoie également à la pratique des xénogreffes. Très simplement, la xénogreffe peut se définir comme étant la greffe d'un organe animal chez l'homme, mais elle se caractérise par une certaine diversité de techniques et de pratiques. La xénogreffe est déjà couramment pratiquée comme dispositif médical, avec l'utilisation de tissus d'origine animale rendus non viables ou de produits non viables dérivés de tissus d'origine animale : utilisation habituelle de valves cardiaques porcines, d'implants de pontage coronarien, de tendons, d'implants cristalliniens d'origine animale, notamment. Plus précaire est encore la technique de la greffe d'organes, comme le foie ou le coeur, provenant d'un animal et envisagée comme une alternative à l'allogreffe, comme une solution à la pénurie d'organes humains et à la multiplication des trafics d'organes. De telles interventions ont été pratiquées dès le XIXe siècle de façon limitée et le XXesiècle consacra les premières véritables greffes animales chez l'homme, dont l'histoire de Baby Fae, bébé prématuré ayant survécu vingt jours avec un coeur de babouin, constitue une illustration très médiatique et dramatique, en 1985. Outre les questions relatives à la licéité et à la légalité de la xénogreffe (9) , le développement de cette technique de greffe d'organes animaux soulève des questions portant sur la légitimité de la xénogreffe et concernant directement l'animal, porteur et donneur d'organes destinés à l'homme.
5 - La question des xénogreffes - et de leur légitimité - soulève ainsi, implicitement, la question du statut juridique de l'animal (10) . Les principes d'utilité sociale et de subsidiarité justifient la légitimité des transplantations d'organes animaux chez l'homme. L'animal-chose, tel qu'il est reconnu par le Code civil qui le classe expressément dans la catégorie des choses juridiques, meubles par nature ou immeubles par destination (11) , peut alors servir de réservoir d'organes pour l'espèce humaine et être sacrifié pour permettre la transplantation de ses organes chez un être humain.
6 - Toutefois, la reconnaissance de l'animal comme être vivant et sensible - par le Code pénal, notamment, qui le protège contre les atteintes à sa vie et à son intégrité - pose les limites de la pratique des xénogreffes. Ainsi, dans ce domaine, même si l'animal peut subir une atteinte volontaire à sa vie, dans la mesure où l'une des conditions premières de la réalisation de l'opération est le sacrifice de l'animal, celui-ci ne doit pas être exposé à des mauvais traitements, des actes de cruauté ou des sévices graves (12) . Des considérations de protection animale peuvent donc limiter la pratique des xénogreffes. Par exemple, au Royaume-Uni, le Nuffield Council on Bioethics - le Comité national d'éthique du Royaume-Uni - a rendu, en 1996, un rapport suggérant la poursuite des travaux dans le domaine des xénogreffes, sous réserve du respect de règles rigoureuses assurant le bien-être des animaux (13) . Le respect du bien-être animal est également prescrit par les conclusions et recommandations de la consultation sur les xénotransplantations tenue à Genève du 28 au 30 octobre 1997 (14) . L'éthique de l'expérimentation animale constitue aussi une limite à la pratique des xénogreffes qui nécessitera certainement une intensification du clonage des animaux ou, tout au moins, une modification génétique de ceux-ci. La modification génétique des animaux doit ainsi être justifiée sur le plan éthique et réalisée dans des conditions éthiquement acceptables, ce qui implique le devoir d'éviter ou de réduire la souffrance animale, l'animal ne devant pas être soumis à une souffrance injustifiée ou disproportionnée, ainsi que l'obligation de réduire et de remplacer, lorsque cela est possible, les expériences sur les animaux (15) .
7 - La « pluralité» actuelle du statut juridique de l'animal constitue donc à la fois une légitimation (animal-chose du Code civil) et une limite (animal, être vivant et sensible juridiquement protégé) à la pratique des xénogreffes. Cette pratique contribue à permettre l'existence d'êtres hybrides qui soulève la problématique de l'ambiguïté du statut juridique de ces êtres et du statut juridique de l'animal dans les xénogreffes.
8 - D'une part, suite à une xénogreffe, un être humain va vivre en ayant, dans son corps, un ou des organes animaux. Cet être peut, a priori, être qualifié de « chimère réelle», car il correspond à un homme doté d'organes provenant d'une autre espèce. Toutefois, son statut ne fait aucun doute : il est un homme, sujet de droits, doté de la personnalité juridique. La présence d'organes animaux dans son corps ne remet pas en cause son statut juridique. Déjà aujourd'hui, les individus sur lesquels sont implantés des tissus ou des produits d'origine animale ne voient pas leur statut d'êtres humains, de personnes juridiques, remis en cause sur ce fondement. Il en est de même lorsque l'individu reçoit un organe d'origine animale, qui intègre la personne juridique et perd ainsi sa nature première animale. L'organe devient un élément du corps humain qui suit le régime juridique de la personne et peut alors être considéré, du fait de l'incorporation dans le corps de l'homme, comme une « personne par incorporation» (16) .
9 - D'autre part, en amont de la xénogreffe, des animaux sont porteurs d'organes qui sont destinés à l'homme, destinés à devenir des organes humains. Là encore, la science utilise des êtres qui peuvent être qualifiés de « chimères réelles». Ces animaux seront, le plus souvent, modifiés génétiquement, de façon à limiter au maximum les risques de rejet de leurs organes par les receveurs humains. Ces êtres demeurent bien des animaux, même modifiés génétiquement. Cependant, leurs organes peuvent être appréciés comme des organes humains « par destination», puisque, organes animaux, ils sont destinés à devenir des organes de l'homme receveur. Le droit positif n'envisage pas particulièrement la situation juridique de ces animaux qui demeurent des choses. Mais la question de leur statut propre et de celui de leurs organes peut laisser subsister objectivement des zones d'incertitudes.
10 - En outre, un parallèle peut être établi avec les immeubles par destination. L'immeuble par destination a ou perd cette qualité selon qu'il est attaché ou non à l'immeuble par nature ; il est également nécessairement détachable, contrairement au meuble incorporé dans l'immeuble par nature. Or, l'organe animal est détachable de l'animal porteur. Mais, une fois incorporé dans le corps de l'homme receveur, cet organe ne sera plus détachable, sauf pour raison médicale. L'animal porteur de l'organe destiné à l'homme n'est pas une personne juridique. Et, alors que l'immobilisation par destination n'est effective que si le meuble et l'immeuble appartiennent au même propriétaire, l'homme n'est pas propriétaire de son corps, qui reçoit l'organe issu de l'animal. Les organes de l'animal porteur ne peuvent donc pas être considérés comme « personnes par destination», mais uniquement comme « organes humains par destination», ce qui ne correspond à aucun statut particulier, mais pourrait entraîner l'application des règles relatives aux organes humains, dans l'hypothèse des greffes (17) . Une fois que l'organe est prélevé et incorporé dans le corps de l'homme, il devient «personne par incorporation», comme envisagé précédemment.
11 - Enfin, la question de la brevetabilité du vivant peut également se poser, en ce qui concerne les animaux transgéniques et la xénotransplantation, qui a pour but la transplantation d'un organe animal chez un être humain. Le porc, dont les organes ont une taille et une physiologie qui les rendent très semblables à ceux des humains, est l'animal utilisé comme fournisseur des organes destinés à la xénotransplantation. Afin d'augmenter les chances de réussite de l'opération, c'est-à-dire dans le but de rendre le patrimoine génétique de l'animal davantage compatible avec celui de l'homme et d'écarter au maximum les possibilités de rejet ou d'infections, le patrimoine génétique du porc subit des modifications génétiques. Des brevets portant sur l'animal transgénique utilisé à des fins de xénotransplantation peuvent être sollicités. Les réponses juridiques données au problème de la brevetabilité de cet animal éclairent le débat sur le statut de l'animal dans les biotechnologies (18) . L'exemple du droit des brevets met en effet en exergue la réification continue de l'animal. La reconnaissance juridique de la brevetabilité du vivant entraîne une nouvelle considération de la vie, en raison du déplacement des critères, du vivant à l'activité de l'homme. Ainsi, le critère du vivant ne suffit pas à distinguer nettement l'animal des autres choses. L'animal, être vivant, est essentiellement appréhendé comme res, qui peut être l'objet de brevet. L'ensemble du débat tient alors au souci d'éviter l'appropriation du vivant, d'une espèce (19) . Il s'agit d'empêcher que tous les individus d'une même espèce deviennent la propriété d'une seule société, titulaire d'un brevet. L'animal utilisé dans les xénogreffes et modifié génétiquement à cette fin n'apparaît plus que comme un réservoir d'organes pour l'homme. Les xénogreffes ont des justifications éthiques, morales, médicales. Il n'en demeure pas moins vrai que l'animal est alors toujours rapproché de la chose et traité comme une simple chose, afin de permettre de telles opérations et d'en assurer une exploitation lucrative par l'obtention de brevets (20) .
Gazette du Palais, 30 décembre 2008 n° 365, P. 62 - Tous droits réservés
13:18 | Lien permanent | Commentaires (1)
14/03/2013
Pourquoi j'ai rompu avec la gauche
Jean-Claude Michéa: "Pourquoi j'ai rompu avec la gauche"
Mardi 12 Mars 2013 (MARIANNE)
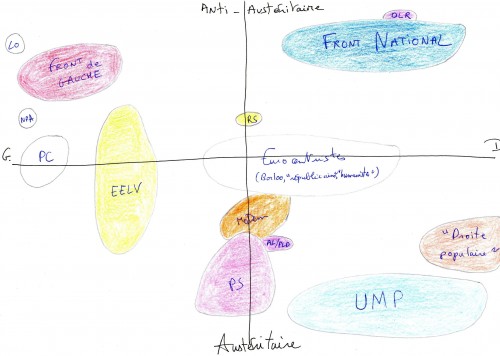 Toujours imprégné de libéralisme mitterrandien, le socialisme à la Hollande ne convainc pas le philosophe Jean-Claude Michéa. A l'occasion de son nouveau livre, "les Mystères de la gauche", il s'en explique en exclusivité pour "Marianne".
Toujours imprégné de libéralisme mitterrandien, le socialisme à la Hollande ne convainc pas le philosophe Jean-Claude Michéa. A l'occasion de son nouveau livre, "les Mystères de la gauche", il s'en explique en exclusivité pour "Marianne".
Au moins depuis la parution d'Impasse Adam Smith en 2002, un livre de Jean-Claude Michéa est toujours attendu. Avec jubilation. Ou avec un fusil, c'est selon. D'abord parce que la parole de ce philosophe, nourri à la pensée de George Orwell, de Guy Debord et du meilleur Marx, est extrêmement rare dans les médias. Ensuite parce qu'il appartient à cette espèce politiquement ambidextre, hélas si peu représentée et si mal comprise, capable de se montrer aussi cruel à l'égard d'une gauche libérale qui s'autocaricature en valorisant toutes les prétendues transgressions morales et culturelles, qu'il sait se montrer lucide à l'égard de l'incroyable cynisme des dirigeants de la droite actuelle (Sarkozy et Copé en tête), lorsqu'ils se posent en défenseurs des «petites gens», que vient en fait piétiner tout leur programme économique, voué à l'expansion illimitée des intérêts du CAC 40.
Disons-le d'emblée : les Mystères de la gauche (Climats) est le livre que l'on espérait depuis plusieurs années de la part de Michéa. Sur plusieurs points capitaux, celui-ci s'explique en effet. Notamment sur son refus définitif de se réclamer de «la gauche», pour penser le front de libération populaire qu'il appelle de ses vœux. «La gauche», un signifiant-maître trop longtemps prostitué, et qu'il juge désormais «inutilement diviseur, dès lors qu'il s'agit de rallier les classes populaires». Aussi parce que le philosophe répond au passage aux procès en droitisation qui lui sont régulièrement faits. Ainsi cet anticapitaliste conservateur admet-il ici que l'attachement aux «valeurs traditionnelles» peut produire des dérives inquiétantes, et que, «sur ce point, les mises en garde permanentes de la gauche conservent tout leur sens». Un grand millésime donc, pour l'orwellien de Montpellier. Percutant, souvent hilarant dans sa façon de moquer l'autocélébration de la gauche en «parti de demain» (Zola), Michéa dérange, éclaire, emporte presque toujours la conviction.
Marianne : Vous estimez urgent d'abandonner le nom de «gauche», de changer de signifiant pour désigner les forces politiques qui prendraient à nouveau en compte les intérêts de la classe ouvrière... Un nom ne peut-il pourtant ressusciter par-delà ses blessures historiques, ses échecs, ses encombrements passés ? Le problème est d'ailleurs exactement le même pour le mot «socialisme», qui après avoir qualifié l'entraide ouvrière chez un Pierre Leroux s'est mis, tout à fait a contrario, à désigner dans les années 80 les turlupinades d'un Jack Lang. Ne pourrait-on voir dans ce désir d'abolir un nom de l'histoire comme un écho déplaisant de cet esprit de la table rase que vous dénoncez sans relâche par ailleurs ?
Jean-Claude Michéa : Si j'en suis venu - à la suite, entre autres, de Cornelius Castoriadis et de Christopher Lasch - à remettre en question le fonctionnement, devenu aujourd'hui mystificateur, du vieux clivage gauche-droite, c'est simplement dans la mesure où le compromis historique forgé, au lendemain de l'affaire Dreyfus, entre le mouvement ouvrier socialiste et la gauche libérale et républicaine (ce «parti du mouvement» dont le parti radical et la franc-maçonnerie voltairienne constituaient, à l'époque, l'aile marchante) me semble désormais avoir épuisé toutes ses vertus positives. A l'origine, en effet, il s'agissait seulement de nouer une alliance défensive contre cet ennemi commun qu'incarnait alors la toute-puissante «réaction». Autrement dit, un ensemble hétéroclite de forces essentiellement précapitalistes qui espéraient encore pouvoir restaurer tout ou partie de l'Ancien Régime et, notamment, la domination sans partage de l'Eglise catholique sur les institutions et les âmes. Or cette droite réactionnaire, cléricale et monarchiste a été définitivement balayée en 1945 et ses derniers vestiges en Mai 68 (ce qu'on appelle de nos jours la «droite» ne désigne généralement plus, en effet, que les partisans du libéralisme économique de Friedrich Hayek et de Milton Friedman). Privé de son ennemi constitutif et des cibles précises qu'il incarnait (comme, la famille patriarcale ou l'«alliance du trône et de l'autel») le «parti du mouvement» se trouvait dès lors condamné, s'il voulait conserver son identité initiale, à prolonger indéfiniment son travail de «modernisation» intégrale du monde d'avant (ce qui explique que, de nos jours, «être de gauche» ne signifie plus que la seule aptitude à devancer fièrement tous les mouvements qui travaillent la société capitaliste moderne, qu'ils soient ou non conformes à l'intérêt du peuple, ou même au simple bon sens). Or, si les premiers socialistes partageaient bien avec cette gauche libérale et républicaine le refus de toutes les institutions oppressives et inégalitaires de l'Ancien Régime, ils n'entendaient nullement abolir l'ensemble des solidarités populaires traditionnelles ni donc s'attaquer aux fondements mêmes du «lien social» (car c'est bien ce qui doit inéluctablement arriver lorsqu'on prétend fonder une «société» moderne - dans l'ignorance de toutes les données de l'anthropologie et de la psychologie - sur la seule base de l'accord privé entre des individus supposés «indépendants par nature»). La critique socialiste des effets atomisants et humainement destructeurs de la croyance libérale selon laquelle le marché et le droit ab-strait pourraient constituer, selon les mots de Jean-Baptiste Say, un «ciment social» suffisant (Engels écrivait, dès 1843, que la conséquence ultime de cette logique serait, un jour, de «dissoudre la famille») devenait dès lors clairement incompatible avec ce culte du «mouvement» comme fin en soi, dont Eduard Bernstein avait formulé le principe dès la fin du XIXe siècle en proclamant que «le but final n'est rien» et que «le mouvement est tout». Pour liquider cette alliance désormais privée d'objet avec les partisans du socialisme et récupérer ainsi son indépendance originelle, il ne manquait donc plus à la «nouvelle» gauche que d'imposer médiatiquement l'idée que toute critique de l'économie de marché ou de l'idéologie des droits de l'homme (ce «pompeux catalogue des droits de l'homme» que Marx opposait, dans le Capital, à l'idée d'une modeste «Magna Carta» susceptible de protéger réellement les seules libertés individuelles et collectives fondamentales) devait nécessairement conduire au «goulag» et au «totalitarisme». Mission accomplie dès la fin des années 70 par cette «nouvelle philosophie» devenue, à présent, la théologie officielle de la société du spectacle. Dans ces conditions, je persiste à penser qu'il est devenu aujourd'hui politiquement inefficace, voire dangereux, de continuer à placer un programme de sortie progressive du capitalisme sous le signe exclusif d'un mouvement idéologique dont la mission émancipatrice a pris fin, pour l'essentiel, le jour où la droite réactionnaire, monarchiste et cléricale a définitivement disparu du paysage politique. Le socialisme est, par définition, incompatible avec l'exploitation capitaliste. La gauche, hélas, non. Et si tant de travailleurs - indépendants ou salariés - votent désormais à droite, ou surtout ne votent plus, c'est bien souvent parce qu'ils ont perçu intuitivement cette triste vérité.
Vous rappelez très bien dans les Mystères de la gauche les nombreux crimes commis par la gauche libérale contre le peuple, et notamment le fait que les deux répressions ouvrières les plus sanglantes du XIXe siècle sont à mettre à son compte. Mais aujourd'hui, tout de même, depuis que l'inventaire critique de la gauche culturelle mitterrandienne s'est banalisé, ne peut-on admettre que les socialistes ont changé ? Un certain nombre de prises de conscience importantes ont eu lieu. Celle, par exemple, du long abandon de la classe ouvrière est récente, mais elle est réelle. Sur les questions de sécurité également, on ne peut pas davantage dire qu'un Manuel Valls incarne une gauche permissive et angéliste. Or on a parfois l'impression à vous lire que la gauche, par principe, ne pourra jamais se réformer... Est-ce votre sentiment définitif ?
J.-C.M. : Ce qui me frappe plutôt, c'est que les choses se passent exactement comme je l'avais prévu. Dès lors, en effet, que la gauche et la droite s'accordent pour considérer l'économie capitaliste comme l'horizon indépassable de notre temps (ce n'est pas un hasard si Christine Lagarde a été nommée à la tête du FMI pour y poursuivre la même politique que DSK), il était inévitable que la gauche - une fois revenue au pouvoir dans le cadre soigneusement verrouillé de l'«alternative unique» - cherche à masquer électoralement cette complicité idéologique sous le rideau fumigène des seules questions «sociétales». De là le désolant spectacle actuel. Alors que le système capitaliste mondial se dirige tranquillement vers l'iceberg, nous assistons à une foire d'empoigne surréaliste entre ceux qui ont pour unique mission de défendre toutes les implications anthropologiques et culturelles de ce système et ceux qui doivent faire semblant de s'y opposer (le postulat philosophique commun à tous ces libéraux étant, bien entendu, le droit absolu pour chacun de faire ce qu'il veut de son corps et de son argent). Mais je n'ai là aucun mérite. C'est Guy Debord qui annonçait, il y a vingt ans déjà, que les développements à venir du capitalisme moderne trouveraient nécessairement leur alibi idéologique majeur dans la lutte contre «le racisme, l'antimodernisme et l'homophobie» (d'où, ajoutait-il, ce «néomoralisme indigné que simulent les actuels moutons de l'intelligentsia»). Quant aux postures martiales d'un Manuel Valls, elles ne constituent qu'un effet de communication. La véritable position de gauche sur ces questions reste bien évidemment celle de cette ancienne groupie de Bernard Tapie et d'Edouard Balladur qu'est Christiane Taubira.
Contrairement à d'autres, ce qui vous tient aujourd'hui encore éloigné de la «gauche de la gauche», des altermondialistes et autres mouvements d'indignés, ce n'est pas l'invocation d'un passé totalitaire dont ces lointains petits cousins des communistes seraient encore comptables... C'est au contraire le fond libéral de ces mouvements : l'individu isolé manifestant pour le droit à rester un individu isolé, c'est ainsi que vous les décrivez. N'y a-t-il cependant aucune de ces luttes, aucun de ces mouvements avec lequel vous vous soyez senti en affinité ces dernières années ?
J.-C.M. : Si l'on admet que le capitalisme est devenu un fait social total - inséparable, à ce titre, d'une culture et d'un mode de vie spécifiques -, il est clair que les critiques les plus lucides et les plus radicales de cette nouvelle civilisation sont à chercher du côté des partisans de la «décroissance». En entendant par là, naturellement, non pas une «croissance négative» ou une austérité généralisée (comme voudraient le faire croire, par exemple, Laurence Parisot ou Najat Vallaud-Belkacem), mais la nécessaire remise en question d'un mode de vie quotidien aliénant, fondé - disait Marx - sur l'unique nécessité de «produire pour produire et d'accumuler pour accumuler». Mode de vie forcément privé de tout sens humain réel, inégalitaire (puisque la logique de l'accumulation du capital conduit inévitablement à concentrer la richesse à un pôle de la société mondiale et l'austérité, voire la misère, à l'autre pôle) et, de toute façon, impossible à universaliser sans contradiction dans un monde dont les ressources naturelles sont, par définition, limitées (on sait, en effet, qu'il faudrait déjà plusieurs planètes pour étendre à l'humanité tout entière le niveau de vie actuel de l'Américain moyen). J'observe avec intérêt que ces idées de bon sens - bien que toujours présentées de façon mensongère et caricaturale par la propagande médiatique et ses économistes à gages - commencent à être comprises par un public toujours plus large. Souhaitons seulement qu'il ne soit pas déjà trop tard. Rien ne garantit, en effet, que l'effondrement, à terme inéluctable, du nouvel Empire romain mondialisé donnera naissance à une société décente plutôt qu'à un monde barbare, policier et mafieux.
Vous réaffirmez dans ce livre votre foi en l'idée que le peuple serait dépositaire d'une common decency [«décence ordinaire», l'expression est de George Orwell] avec lesquelles les «élites» libérales auraient toujours davantage rompu. Mais croyez-vous sincèrement que ce soit aujourd'hui l'attachement aux valeurs morales qui définisse «le petit peuple de droite», ainsi que vous l'écrivez ici ? Le désossage des structures sociales traditionnelles, ajouté à la déchristianisation et à l'impact des flux médiatiques dont vous décrivez ici les effets culturellement catastrophiques, a également touché de plein fouet ces classes-là. N'y a-t-il donc pas là quelque illusion - tout à fait noble, mais bel et bien inopérante - à les envisager ainsi comme le seul vivier possible d'un réarmement moral et politique ?
J.-C.M. : S'il n'y avait pas, parmi les classes populaires qui votent pour les partis de droite, un attachement encore massif à l'idée orwellienne qu'il y a «des choses qui ne se font pas», on ne comprendrait pas pourquoi les dirigeants de ces partis sont en permanence contraints de simuler, voire de surjouer de façon grotesque, leur propre adhésion sans faille aux valeurs de la décence ordinaire. Alors même qu'ils sont intimement convaincus, pour reprendre les propos récents de l'idéologue libéral Philippe Manière, que seul l'«appât du gain» peut soutenir «moralement» la dynamique du capital (sous ce rapport, il est certainement plus dur d'être un politicien de droite qu'un politicien de gauche). C'est d'ailleurs ce qui explique que le petit peuple de droite soit structurellement condamné au désespoir politique (d'où son penchant logique, à partir d'un certain seuil de désillusion, pour le vote d'«extrême droite»). Comme l'écrivait le critique radical américain Thomas Franck, ce petit peuple vote pour le candidat de droite en croyant que lui seul pourra remettre un peu d'ordre et de décence dans cette société sans âme et, au final, il se retrouve toujours avec la seule privatisation de l'électricité ! Cela dit, vous avez raison. La logique de l'individualisme libéral, en sapant continuellement toutes les formes de solidarité populaire encore existantes, détruit forcément du même coup l'ensemble des conditions morales qui rendent possible la révolte anticapitaliste. C'est ce qui explique que le temps joue de plus en plus, à présent, contre la liberté et le bonheur réels des individus et des peuples. Le contraire exact, en somme, de la thèse défendue par les fanatiques de la religion du progrès.
03:52 | Lien permanent | Commentaires (0)


















