19/09/2010
Chat de Schrödinger
 Petit rappel sur la décohérence et la réduction de la fonction d'onde
Petit rappel sur la décohérence et la réduction de la fonction d'onde
par Christophe Jacquemin
C'est à Erwin Shrödinger que l'on doit d'avoir popularisé la décohérence et la notion de réduction de la fonction d'onde. Son expérience imaginaire formulée en 1935, dite "paradoxe du chat de Schrödinger", est en effet désormais assez connue du grand public.
L'expérience est la suivante :dans une boîte fermée pourvue d'un hublot se trouve un chat, une fiole de cyanure, un marteau retenu par un fil et un détecteur quantique (un compteur Geiger). On y dépose un élément radioactif (atome d'uranium U) qui, dans un temps donné, a 50% de chance de se désintégrer en émettant un électron, électron qui ira frapper le détecteur; lequel actionnera alors le marteau qui brisera la fiole de poison mortel
Fermons la boîte, déclenchons l'expérience et demandons-nous avant de regarder par le hublot si le chat est vivant ou mort... C'est évident direz-vous : il y a 50% de chance que le chat soit vivant et autant qu'il soit mort...
Mais selon la physique quantique le chat, avant observation, est vivant ET mort à la fois ! Elle affirme que l'atome U est un être quantique auquel est applicable le principe de superposition : les particules atomiques peuvent exister dans plusieurs états superposés et simultanés. Ainsi, l'état vivant ou mort du chat ne dépend que de l'état (émission d'un électron ou non) de l'atome d'uranium. Or on sait que l'électron, étant donné sa nature ondulatoire, peut être localisé tout autour du noyau d'un atome. Il est présent simultanément à plusieurs endroits, et cela AVANT qu'il ne soit observé. De même, un atome radioactif d'uranium peut exister dans deux états superposés (intact et désintégré). Cet état de superposition cesse immédiatement dès qu'il y a observation, et donc interaction, de la particule. On dit alors qu'il y a décohérence lorsqu'un système A et B devient un système A ou B. Ainsi, regarder n'importe quelle particule quantique l'empêche de rester dans son double état (ET) ce qui l'oblige à en choisir un des deux (OU).
Dans l'expérience, l'état superposé de l'atome U devrait donc se transmettre à notre chat macroscopique et le transformer en mort-vivant, le fait d'observer le chat à travers le hublot entraînant la décohérence de son état (mort/vivant) et le choix d'un seul état. Cette explication, difficilement acceptable pour notre monde macroscopique, montre alors les difficultés d'interprétation que soulève le formalisme mathématique quantique (où les états superposés sont faciles à concevoir lorsqu'ils sont définis par des fonctions d'onde car celles-ci s'additionnent sans problème).
Mais alors, le chat ? Est-il mort ou bien vivant ? En d'autres termes, cela s'applique-t-il vraiment aux êtres macroscopiques ? La réponse vient ici de chercheurs français qui ont déterminé que la période d'incertitude est inversement proportionnelle à la complexité d'un objet. Ce qui pour le chat, qui est un objet complexe, revient à une période tellement courte qu'elle est négligeable. Dit d'une autre façon, l'état superposé "vivant ET mort" dans lequel se trouve le chat ressemble à une bulle de savon : une bulle est éphémère et détruite à la moindre interaction. La décohérence des objets macroscopiques est quasi immédiate.
06:03 Publié dans Reversibilité | Lien permanent | Commentaires (0)
31/08/2010
Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making
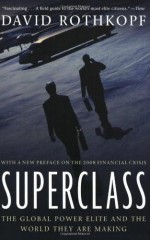 David Rothkopf, Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making, Farrar Straus Giroux, 2009.
David Rothkopf, Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making, Farrar Straus Giroux, 2009.
Each of them is one in a million. They number six thousand on a planet of six billion. They run our governments, our largest corporations, the powerhouses of international finance, the media, world religions, and, from the shadows, the world’s most dangerous criminal and terrorist organizations. They are the global superclass, and they are shaping the history of our time.
Today’s superclass has achieved unprecedented levels of wealth and power. They have globalized more rapidly than any other group. But do they have more in common with one another than with their own countrymen, as nationalist critics have argued? They control globalization more than anyone else. But has their influence fed the growing economic and social inequity that divides the world? What happens behind closeddoor meetings in Davos or aboard corporate jets at 41,000 feet? Conspiracy or collaboration? Deal-making or idle self-indulgence? What does the rise of Asia and Latin America mean for the conventional wisdom that shapes our destinies? Who sets the rules for a group that operates beyond national laws?
Drawn from scores of exclusive interviews and extensive original reporting, Superclass answers all of these questions and more. It draws back the curtain on a privileged society that most of us know little about, even though it profoundly affects our everyday lives. It is the first in-depth examination of the connections between the global communities of leaders who are at the helm of every major enterprise on the planet and control its greatest wealth. And it is an unprecedented examination of the trends within the superclass, which are likely to alter our politics, our institutions, and the shape of the world in which we live.
Reviewed by Anne-Marie Slaughter
Go to www.theyrule.net. A white page appears with a deliberately shadowy image of a boardroom table and chairs. Sentences materialize: "They sit on the boards of the largest companies in America." "Many sit on government committees." "They make decisions that affect our lives." Finally, "They rule." The site allows visitors to trace the connections between individuals who serve on the boards of top corporations, universities, think thanks, foundations and other elite institutions. Created by the presumably pseudonymous Josh On, "They Rule" can be dismissed as classic conspiracy theory. Or it can be viewed, along with David Rothkopf's Superclass, as a map of how the world really works.
In Superclass, Rothkopf, a former managing director of Kissinger Associates and an international trade official in the Clinton Administration, has identified roughly 6,000 individuals who have "the ability to regularly influence the lives of millions of people in multiple countries worldwide." They are the "superclass" of the 21st century, spreading across borders in an ever thickening web, with a growing allegiance, Rothkopf argues, to each other rather than to any particular nation.
Rothkopf's archetypal member of the superclass is Blackstone Group executive Stephen Schwarzman, who is not only fabulously wealthy, but also chairman of the Kennedy Center, a board member of the New York Public Library, the New York City Ballet, the Film Society of Lincoln Center and the New York City Partnership. These boards, along with the over 100 businesses Blackstone has invested in, the other business councils and advisory boards he sits on, and his Yale and Harvard education, mean that Schwarzman is only one or two affiliations away from any center of power in the world. Rothkopf actually traces the "daisy chain" of Schwarzman's connections through his board memberships -- linking him to Ratan Tata, one of India's richest men, former Mexican president Ernesto Zedillo and many others. It is these links that create access that translates to influence and determines how the levers of power are pulled.
Fame alone doesn't get you into the global power elite: Tom Cruise and Katie Holmes are out while Angelina Jolie and Bono are in. High office is generally enough for politicians and even their spouses, but membership in the superclass can be fleeting -- Mikhail Gorbachev and Cherie Blair are now out, while Henry Kissinger and Bill Clinton are still in. Rothkopf harps on the Pareto principle of distribution, or the "80/20 rule," whereby 20 percent of the causes of anything are responsible for 80 percent of the consequences. That means 20 percent of the money-makers make 80 percent of the money and 20 percent of the politicians make 80 percent of the important decisions. That 20 percent belongs to the superclass.
On closer inspection, however, Rothkopf has no actual methodology for determining who is in and who is out. Each chapter identifies individuals who are said to count in a field, conclusions backed up by trendspotting and anecdotes about Rothkopf's encounters at Davos and New York dinner parties that make the reader feel vaguely voyeuristic. When Rothkopf ventures away from his core expertise in politics and finance, and into such subjects as asymmetrical warfare, mega-churches and freemasonry, the pastiche-like quality of his research becomes evident.
Still, Superclass is often thought-provoking. For one thing, it is as much about who is not part of the superclass as who is. As I read Rothkopf's chronicles of elite gatherings -- Davos, Bilderberg, the Bohemian Grove (all male), Fathers and Sons (all male) -- I was repeatedly struck by the near absence of women. Fortune magazine's annual Most Powerful Women Summit, the only elite gathering I know of that is restricted to women, didn't even rate a mention. And indeed, when Rothkopf summarizes "how to become a member of the superclass," his first rule is "be born a man." Only 6 percent of the superclass is female.
Superclass is written in part as a consciousness-raising exercise for members of the superclass themselves. Rothkopf worries that "the world they are making" is deeply unequal and ultimately unstable. He hopes that the current global elite will use their power to do more than egg each other on to high-profile philanthropy. Elites in radically unequal countries such as Chile, for instance, might decide to open their cozy circles of power to allow the emergence of a genuine middle class. New York bankers might realize that they can no longer peddle loans to developing countries in good times but then pressure the U.S. Treasury and the International Monetary Fund to bail out those same governments when they suddenly default on their debts (ensuring, of course, that the bankers get paid). The agribusinesses that reap billions from domestic subsidies in developed countries might consider the longer-term value of trade rather than aid for countries at the bottom of the global food chain.
Perhaps. But it's likely to take more than exhortation. In the words of former Navy Secretary John Lehman, "Power corrupts. Absolute power is kind of neat." Why would the superclass want to give it up?
23:09 Publié dans Reversibilité | Lien permanent | Commentaires (0)
30/08/2010
Keynes Vs. Hayek : le grand débat continue
 Les débats faisant rage actuellement à propos des politiques susceptibles de sortir l'économie américaine de la Grande Récession sont une répétition des débats ayant eu lieu durant la Grande Dépression. Grâce aux efforts de Richard Ebeling, Professeur d'économie à l'Université Northwood, nous en avons une preuve documentaire concise et incontestable. Il a redécouvert des lettres parvenues au Times of London des protagonistes de l’époque qui reflètent en fait les débats d'aujourd'hui.
Les débats faisant rage actuellement à propos des politiques susceptibles de sortir l'économie américaine de la Grande Récession sont une répétition des débats ayant eu lieu durant la Grande Dépression. Grâce aux efforts de Richard Ebeling, Professeur d'économie à l'Université Northwood, nous en avons une preuve documentaire concise et incontestable. Il a redécouvert des lettres parvenues au Times of London des protagonistes de l’époque qui reflètent en fait les débats d'aujourd'hui.
Le 17 octobre 1932, le Times publiait une longue lettre de John Maynard Keynes et de cinq autres économistes universitaires. Le camp de Keynes, et coll. (Keynes pour faire court), y plaidait pour l’accroissement des dépenses — de toute nature, privée ou publique, consommation ou investissement. « L'économie privée » était le coupable qui entravait le retour à la prospérité. Si une personne décide d’épargner, rien ne garantit que les fonds « trouveront leur chemin vers l'investissement dans de nouveaux projets par des entreprises publiques ou privées ». Ils citent « le manque de confiance » comme étant la raison de la non-transformation de l'épargne en investissement. Par conséquence, « l'intérêt général dans les conditions actuelles ne va pas dans le même sens que celui de l'économie privée ; dépenser moins d'argent que ce que l’on souhaiterait n'est pas patriotique ». Ils concluent en soutenant les dépenses publiques pour compenser la fâcheuse épargne privée.
Les opinions exprimées dans cette lettre allaient devenir l’essence de l’économie keynésienne : les dépressions sont causées par un manque de dépenses qui peuvent être compensé par les dépenses publiques. Le keynésianisme (qui est antérieur à Keynes) est aujourd’hui facilement identifiable dans les discours prononcés par le président Obama et son équipe économique.
Deux jours plus tard, le 19 octobre 1932, quatre professeurs de l'Université de Londres répondaient à la lettre de Keynes, et l'un des signataires était Friedrich A. Hayek qui, 50 ans plus tard, allait gagner le prix Nobel d'économie. Le camp Hayek, et coll. (Hayek pour faire court), identifiait trois sujets de discorde. En premier lieu, ils rejetaient avec justesse l’argument de Keynes sur la futilité de l'épargne comme étant en réalité un argument sur ce qui est généralement appelé les dangers de la thésaurisation ; à savoir les conséquences potentiellement néfastes d'une augmentation de la demande de monnaie au niveau de l’ensemble de l'économie qui n'est pas satisfaite par une augmentation correspondante de l'offre de monnaie. « Il est admis que thésauriser, en espèces ou en encaisses oisives, a des effets déflationnistes. Personne ne pense que la déflation est désirable en soi ».
Deuxièmement, les professeurs de Londres contestaient l’idée que la forme des dépenses importait peu, que ce soit la consommation ou l'investissement. Ils considéraient le « renouveau de l'investissement comme particulièrement souhaitable », comme le font les partisans de l'économie de l’offre d'aujourd'hui. Ils distinguent la thésaurisation de la monnaie de l'épargne investie en valeurs mobilières, et réaffirment l'importance des marchés des valeurs mobilières dans la transformation de l'épargne en investissement.
Leur troisième et plus grand désaccord avec Keynes concernait les effets bénéfiques des dépenses publiques financées par des déficits. Ils s’y opposaient. « L'existence de la dette publique à une grande échelle impose des frictions et des obstacles au réajustement, beaucoup plus importants que les frictions et les obstacles imposés par l'existence de la dette privée ». Ce n'était pas le moment pour de « nouvelles piscines municipales, etc. » (exemple de Keynes). Dans notre contexte contemporain, pas de plan de relance.
Enfin, et surtout, ils ont montré la voie à suivre pour aller de l’avant. Les gouvernements du monde entier, suivant les États-Unis avec la destructrice Loi Smoot-Hawley de 1930, s'étaient tournés vers le protectionnisme et les restrictions sur les flux de capitaux. Hayek a fait valoir qu'il était temps « d'abolir les restrictions sur le commerce et la libre circulation des capitaux » : le remède à la Grande Dépression était un système international d'échange mondial revigoré. L'économie mondiale n'a pas cédé au protectionnisme cette fois-ci, mais les efforts pour développer le commerce mondial ont faibli. Comme l’a rappelé récemment Allan Meltzer, Professeur d'économie à l'Université Carnegie Mellon, dans le Wall Street Journal, seule l'expansion du commerce nous permet de rembourser la dette publique qui pèse sur l'économie.
La redécouverte par le Prof. Ebeling de ces lettres a déclenché un torrent de commentaires sur les blogs. Comme l’a dit Mario Rizzo, économiste à l’Université de New York, « le grand débat est encore Keynes contre Hayek. Tout le reste n'est que notes de bas de page ». Les économistes ont habillé le débat avec toujours davantage de complexité mathématique, mais les problèmes sous-jacents restent les mêmes.
Keynes avait-il raison de soutenir que l’épargne devienne des encaisses oisives et déprime l'activité économique ? Ou était-ce le point de vue de Hayek, d'abord énoncé par Adam Smith dans la Richesse des nations en 1776, qui était correct ? (Smith : « Ce qui est annuellement épargné est aussi régulièrement consommé que ce qui est annuellement dépensé, et il l’est aussi presque dans le même temps. »)
Les dépenses sont-elles toutes également productives, ou les politiques publiques devraient-elles viser la stimulation de l'investissement privé ? Dans ce dernier cas, M. Obama est en train de suivre les traces de Roosevelt et d’empêcher la reprise, en diabolisant les entreprises et en créant un environnement d’incertitude par le biais de nouvelles réglementations et de programmes coûteux. En faisant cela, il ne suit ni Hayek, ni Keynes, puisque la création d'incertitudes est considéré comme destructive par les deux. Enfin, la création d’une nouvelle dette publique dans une économie affaiblie est-elle la voie vers la reprise ? Ou sont-ce « les économies » (« l’austérité » dans le débat d'aujourd'hui) et l’épargne qui mènera vers la prospérité aujourd’hui, comme cela a été généralement envisagé auparavant ?
De notre correspondant,
Gerald O’Driscoll,
ancien vice-président de la Federal Reserve Bank de Dallas, est analyste au Cato Institute à Washington DC,
le 12 juillet 2010.
06:57 Publié dans Reversibilité | Lien permanent | Commentaires (1)
15/05/2010
La conquête de l'Afrique

Sous Louis-Philippe, le lieutenant de vaisseau Bouet-Willaumetz avait été envoyé en mission à la demande des commerçants de Bordeaux, désireux d'imiter la maison Régis frères de Marseille, qui importait les bois de teinture, l'ivoire, la poudre d'or et l'huile de palme de la côte du Bénin. Au cours de ses voyages, il avait passé entre 1837 et 1842 huit traités avec les roitelets nègres, Denis, Louis, Pierre et autres, qui signaient d'une croix, acceptant les cadeaux et laissaient les Français construire leurs fortins. Garroway, Assinie, Grand-Bassam naquirent ainsi, et Libreville fut peuplée avec les esclaves d'un négrier arrêté en 1849 par la frégate Pénélope qui croisait le long des côtes pour empêcher la traite.
Les nègres furent en général satisfaits. Le roi Denis, qui avait reçu dix barils de poudre, vingt fusils, deux sacs de tabac, un baril d'eau de vie et dix chapeaux blancs, devint en outre chevalier de la légion d'honneur quand les Chambres eurent ratifié le traité...
09:22 Publié dans Reversibilité | Lien permanent | Commentaires (0)
La colonisation de l'Algérie

En avril 1843, le lieutenant-colonel Forey, commandant l'une des sept colonnes qui parcouraient l'Ouarsenis, écrit au général Castellane:
"Renté à Milianah ... j'eus encore le commandement d'une colonne, je dirai plus importante par sa composition et par la nature du pays que j'eus à parcourir... Là, plus de gourbis isolés sur les flancs de montagnes, construits en branchages et réparés aussitôt que détruits, mais des villages semblables à nos bourgs de France.... tous entourés de jardins, de forêts immenses d'oliviers de la taille des platanes de Perpignan: nous étions stupéfaits de tant de beautés naturelles, mais les ordres étaient impératifs et j'ai dû remplir consciencieusement ma mission en ne laissant pas un village debout, pas un arbre, pas un champ. Le mal que ma colonne a fait sur son passage est incalculable. Est-ce un mal? Est-ce un bien? C'est l'avenir qui le décidera. Pour ma part, je, je crois que c'est le seul moyen d'amener la soumission ou l'émigration des ces habitants, bien à plaindre en définitive, puisqu'ils sont entre deux partis, pour l'un desquels ils ne peuvent se décider sans encourir la vengeance de l'autre."
09:08 Publié dans Reversibilité | Lien permanent | Commentaires (0)
25/08/2009
Burqa, les raisons de ne pas être systématiquement "contre"
Pourquoi les Français veulent interdire la burqa ? Entretien avec John Bowen
John Bowen est anthropologue, professeur à l’université Washington de Saint Louis, aux États-Unis. Il est spécialiste de l’Islam et ses récents travaux ont porté en particulier sur les musulmans de France. Tombé en plein débat sur le voile, il a déplacé un temps sa problématique pour s’intéresser à la perception de l’Islam par les Français : son livre Why the French Don’t like Headscarves, paru en 2007, interroge les ressorts de la mobilisations des valeurs républicaines et laïques contre la menace que représenterait le foulard.
Alors que la "mission d’information parlementaire" sur le voile intégral a commencé ses auditions, et les poursuivra jusqu’en décembre 2009, John Bowen propose d’interroger le sens de cette nouvelle préoccupation du politique. S’agit-il de légiférer davantage sur l’espace public ? ou bien de s’ingérer jusque dans la sphère privée ?
nonfiction.fr : Comment expliquez-vous la résurgence actuelle de la question de la burqa ?
John Bowen : Il est difficile d’expliquer pourquoi cette question ressurgit maintenant, car ce n’est pas lié à un événement particulier. Dans mon livre sur le foulard (2007) j’ai cherché des liens entre les résurgences des déclarations sur le foulard et les événements qui se passaient dans le monde musulman, en Algérie ou en Afghanistan par exemple. Avec la burqa, c’est plutôt une longue histoire. On voit depuis quelques années en Italie du Nord, en Belgique, aux Pays-Bas, des tentatives des pouvoirs locaux pour interdire la burqa. Ces mouvements européens contre l’Islam rencontrent un fort écho en France, et pas seulement dans les milieux d’extrême-droite, car les Français sont imprégnés de l’idée qu’on ne doit pas tolérer ce qui divise, or la burqa divise un individu. Le débat traverse le continuum politique droite-gauche, en se focalisant sur l’idée des valeurs communes : même si on fait appel aux questions techniques des contrôles d’identité par exemple, c’est plutôt le fait d’avoir des cloisonnements, des communautés qui gêne.
nonfiction.fr : Pourquoi ce déplacement de l’école à la rue ?
John Bowen : Pendant les débats en 2002-2003 quelques voix disaient que si le voile était symbole d’oppression de la femme, alors il fallait l’abolir de l’espace public, que ce soit à l’école ou dans la rue. Ces propositions, très cohérentes dans leur raisonnement, n’ont pas été suivies car à ce moment la loi sur le voile devait répondre à un ensemble de problèmes propres à l’école, et qui préoccupaient les enseignants comme les directeurs d’établissements : la contestation des cours d’histoire sur la Shoah par exemple, ou l’adaptation des rythmes scolaires aux obligations religieuses. Dans ce contexte, l’affaire du voile a fourni une opportunité pour légiférer, et donner l’impression de résoudre par la loi des problèmes face auxquels les acteurs se trouvaient démunis. Cette manie française de faire des lois, on la retrouve encore récemment avec la loi sur les bandes et sur le port des cagoules…
nonfiction.fr : C’est une coïncidence amusante, ce parallèle entre la cagoule et la burqa !
John Bowen : Oui, ce n’était pas forcément intentionnel mais les deux participent d’une même question : comment on légifère sur l’espace public ? De manière générale, la France a une conception positive de l’espace public, comme le lieu des valeurs communes et du vivre ensemble, d’où tout signe porteur de division doit être évacué ; c’est le sens de la laïcité à la française. Cependant les limites de cet espace restent floues. Dans le concret, l’espace public c’est quoi : la rue ? l’école ? la mairie ?
Revenons sur le cas de la femme à qui on a refusé la nationalité française parce qu’elle portait la burqa – le raisonnement du gouvernement ce n’était pas de dire que les conditions n’étaient pas remplies pour l’obtention de la nationalité, mais de dire que, du fait qu’elle était ainsi vêtue, qu’elle restait chez elle, elle présentait un défaut d’assimilation. Voilà le point intéressant : le problème ne vient pas d’un trouble à l’ordre public, mais du fait de rester dans la sphère privée. C’est là que se trouve le changement : maintenant on va jusque dans la chambre, on l’a vu encore dans le débat sur l’annulation du mariage pour cause de non-virginité de l’épouse, une annulation qui n’était ni contestée par la femme, ni par les juges, mais par les voix politiques qui ont estimé que ces distinctions n’avaient pas lieu d’être dans la sphère privée. Dans l’affaire de la burqa, on considère que la vie privée peut être source de défauts dans la sphère publique – défaut de laïcité, d’assimilation etc. Ce qui m’intéresse beaucoup c’est l’évolution de la notion d’ordre public ; il y a d’une part l’espace public en ce qu’il s’oppose à l’espace intime, familial, et d’autre part il y a l’ordre public, cette idée très durkheimienne d’un ordre social, moral, qui peut être bafoué même en privé. Et c’est cette idée d’un ordre moral qui pourrait nous amener à une interprétation en faveur de l’interdiction de la burqa ; mais dans notre période post-Vichy on a du mal à parler d’ordre moral.
nonfiction.fr : Donc vous voulez dire qu’on sort du politique si on s’intéresse à la sphère privée ?
John Bowen : Je vois là une atteinte potentielle à la vie privée des gens, à la liberté dans la sphère privée. Avec la burqa, la question du communautarisme est maintenant portée sur le corps de la femme. Ce déplacement, qui paraît récent, s’inscrit pourtant dans le temps long, car la tension entre libertés individuelles et valeurs communes est une constante depuis la révolution française : il ne faut pas oublier qu’après 1789 il y a eu 1792. La France demeure traversée par cette tension entre l’État - expression de la volonté générale, et la liberté de l’individu. Cette tension qui apparaît clairement dans la pensée de Rousseau…
nonfiction.fr : Vous montrez d’ailleurs dans votre livre sur le foulard que la pensée rousseauiste imprègne fortement la mentalité française : est-ce que vous pensez que les petits Français devraient lire plus de philosophes anglo-saxons à l’école ?
John Bowen : C’est une question qui porte sur la pédagogie à l’école… depuis des années des efforts sont faits pour introduire la pensée des libéraux en France . Cependant, on peut trouver une défense de la liberté individuelle chez Rousseau, sans avoir recours à d’autres systèmes philosophiques qui seraient moins ancrés dans la pédagogie, l’histoire de la France.
D’autre part, ces questions ne posent pas seulement, de manière générale, le problème des libertés publiques, mais de manière plus particulière le problème de l’Islam en France. C’est ce que je cherche à montrer dans mon nouveau livre Can Islam Be French (L’Islam peut-il être français, à paraître, Princeton University Press). Il reste encore à inventer des formes de dialogue, à trouver des interlocuteurs privilégiés qui puissent, en quelque sorte, normaliser la présence de l’Islam en France
00:37 Publié dans Reversibilité | Lien permanent | Commentaires (0)
Burqa, les raisons d'être "pour"
Me serais-je emballé trop vite en proposant ici même qu’on légifère fissa contre la burqa ? Je m’interroge.
On me l’a répété tout l’été : pourquoi stigmatiser ces femmes qui, si on ne les montrait pas du doigt, passeraient totalement inaperçues? Cet argument, qu’il soit rabâché par Eric Besson ou par Marie-George Buffet, n’est pas dénué de logique formelle : après tout, rendre les femmes invisibles est bel et bien l’objet social de ladite burqa. Mais d’autres événements estivaux sont venus étayer mes velléités de virage de cuti sur la question.
Tout d’abord, alors que le pays redécouvre les dangers de la canicule, force est de constater que les porteuses de voile intégral sont moins exposées que leurs sœurs impies aux misères de l’insolation et donc des cancers cutanés afférents. Depuis des décennies, les multinationales cosmétiques s’escrimaient à inventer le véritable écran total : vous bilez plus, les mecs, on l’a trouvé ! Désormais, il ne restera plus qu’à régler quelques petits problèmes liés à l’hypersudation…
Toujours dans l’optique du principe de précaution, un autre argument plaide en faveur de l’autorisation du port de la burqa, voire de son caractère obligatoire : l’épidémie de grippe A. Non seulement la burqa fait office de masque antiviral, mais en outre, le code moral qui va avec, guère propice au frotti-frotta - même le plus prétendument innocent - est un rempart phénoménal contre la contamination par contact direct. Laver ses mains cinq fois par jour, c’est bien, ne jamais s’en servir, c’est mieux !
Enfin l’actualité nous sert un dernier argument en faveur d’une tolérance bien pensée. Car ce vêtement que j’ai moi-même fautivement qualifié d’archaïsme peut se révéler d’une totale modernité. Comme vous, j’ai été ému par ses images télévisées de femmes afghanes votant pour la première fois de leur vie, malgré les menaces des talibans. Mais auraient-elles pu le faire si on n’avait pas mis à leur disposition ces magnifiques isoloirs individuels et portatifs ?
Marc Cohen, Burqa, j'ai changé d'avis, sur Causeur
00:28 Publié dans Reversibilité | Lien permanent | Commentaires (0)
31/07/2008
Charles Baudelaire à contrenuit
Les Fleurs du mal.
par
Jules Barbey d'Aurevilly
I
S’il n’y avait que du talent dans Les Fleurs du mal de M. Charles Baudelaire, il y en aurait certainement assez pour fixer l’attention de la Critique et captiver les connaisseurs ; mais dans ce livre difficile à caractériser tout d’abord, et sur lequel notre devoir est d’empêcher toute confusion et toute méprise, il y a bien autre chose que du talent pour remuer les esprits et les passionner... M. Charles Baudelaire, le traducteur des œuvres complètes d’Edgar Poë, qui a déjà fait connaître à la France le bizarre conteur, et qui va incessamment lui faire connaître le puissant poète dont le conteur était doublé, M. Baudelaire qui, de génie, semble le frère puîné de son cher Edgar Poë, avait déjà éparpillé, çà et là, quelques-unes des poésies qu’il réunit et qu’il publie. On sait l’impression qu’elles produisirent alors. A la première apparition, à la première odeur de ces Fleurs du mal, comme il les nomme, de ces fleurs (il faut bien le dire, puisqu’elles sont les Fleurs du mal) horribles de fauve éclat et de senteur, on cria de tous les côtés à l’asphyxie et que le bouquet était empoisonné ! Les moralités délicates disaient qu’il allait tuer comme les tubéreuses tuent les femmes en couche, et il tue en effet de la même manière. C’est un préjugé. A une époque aussi dépravée par les livres que l’est la nôtre, Les Fleurs du mal n’en feront pas beaucoup, nous osons l’affirmer. Et elles n’en feront pas, non-seulement parce que nous sommes les Mithridates des affreuses drogues que nous avons avalées depuis vingt-cinq ans, mais aussi par une raison beaucoup plus sûre, tirée de l’accent, — de la profondeur d’accent d’un livre qui, selon nous, doit produire l’effet absolument contraire à celui que l’on affecte de redouter. N’en croyez le titre qu’à moitié ! Ce ne sont pas les Fleurs du mal que le livre de M. Baudelaire. C’est le plus violent extrait qu’on ait jamais fait de ces fleurs maudites. Or, la torture que doit produire un tel poison sauve des dangers de son ivresse.
Telle est la moralité, inattendue, involontaire peut-être, mais certaine, qui sortira de ce livre, cruel et osé, dont l’idée a saisi l’imagination d’un artiste ! Révoltant comme la vérité, qui l’est souvent, hélas ! dans le monde de la Chute, ce livre sera moral à sa manière ; et ne souriez pas ! cette manière n’est rien moins que celle de la Toute-Puissante Providence elle-même, qui envoie le châtiment après le crime, la maladie après l’excès, le remords, la tristesse, l’ennui, toutes les hontes et toutes les douleurs qui nous dégradent et nous dévorent, pour avoir transgressé ses lois. Le poète des Fleurs du mal a exprimé, les uns après les autres, tous ces faits divinement vengeurs. Sa Muse est allée les chercher dans son propre cœur entr’ouvert, et elle les a tirés à la lumière d’une main aussi impitoyablement acharnée que celle du Romain qui tirait hors de lui ses entrailles. Certes ! l’auteur des Fleurs du mal n’est pas un Caton. Il n’est ni d’Utique, ni de Rome. Il n’est ni le Stoïque, ni le Censeur. Mais quand il s’agit de déchirer l’âme humaine à travers la sienne, il est aussi résolu et aussi impassible que celui qui ne déchira que son corps, après une lecture de Platon. La Puissance qui punit la vie est encore plus impassible que lui ! Ses prêtres, il est vrai, prêchent pour elle. Mais elle-même ne s’atteste que par les coups dont elle nous frappe. Voilà ses voix ! comme dit Jeanne d’Arc. Dieu, c’est le talion infini. On a voulu le mal et le mal engendre. On a trouvé bon le vénéneux nectar, et l’on en a pris à si haute dose, que la nature humaine en craque et qu’un jour elle s’en dissout tout à fait. On a semé la graine amère ; on recueille les fleurs funestes. M. Baudelaire qui les a cueillies et recueillies, n’a pas dit que ces Fleurs du mal étaient belles, qu’elles sentaient bon, qu’il fallait en orner son front, en emplir ses mains et que c’était là la sagesse. Au contraire, en les nommant, il les a flétries. Dans un temps où le sophisme raffermit la lâcheté et où chacun est le doctrinaire de ses vices, M. Baudelaire n’a rien dit en faveur de ceux qu’il a moulés si énergiquement dans ses vers. On ne l’accusera pas de les avoir rendus aimables. Ils y sont hideux, nus, tremblants, à moitié dévorés par eux-mêmes, comme on les conçoit dans l’enfer. C’est là en effet l’avancement d’hoirie infernale que tout coupable a de son vivant dans la poitrine. Le poète, terrible et terrifié, a voulu nous faire respirer l’abomination de cette épouvantable corbeille qu’il porte, pâle canéphore, sur sa tête, hérissée d’horreur. C’est là réellement un grand spectacle ! Depuis le coupable cousu dans un sac qui déferlait sous les ponts humides et noirs du Moyen Age, en criant qu’il fallait laisser passer une justice, on n’a rien vu de plus tragique que la tristesse de cette poésie coupable, qui porte le faix de ses vices sur son front livide. Laissons-la donc passer aussi ! On peut la prendre pour une justice, — la justice de Dieu !
II
Après avoir dit cela, ce n’est pas nous qui affirmerons que la poésie des Fleurs du mal est de la poésie personnelle. Sans doute, étant ce que nous sommes, nous portons tous (et même les plus forts) quelque lambeau saignant de notre cœur dans nos œuvres, et le poète des Fleurs du mal est soumis à cette loi comme chacun de nous. Ce que nous tenons seulement à constater, c’est que contrairement au plus grand nombre des lyriques actuels, si préoccupés de leur égoïsme et de leurs pauvres petites impressions, la poésie de M. Baudelaire est moins l’épanchement d’un sentiment individuel qu’une ferme conception de son esprit. Quoique très-lyrique d’expression et d’élan, le poète des Fleurs du mal est, au fond, un poète dramatique. Il en a l’avenir. Son livre actuel est un drame anonyme dont il est l’auteur universel, et voilà pourquoi il ne chicane ni avec l’horreur, ni avec le dégoût, ni avec rien de ce que peut produire de hideux la nature humaine corrompue. Shakespeare et Molière n’ont pas chicané non plus avec le détail révoltant et l’expression quand ils ont peint l’un, son Iago, l’autre, son Tartufe. Toute la question pour eux était celle-ci : " Y a-t-il des hypocrites et des perfides ? " S’il y en avait, il fallait bien qu’ils s’exprimassent comme des hypocrites et des perfides. C’étaient des scélérats qui parlaient, les poètes étaient innocents ! Un jour même (l’anecdote est connue), Molière le rappela à la marge de son Tartufe, en regard d’un vers par trop odieux, et M. Baudelaire a eu la faiblesse... ou la précaution de Molière.
Dans ce livre, où tout est en vers, jusqu’à la préface, on trouve une note en prose qui ne peut laisser aucun doute non-seulement sur la manière de procéder de l’auteur des Fleurs du mal, mais encore sur la notion qu’il s’est faite de l’art et de la poésie ; car M. Baudelaire est un artiste de volonté, de réflexion et de combinaison avant tout. " Fidèle, dit-il, à son douloureux programme, l’auteur des Fleurs du mal, a dû, en parfait comédien, façonner son esprit à tous les sophismes comme à toutes les corruptions. " Ceci est positif. Il n’y a que ceux qui ne veulent pas comprendre, qui ne comprendront pas. Donc, comme le vieux Gœthe, qui se transforma en marchand de pastilles turc dans son Divan, et nous donna aussi un livre de poésie, — plus dramatique que lyrique aussi, et qui est, peut-être, son chef-d’œuvre, — l’auteur des Fleurs du mal s’est fait scélérat, blasphémateur, impie par la pensée, absolument comme Gœthe s’est fait Turc. Il a joué une comédie, mais c’est la comédie sanglante dont parle Pascal. Ce profond rêveur qui est au fond de tout grand poète s’est demandé en M. Baudelaire ce que deviendrait la poésie en passant par une tête organisée, par exemple, comme celle de Caligula ou d’Héliogabale, et Les Fleurs du mal, — ces monstrueuses, — se sont épanouies pour l’instruction et l’humiliation de nous tous ; car il n’est pas inutile, allez ! de savoir ce qui peut fleurir dans le fumier du cerveau humain, décomposé par nos vices. C’est une bonne leçon. Seulement, par une inconséquence qui nous louche et dont nous connaissons la cause, il se mêle à ces poésies, imparfaites par là au point de vue absolu de leur auteur, des cris d’âme chrétienne, malade d’infini, qui rompent l’unité de l’œuvre terrible, et que Caligula et Héliogabale n’auraient pas poussés. Le christianisme nous a tellement pénétrés, qu’il fausse jusqu’à nos conceptions d’art volontaire, dans les esprits les plus énergiques et les plus préoccupés. S’appelât-t-on l’auteur des Fleurs du mal, — un grand poète qui ne se croit pas chrétien et qui, dans son livre, positivement ne veut pas l’être, — on n’a pas impunément dix-huit cents ans de christianisme derrière soi. Cela est plus fort que nous ! On a beau être un artiste redoutable, au point de vue le plus arrêté, à la volonté la plus soutenue, et s’être juré d’être athée comme Shelley, forcené comme Leopardi, impersonnel comme Shakespeare, indifférent à tout, excepté à la beauté comme Gœthe, on va quelque temps ainsi, — misérable et superbe, — comédien à l’aise dans le masque réussi de ses traits grimés ; — mais il arrive que, tout à coup, au bas d’une de ses poésies le plus amèrement calmes ou le plus cruellement sauvages, on se retrouve chrétien dans une demi-teinte inattendue, dans un dernier mot qui détonne, — mais qui détonne pour nous délicieusement dans le cœur :
Ah ! Seigneur ! donnez-moi la force et le courage
De contempler mon cœur et mon corps sans dégoût !
Cependant, nous devons l’avouer, ces inconséquences, presque fatales, sont assez rares dans le livre de M. Baudelaire. L’artiste, vigilant et d’une persévérance inouïe dans la fixe contemplation de son idée, n’a pas été trop vaincu.
III
Cette idée, nous l’avons dit déjà par tout ce qui précède, c’est le pessimisme le plus achevé. La littérature satanique, qui date d’assez loin déjà, mais qui avait un côté romanesque et faux, n’a produit que des contes pour faire frémir ou des bégaiements d’enfançon, en comparaison de ces réalités effrayantes et de ces poésies nettement articulées où l’érudition du mal en toutes choses se mêle à la science du mot et du rhythme. Car pour M. Charles Baudelaire, appeler un art sa savante manière d’écrire en vers ne dirait point assez. C’est presque un artifice. Esprit d’une laborieuse recherche, l’auteur des Fleurs du mal est un retors en littérature, et son talent, qui est incontestable, travaillé, ouvragé, compliqué avec une patience de Chinois, est lui-même une fleur du mal venue dans les serres chaudes d’une décadence. Par la langue et le faire, M. Baudelaire, qui salue, à la tête de son recueil, M. Théophile Gautier pour son maître, est de cette école qui croit que tout est perdu, et même l’honneur, à la première rime faible, dans la poésie la plus élancée et la plus vigoureuse. C’est un de ces matérialistes raffinés et ambitieux qui ne conçoivent guère qu’une perfection matérielle, — et qui savent parfois la réaliser ; mais par l’inspiration il est bien plus profond que son école, et il est descendu si avant dans la sensation, dont cette école ne sort jamais, qu’il a fini par s’y trouver seul, comme un lion d’originalité. Sensualiste, mais le plus profond des sensualistes, et enragé de n’être que cela, l’auteur des Fleurs du mal va, dans la sensation, jusqu’à l’extrême limite, jusqu’à cette mystérieuse porte de l’infini à laquelle il se heurte, mais qu’il ne sait pas ouvrir, et de rage il se replie sur la langue et passe ses fureurs sur elle. Figurez-vous cette langue, plus plastique encore que poétique, maniée et taillée comme le bronze et la pierre, et où la phrase a des enroulements et des cannelures ; figurez-vous quelque chose du gothique fleuri ou de l’architecture moresque appliqué à cette simple construction qui a un sujet, un régime et un verbe ; puis, dans ces enroulements et ces cannelures d’une phrase qui prend les formes les plus variées comme les prendrait un cristal, supposez tous les piments, tous les alcools, tous les poisons, minéraux, végétaux, animaux ; et ceux-là les plus riches et les plus abondants, si on pouvait les voir, qui se tirent du cœur de l’homme, et vous avez la poésie de M. Baudelaire, cette poésie sinistre et violente, déchirante et meurtrière, dont rien n’approche dans les plus noirs ouvrages de ce temps qui se sent mourir. Cela est, dans sa férocité intime, d’un ton inconnu en littérature. Si à quelques places, comme dans la pièce La Géante ou dans Don Juan aux enfers, — un groupe de marbre blanc et noir, — une poésie de pierre, di sasso, comme le Commandeur, — M. Baudelaire rappelle la forme de M. V. Hugo, mais condensée et surtout purifiée ; si a quelques autres, comme La Charogne, la seule poésie spiritualiste du recueil, dans laquelle le poète se venge de la pourriture abhorrée par l’immortalité d’un cher souvenir :
Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,
Que j’ai gardé la forme et l’essence divine
De mes amours décomposés,
on se souvient de M. Auguste Barbier, partout ailleurs l’auteur des Fleurs du mal est lui-même et tranche fièrement sur tous les talents de ce temps. Un critique le disait l’autre jour (M. Thierry, du Moniteur) dans une appréciation supérieure : pour trouver quelque parenté à cette poésie implacable, à ce vers brutal, condensé et sonore, ce vers d’airain qui sue du sang, il faut remonter jusqu’au Dante, magnus parens ! C’est l’honneur de M. Charles Baudelaire d’avoir pu évoquer, dans un esprit délicat et juste, un si grand souvenir !
Il y a du Dante, en effet, dans l’auteur des Fleurs du mal, mais c’est du Dante d’une époque déchue, c’est du Dante athée et moderne, du Dante venu après Voltaire, dans un temps qui n’aura point de saint Thomas. Le poète de ces Fleurs, qui ulcèrent le sein sur lequel elles reposent, n’a pas la grande mine de son majestueux devancier, et ce n’est pas sa faute. Il appartient à une époque troublée, sceptique, railleuse, nerveuse, qui se tortille dans les ridicules espérances des transformations et des métempsychoses ; il n’a pas la foi du grand poète catholique qui lui donnait le calme auguste de la sécurité dans toutes les douleurs de la vie. Le caractère de la poésie des Fleurs du mal, à l’exception de quelques rares morceaux que le désespoir a fini par glacer, c’est le trouble, c’est la furie, c’est le regard convulsé et non pas le regard, sombrement clair et limpide, du Visionnaire de Florence. La Muse du Dante a rêveusement vu l’Enfer, celle des Fleurs du mal le respire d’une narine crispée comme celle du cheval qui hume l’obus ! L’une vient de l’Enfer, l’autre y va. Si la première est plus auguste, l’autre est peut-être plus émouvante. Elle n’a pas le merveilleux épique qui enlève si haut l’imagination et calme ses terreurs dans la sérénité dont les génies, tout à fait exceptionnels, savent revêtir leurs œuvres les plus passionnées. Elle a, au contraire, d’horribles réalités que nous connaissons, et qui dégoûtent trop pour permettre même l’accablante sérénité du mépris. M. Baudelaire n’a pas voulu être dans son livre des Fleurs du mal un poète satirique, et il l’est pourtant, sinon de conclusion et d’enseignement, au moins de soulèvement d’âme, d’imprécations et de cris. Il est le misanthrope de la vie coupable, et souvent on s’imagine, en le lisant, que si Timon d’Athènes avait eu le génie d’Archiloque, il aurait pu écrire ainsi sur la nature humaine et l’insulter en la racontant !
IV
Nous ne pouvons ni ne voulons rien citer du recueil de poésies en question, et voici pourquoi : une pièce citée n’aurait que sa valeur individuelle, et il ne faut pas s’y méprendre, dans le livre de M. Baudelaire, chaque poésie a, de plus que la réussite des détails ou la fortune de la pensée, une valeur très-importante d’ensemble et de situation qu’il ne faut pas lui faire perdre, en la détachant. Les artistes qui voient les lignes sous le luxe et l’efflorescence de la couleur percevront très-bien qu’il y a ici une architecture secrète, un plan calculé par le poète, méditatif et volontaire. Les Fleurs du mal ne sont pas à la suite les unes des autres comme tant de morceaux lyriques, dispersés par l’inspiration, et ramassés dans un recueil sans d’autre raison que de les réunir. Elles sont moins des poésies qu’une œuvre poétique de la plus forte unité. Au point de vue de l’art et de la sensation esthétique, elles perdraient donc beaucoup à n’être pas lues dans l’ordre où le poète, qui sait bien ce qu’il fait, les a rangées. Mais elles perdraient bien davantage au point de vue de l’effet moral que nous avons signalé au commencement de ce chapitre.
Cet effet, sur lequel il importe beaucoup de revenir, gardons-nous bien de l’énerver. Ce qui empêchera le désastre de ce poison, servi dans cette coupe, c’est sa force ! L’esprit des hommes, qu’il bouleverserait en atomes, n’est pas capable de l’absorber dans de telles proportions, sans le revomir, et une telle contraction donnée à l’esprit de ce temps, affadi et débilité, peut le sauver, en l’arrachant par l’horreur à sa lâche faiblesse. Les Solitaires ont auprès d’eux des têtes de mort, quand ils dorment. Voici un Rancé, sans la foi, qui a coupé la tête à l’idole matérielle de sa vie ; qui, comme Caligula, a cherché dedans ce qu’il aimait et qui crie du. néant de tout, en la regardant ! Croyez-vous donc que ce ne soit pas là quelque chose de pathétique et de salutaire ?... Quand un homme et une poésie en sont descendus jusque-là, — quand ils ont dévalé si bas, dans la conscience de l’incurable malheur qui est au fond de toutes les voluptés de l’existence, poésie et homme ne peuvent plus que remonter. M. Charles Baudelaire n’est pas un de ces poètes qui n’ont qu’un livre dans le cerveau et qui vont le rabâchant toujours. Mais qu’il ait desséché sa veine poétique (ce que nous ne pensons pas) parce qu’il a exprimé et tordu le cœur de l’homme lorsqu’il n’est plus qu’une épongé pourrie, ou qu’il l’ait, au contraire, survidée d’une première écume, il est tenu de se taire maintenant, — car il a des mots suprêmes sur le mal de la vie, — ou de parler un autre langage. Après Les Fleurs du mal, il n’y a plus que deux partis à prendre pour le poète qui les fit éclore : ou se brûler la cervelle... ou se faire chrétien !
07:56 Publié dans Reversibilité | Lien permanent | Commentaires (0)
28/07/2008
Edgar Poe
Les Histoires extraordinaires.
par
Jules Barbey d’Aurévilly
Le Réveil, 1865
I
 C’est le roi des Bohêmes ! Edgar Poe est bien le premier et le meilleur, à sa manière, de cette littérature effrénée et solitaire, sans tradition et sans ancêtres... prolem sine matre creatam, qui s’est timbrée elle-même de ce nom de Bohême qui lui restera comme sa punition ! Edgar Poe, le poète et le conteur américain, est à nos yeux le Bohême accompli, le Bohême élevé à sa plus haute puissance. Né dans ce tourbillon de poussière que l’on appelle, par une dérision de l’histoire, les États-Unis* ; revenu, après l’avoir quittée, dans cette auberge des nations, qui sera demain un coupe-gorge, et où, bon an mal an, tombent cinq cent mille drôles plus ou moins bâtards, plus ou moins chassés de leur pays, qu’ils menaçaient ou qu’ils ont troublé, Edgar Poe est certainement le plus beau produit littéraire de cette crème de l’écume du monde. Et c’était logique et justice que le plus fort de tous les Bohêmes contemporains naquît au sein de la Bohême du refuge et du sang-mêlé de toutes les révoltes !
C’est le roi des Bohêmes ! Edgar Poe est bien le premier et le meilleur, à sa manière, de cette littérature effrénée et solitaire, sans tradition et sans ancêtres... prolem sine matre creatam, qui s’est timbrée elle-même de ce nom de Bohême qui lui restera comme sa punition ! Edgar Poe, le poète et le conteur américain, est à nos yeux le Bohême accompli, le Bohême élevé à sa plus haute puissance. Né dans ce tourbillon de poussière que l’on appelle, par une dérision de l’histoire, les États-Unis* ; revenu, après l’avoir quittée, dans cette auberge des nations, qui sera demain un coupe-gorge, et où, bon an mal an, tombent cinq cent mille drôles plus ou moins bâtards, plus ou moins chassés de leur pays, qu’ils menaçaient ou qu’ils ont troublé, Edgar Poe est certainement le plus beau produit littéraire de cette crème de l’écume du monde. Et c’était logique et justice que le plus fort de tous les Bohêmes contemporains naquît au sein de la Bohême du refuge et du sang-mêlé de toutes les révoltes !
* Depuis que ceci est écrit, on a vu s’ils l’étaient. Les États-Unis ! On peut les appeler maintenant les États-Déchirés.
Individuel comme un Américain, n’ayant jamais vu que le moi par lequel il a péri, comme ils périront eux aussi, Edgar Poe fut. parmi ses compatriotes démocrates, le Bohême de l’esprit aristocratique. Dans le pays de la plus cynique utilité, il ne vit que la beauté, la beauté par elle-même, la beauté oisive, inféconde, l’art pour l’art. Rien ne peut se comparer à l’amour violent qu’il eut pour elle. M. Victor Hugo, traître à cet art pour l’art qui ne fut jamais pour lui qu’une religion de préface, et qui, en vieillissant, a livré sa Muse à de bien autres préoccupations ; M. Victor Hugo, même aux plus chaudes années de sa jeunesse, est bien tiède et bien transi dans son amour fanfaron de la forme et de la beauté, en comparaison d’Edgar Poe, de ce poëte et de cet inventeur qui a la frénésie patiente, quand il s’agit de donner à son œuvre le fini... qui est son seul infini, hélas ! A coup sûr, jamais les doctrines, ou plutôt l’absence de doctrines que nous combattons : l’égoïsme sensuel, orgueilleux et profond, l’immoralité par le fait, quand elle n’est pas dans la peinture et dans l’indécence du détail, le mépris réfléchi de tout enseignement, la recherche de l’émotion à outrance et à tout prix, et le pourlèchement presque bestial de la forme seule, n’ont eu dans aucun homme de notre temps, où que vous le preniez, une expression plus concentrée et plus éclatante à la fois que dans Edgar Poe et ses œuvres.
Étudier la Bohême sur cet homme, ses livres et ses procédés, c’est donc étudier la maladie sur le plus puissant organisme qu’elle ait ruiné en quelques jours. Que nous servirait de l’étudier sur quelque impuissant ou quelque noué ? Prenons-la où elle fit vraiment un ravage. Pour mieux montrer l’abjection de la Bohême littéraire, nous choisirons son plus beau cadavre. On verra plus nettement la cause de la ruine sur cette noble chose démolie. C’est là presque un deuil, en vérité, car Edgar Poe pouvait être quelque chose de grand et il ne sera qu’une chose curieuse. Il y a plus triste que le talent foudroyé, c’est le talent qui se fourvoie, et qui meurt de s’être fourvoyé.
II
Il était né poëte, Edgar Poe. Tels qu’ils sont, violemment manqués, mais portant la trace à toute page d’une force inouïe, les livres que la traduction de M. Baudelaire nous a fait connaître, ne permettent pas d’en douter. C’était, de nature, un vrai poëte, une incontestable supériorité d’imagination, faite pour aller ravir l’inspiration aux plus grandes sources ; mais il n’est pas bon que l’homme soit seul, a dit le saint Livre, et Poe, ce Byron-Bohême, vécut seul toute sa vie et mourut comme il avait vécu, — ivre et seul ! L’ivrognerie de ce malheureux était devenue le vice de sa solitude. Quoique marié (son biographe ne nous dit pas à quel autel) quoique marié à une femme qu’il aima, prétend-on, — mais nous savons trop comment aiment les poëtes, — la famille ne créa point autour de lui d’atmosphère préservatrice. Or, comme le talent, ne nous lassons point de le répéter, est toujours moulé par la vie et la réverbère, Edgar Poe, l’isolé, exploita pendant toute la sienne les abominables drames de l’isolement. Sous toutes les formes que l’art — cette comédie qu’on se joue à soi-même, — cherche à varier, mais qu’en définitive il ne varie point, Edgar Poe, l’auteur des Histoires extraordinaires, ne fut jamais, en tous ses ouvrages, que le paraboliste acharné de l’enfer qu’il avait dans le cœur, car l’Amérique n’était pour lui qu’un effroyable cauchemar spirituel, dont il sentait le vide et qui le tuait.
Au milieu des intérêts haletants de ce pays de la matière, Poe, ce Robinson de la poésie, perdu, naufragé dans ce vaste désert d’hommes, rêvait éveillé, tout en délibérant sur la dose d’opium à prendre pour avoir au moins de vrais rêves, d’honnêtes mensonges, une supportable irréalité ; et toute l’énergie de son talent, comme sa vie, s’absorba dans une analyse enragée, et qu’il recommençait toujours, des tortures de sa solitude. Évidemment, s’il avait été un autre homme, il aurait pu combler, avec des affections fortes ou des vertus domestiques, cette solitude qui a fait pis que de dévorer son génie, car elle l’a dépravé. Seulement, pour cela, il lui eût fallu le bénéfice et le soutien d’une éducation morale quelconque, et l’on se demande avec pitié ce que fut la sienne, à lui, le fils d’une actrice et de l’aventure, dans une société qui a trouvé, un beau matin, les Mormons, au fond de ses mœurs !
On se le demande, sans pouvoir y répondre. Le biographe d’Edgar Poe ne le dit pas et peut-être ne s’en soucie guère ; mais le silence de sa notice sur l’éducation morale, nécessaire même au génie pour qu’il soit vraiment le génie, genre d’éducation qui manqua sans doute à Edgar Poe ; et d’un autre côté, le peu de place que tiennent le cœur humain et ses sentiments dans l’ensemble des œuvres de ce singulier poëte et de ce singulier conteur, renseignent suffisamment, — n’est-il pas vrai ? — sur la moralité sensible ou réfléchie d’un homme qui, après tout, avec une organisation superbe, ne fut accessible qu’à des émotions inférieures, et dont la pensée, dans les plus compliquées de ses inventions, n’a jamais que deux mouvements convulsifs, — la curiosité et la peur.
III
Était-ce donc la peine d’avoir tant de facultés en puissance ? La curiosité et la peur ? Quoi ! dans ces Histoires extraordinaires, qui le sont bien moins par le fond des choses que par le procédé d’art du conteur, sur lequel nous reviendrons, et qui est, à la vérité, extraordinaire, il n’y a rien de plus élevé, de plus profond et de plus beau, en sentiment humain, que la curiosité et la peur, — ces deux choses vulgaires ! — La curiosité de l’incertain qui veut savoir et qui rôde toujours sur la limite de deux mondes, le naturel et le surnaturel, s’éloignant de l’un pour frapper incessamment à la porte de l’autre, qu’elle n’ouvrira jamais, car elle n’en a pas la clef ; et la peur, terreur blême de ce surnaturel qui attire, et qui effraye autant qu’il attire ; car, depuis Pascal peut-être, il n’y eut jamais de génie plus épouvanté, plus livré aux affres de l’effroi et à ses mortelles agonies, que le génie panique d’Edgar Poe !
Tel est le double caractère du talent, de l’homme et de l’œuvre que la traduction française, qui est très-bien faite, nous a mis à même de juger : la peur et ses transes, la curiosité et ses soifs, la peur et la curiosité du surnaturel dont on doute, et, pour l’expliquer, toutes les folies d’une époque et d’un pays matérialiste qui effraye autant qu’il attire. Tout cela est agité, orageux, terrible, presque fou, et peut faire passer un frisson sur la peau et sur l’âme, mais n’y entre pas, si l’on a une croyance solide, une foi religieuse, une certitude. Tout cela, — des contes d’ogre pour des enfants qui se croient des hommes, — n’a qu’une prise d’un moment sur l’imagination du lecteur, et manque, comme impression d’art, de profondeur et de vraie beauté. Ce n’est point là la peur, la peur cabrée, renversée, glacée de Pascal. La peur de Pascal ne déshonore point cet épouvanté sublime. Elle vient d’une grande chose, de la foi qui lui montre l’enfer à œil nu et de l’indignité sentie, qui lui dit qu’il y peut tomber, tandis que la peur d’Edgar Poe est la peur de l’enfant ou du lâche d’esprit, fasciné par ce que la mort, qui garde le secret de l’autre monde, quand la religion ne nous le dit pas, a d’inconnu, de ténébreux, de froid. C’est l’application du mot de Bacon : " les hommes ont peur de la mort comme les enfants ont peur de l’ombre. "
Cette peur des sens soulevés prend mille formes dans les Histoires de Poe ; mais soit qu’elle se traduise et se spécifie par l’horreur qu’il a d’être enterré vivant, ou par le désir immense de tomber, ou par quelque autre hallucination du même genre, c’est toujours la même peur nerveuse du matérialiste halluciné. Edgar Poe excelle à créer ces hallucinations, et il les savoure et les réfléchit, tout en en frémissant ou se pâmant d’effroi. Sans aucun doute, dans ce jeu bizarre où l’auteur devient de bonne foi, et, comme l’acteur, se fascine soi-même, il y a (et la Critique doit l’y voir) un naturel de poëte dramatique qui, tiré de toutes ces données, sujets habituels des contes d’Edgar Poe : le somnambulisme, le magnétisme, la métempsycose, — le déplacement et la transposition de la vie, — aurait pu être formidable. Mais il y a aussi, — il faut bien le dire, — le Perrault. Il y est caché au fond du grand poëte ; et parce qu’il y est, faute de sujets moraux et grands, faute d’idées, faute de grandes croyances, faute d’imposantes certitudes, on peut dire hardiment que c’est le Bohême qui l’y a mis !
IV
Ainsi, en plein cœur de son propre talent, pour le diminuer et le piquer de sa tache, voilà que nous rencontrons le Bohême, c’est-à-dire l’homme qui vit intellectuellement au hasard de sa pensée, de sa sensation ou de son rêve, comme il a vécu socialement dans cette cohue d’individualités solitaires, qui ressemble à un pénitentiaire immense, le pénitentiaire du travail et de l’égoïsme américain ! Edgar Poe, le fils de l’aventure et de l’aventure infortunée, est aussi le plus souvent un aventurier d’inventions malheureuses, quoiqu’il y ait quelques-uns de ses contes qui, le genre admis de cette littérature matérialiste et fébrile, semblent réussis. Au lieu de se placer au-dessus d’elles, comme les penseurs originaux, il pille les idées de son temps, et ce qu’il en flibuste ne méritait guère d’être flibusté. Doué de la force de cette race de puritains qui se sont abattus d’Angleterre comme une bande de cormorans affamés, ce qu’il prend aux préoccupations contemporaines ne vaut pas la force qu’il déploie pour se servir de ce qu’il a pris ; et ici nous arrivons à ce qui l’emporte, selon nous, dans Edgar Poe, sur les résultats obtenus de sa manière, — c’est-à-dire l’application de son procédé.
V
Et, en effet, l’originalité vraie d’Edgar Poe, ce qui lui gardera une place visible dans l’Histoire littéraire du dix-neuvième siècle, c’est le procédé qu’on retrouve partout dans ses œuvres ; aussi bien dans son roman d’Arthur Gordon Pym que dans ses Histoires extraordinaires, et qui fait du poëte et du conteur américain ce qu’il est, c’est-à-dire le plus énergique des artistes volontaires, la volonté la plus étonnamment acharnée, froidissant l’inspiration pour y ajouter. Ce procédé d’Edgar Poe est l’analyse, que jamais personne peut-être ne mania comme lui. Nous l’avons indiqué : maigre d’invention, exploitant seulement deux ou trois situations (pas plus !) de la même série excentrique, Poe fait son drame avec presque rien, et c’est tout.
Mais pour le faire, ce drame, pour grossir cet atome en le décomposant, il se sert d’une analyse inouïe et qu’il pousse à la fatigue suprême, à l’aide d’on ne sait quel prodigieux microscope, sur la pulpe même du cerveau. Positivement, le lecteur assiste à l’opération du chirurgien ; positivement il entend crier l’acier de l’instrument et sent les douleurs. Edgar Poe applique ce quelque chose, qu’on peut nommer l’impatience dans la curiosité, le procédé du travail en matière d’horlogerie. Il établit le tour du cadran de l’analyse sur le pivot de son mouvement interne. Il a une patience qui attaque les nerfs, une patience furieuse qui se met des freins à elle-même, et qui a dû sacrifier souvent tout un mois en simples préparatifs pour faire bouillir son public une heure. Machiavélique côté de son génie, qui touche ici à la rouerie profonde du jongleur, et où le poëte, le poëte, ce Spontané divin, expire dans les exhibitions affreuses du charlatan et du travailleur américain !
VI
Car il est Américain, quoi qu’il fasse, cet homme qui détestait l’Amérique, et que l’Amérique, mère de ses vices et de sa misère, a poussé au suicide contre elle. Fatalité de l’origine et de la race ! On n’efface jamais à son front sa nationalité ou sa naissance. Edgar Poe, le Bohême de génie, n’est après tout ni plus ni moins qu’un Américain, l’énergique produit et l’antithèse du monde américain des États-Unis ! Il y aurait quelque chose de plus à faire que ses Contes, ce serait sa propre analyse, mais pour cela, il faudrait son genre de talent... Quand on résume cette curieuse et excentrique individualité littéraire, ce fantastique, en ronde bosse, de la réalité cruelle, près duquel Hoffmann n’est que la silhouette vague de la fumée d’une pipe sur un mur de tabagie, il est évident qu’Edgar Poe a le spleen dans des proportions désespérées, et qu’il en décrit férocement les phases, la montre à la main, dans des romans qui sont son histoire.
Ce spleenétique colossal, en comparaison de qui lord Byron, ce beau lymphatique, ne nous apparaît plus que comme une vaporeuse petite maîtresse ; ce spleenétique colossal, malgré l’infiltration morbide de son regard d’aliéné, a les lucidités flegmatiques et transperçantes du condamné qui se sait sur son échafaud. Il n’a pas que le spleen de la vie, il a aussi celui de la mort ! Spirituellement parlant, la question de l’autre monde a toujours étrangement pesé sur cet homme de l’autre monde, comme nous disons géographiquement. Elle revient de toutes parts dans ses livres. Revanche de la pensée, cette force spirituelle contre l’immoralité fangeuse de la vie, ce fut sa grande anxiété, à cet Hamlet américain ! Ce fut la seule chose vraie de ces livres, construits comme des mensonges immenses ; la seule émotion dont il n’aurait pas trafiqué ! Tout le reste est voulu, arrangé, menti dans ses œuvres, qui ne sont probablement que les pamphlets de son esprit, des pamphlets atroces, des vengeances contre la vie. Il empoisonnait ses empoisonneurs.
Historiquement, il finit par s’empoisonner lui-même. Le suicide, un suicide préparé depuis longtemps, dit très-bien M. Baudelaire, un suicide, la mort bohême, finit la vie bohême d’Edgar Poe. " Un malin, dans les ténèbres du petit jour, raconte amèrement M. Baudelaire, un cadavre fut trouvé sur la voie, est-ce ainsi qu’il faut dire ? non, un corps vivant encore, mais que la mort avait marqué de sa royale estampille. Sur ce corps, dont on ignorait le nom, on ne trouva ni papier ni argent, et on le porta dans un hôpital. C’est là que Poe mourut, le 7 octobre 1849, à l’âge de trente-sept ans, vaincu par le delirium tremens, ce terrible visiteur qui avait déjà hanté son cerveau une ou deux fois... " Hélas ! une ou deux fois, ce n’est pas assez dire. Poe ne mourut pas seulement du delirium tremens, il en avait vécu ! Sa vie tout entière, à ce robuste et malade génie, fut, jusqu’à sa dernière heure, un délire et un tremblement !
VII
Cruelle et lamentable histoire ! Le traducteur qui l’a racontée dans la passion ou la pitié qu’il a pour son poëte, a fait de l’histoire et de cette mort d’Edgar Poe une accusation terrible, une imprécation contre l’Amérique toute entière ! C’est la vieille thèse, la thèse individuelle, et il faut bien le dire, puisque c’est la même chose, la thèse bohême contre les sociétés. Nous eussions de M. Baudelaire, d’une tête qui a parfois la froide lucidité de Poe, attendu une thèse plus virile.
Il pouvait être le frère de charité, l’ensevelisseur des restes d’un homme de génie, sans les jeter à la tête de tout un pays qui, en définitive, ne l’a point volontairement assassiné. Edgar Poe s’est chargé seul de cette besogne : il s’est assassiné lui-même... Moralement, l’Amérique et Edgar Poe se valent; ils n’ont point de reproche à se faire ; ils ont tous les deux le même mal, monstrueux et mortel dans l’un comme dans l’autre, le mal de l’individualité. Edgar Poe répond donc seul à l’histoire de sa destinée, et le poids qu’il porte devant elle ne peut être allégé par rien. Dieu lui avait donné des facultés singulièrement belles, puissantes et rares ; il n’en tira point le parti qu’il en eût pu tirer. Nous l’avons dit, il se fourvoya avec l’effort qui ferait monter un homme aux astres.
A nos yeux, à nous qui ne croyons pas que l’Art soit le but principal de la vie et que l’esthétique doive un jour gouverner le monde, ce n’est pas là une si grande perte qu’un homme de génie; mais nul n’est dispensé d’être une créature morale et bienfaisante, un homme du devoir social; c’est là une perte qu’on ne rachète point ! Or, Edgar Poe ne le fut pas. Pour lui donner force à l’être pourtant, Dieu, après le génie qui est aussi une lumière pour le cœur, lui avait donné des affections domestiques. Le Robinson de la poésie, dans son île d’Amérique, eut mieux que Vendredi, pour supporter et partager la vie. Il épousa une femme qui lui apporta en dot une mère*.Eh bien, cette dernière affection d’une mère, qui ne lui manqua jamais et qui lui survécut, ne l’arrêta point dans la consommation de ce long suicide par l’alcool qu’il accomplit sur sa personne. Voilà ce qui le rend plus coupable qu’un autre de cette Bohême sinistre et funèbre, dont, par la supériorité de ses facultés et de ses fautes, il est actuellement le roi !
* Mme Clemm, la belle-mère de Poe.
10:27 Publié dans Reversibilité | Lien permanent | Commentaires (0)



















