21/03/2013
Droits des chimères

Eléments de réflexions et d'analyse autour du statut juridique des "chimères réelles" et de l'animal, dans les xénogreffes et les biotechnologies
par Jordane SEGURA-CARISSIMI, docteur en Droit privé et sciences criminelles, juriste-chercheur, chargée d'études au CEPS/INSTEAD
1 - L'annonce récente, selon laquelle les députés britanniques ont autorisé des scientifiques à créer des embryons hybrides dédiés à la recherche médicale et issus de l'intégration d'ADN humain dans des ovules d'animaux, peut relancer l'interrogation et la réflexion portant sur le « mélange effectif» d'éléments biologiques d'origine humaine et animale.
2 - Le professeur Jean-Pierre Marguénaud s'est notamment intéressé à ces êtres vivants « dont on ne sait s'ils doivent ou devront être considérés comme des personnes humaines ou comme des choses animées, c'est-à-dire des animaux». Plus précisément, l'auteur envisage, d'une part, le cas des êtres considérés comme des monstres en raison de leur difformité et auxquels s'applique la règle selon laquelle la personnalité juridique est attribuée à des êtres humains nés vivants et viables et, d'autre part, le cas des êtres monstrueux qui vivent entre humanité et animalité (2) . Ces êtres monstrueux vivant entre humanité et animalité relèvent déjà de la mythologie et des légendes anciennes, voire de la science-fiction et de la littérature fantastique. Ils sont le fruit de l'imagination ou de la croyance des hommes et n'entrent pas dans les préoccupations juridiques contemporaines. Cependant, outre la découverte d'êtres appelés les « enfants-loups», « enfants-animaux» ou « hommes sauvages» (3) , vivant culturellement entre humanité et animalité, l'évolution de la science a rendu possible l'existence d'êtres réels, vivant entre humanité et animalité, et participant biologiquement des deux. La science peut donc donner naissance à des « chimères réelles». Ainsi, la création d'êtres hybrides hommes-singes est techniquement possible (4) . En février 2005, un scientifique américain a réalisé une telle « chimère», en «mélangeant» un embryon humain et un embryon singe, plaçant l'Office américain des brevets face à la difficulté de déterminer la frontière entre l'homme et l'animal (5) . De plus, depuis les années 1980, les scientifiques ont constaté qu'au début de son développement, alors que le système immunitaire n'est pas encore formé, un foetus animal pouvait recevoir des tissus provenant d'une autre espèce, sans les rejeter. Une fois né, l'animal constitue une « chimère», puisqu'il possède des cellules ayant les caractères génétiques d'une autre espèce animale. Cette technique pourrait être appliquée au foetus humain : « Les scientifiques sont convaincus que les recherches portant sur les foetus animaux et humains vont enfin offrir la possibilité de franchir la barrière des espèces dans les cas de transplantation d'organes animaux. Il suffirait pour cela de greffer des cellules animales sur l'organe malade du foetus humain, par exemple un coeur ou un foie, de façon à ce que ce dernier induise une tolérance. Sitôt après la naissance du bébé, on pourrait alors greffer un foie ou un coeur d'animal, sans risque de rejet. Sous réserve d'une manipulation dans l'oeuf, chacun d'entre nous pourrait subir une transplantation d'organe de porc ou de singe dans les premiers mois de sa vie» (6) .
3 - Plusieurs critères peuvent être proposés afin de qualifier juridiquement l'être issu de la fusion de cellules humaines et animales, implantée dans l'utérus d'une femme. Biologiquement, l'être humain peut être appréhendé comme « le produit de la rencontre des gamètes d'un homme et d'une femme». Cela conduit le professeur Gérard Mémeteau à considérer la chimère comme un produit d'une autre nature, devant être reconnu comme un être non-humain, dépourvu de personnalité (7) . Génétiquement, l'être humain peut se définir par rapport aux informations génétiques contenues dans son génome. Ainsi, la chimère, qui ne possèderait pas intégralement ces caractéristiques génétiques, serait là encore rejetée au-delà des frontières de l'humanité et assimilée à une chose. Cependant, ce critère génétique abandonne la définition juridique de l'homme aux seules données de la science, laissant de côté les dimensions culturelles, religieuses et philosophiques de l'être humain et permettant l'appropriation d'êtres se trouvant biologiquement entre l'humanité et l'animalité, mais dont on ne saurait totalement nier les caractéristiques humaines. Le professeur Eschbach nous invitait déjà, en 1847, à retenir comme critère le fait qu'un être doive être qualifié d'homme dès lors qu'il est issu d'une femme et ce, quelle que soit sa difformité (8) . Même si cette solution est antérieure à l'évolution récente de la science et des techniques de recherche, elle demeure toujours relativement pertinente et permet d'accorder la personnalité juridique ainsi que la protection issue des droits de l'homme à la « chimère» réelle créée par les scientifiques. Le respect de l'éthique doit bien évidemment conduire l'homme de science à ne pas transgresser de façon absolue les limites posées par la nature, en créant des êtres totalement chimériques, rappelant les « monstres» du passé ou des légendes. Toutefois, la législation la plus stricte ne peut prévenir toute transgression. Dans ce cas, accorder la personnalité et reconnaître l'humanité de tels êtres chimériques peut apparaître comme la solution la meilleure. Néanmoins, dans le texte récemment voté par les députés britanniques et qui autorise la création d'embryons hybrides, il est prévu que ces embryons ne pourront pas être implantés chez un animal ou un humain et qu'ils devront être détruits dans les quatorze jours.
4 - L'existence de « chimères réelles» renvoie également à la pratique des xénogreffes. Très simplement, la xénogreffe peut se définir comme étant la greffe d'un organe animal chez l'homme, mais elle se caractérise par une certaine diversité de techniques et de pratiques. La xénogreffe est déjà couramment pratiquée comme dispositif médical, avec l'utilisation de tissus d'origine animale rendus non viables ou de produits non viables dérivés de tissus d'origine animale : utilisation habituelle de valves cardiaques porcines, d'implants de pontage coronarien, de tendons, d'implants cristalliniens d'origine animale, notamment. Plus précaire est encore la technique de la greffe d'organes, comme le foie ou le coeur, provenant d'un animal et envisagée comme une alternative à l'allogreffe, comme une solution à la pénurie d'organes humains et à la multiplication des trafics d'organes. De telles interventions ont été pratiquées dès le XIXe siècle de façon limitée et le XXesiècle consacra les premières véritables greffes animales chez l'homme, dont l'histoire de Baby Fae, bébé prématuré ayant survécu vingt jours avec un coeur de babouin, constitue une illustration très médiatique et dramatique, en 1985. Outre les questions relatives à la licéité et à la légalité de la xénogreffe (9) , le développement de cette technique de greffe d'organes animaux soulève des questions portant sur la légitimité de la xénogreffe et concernant directement l'animal, porteur et donneur d'organes destinés à l'homme.
5 - La question des xénogreffes - et de leur légitimité - soulève ainsi, implicitement, la question du statut juridique de l'animal (10) . Les principes d'utilité sociale et de subsidiarité justifient la légitimité des transplantations d'organes animaux chez l'homme. L'animal-chose, tel qu'il est reconnu par le Code civil qui le classe expressément dans la catégorie des choses juridiques, meubles par nature ou immeubles par destination (11) , peut alors servir de réservoir d'organes pour l'espèce humaine et être sacrifié pour permettre la transplantation de ses organes chez un être humain.
6 - Toutefois, la reconnaissance de l'animal comme être vivant et sensible - par le Code pénal, notamment, qui le protège contre les atteintes à sa vie et à son intégrité - pose les limites de la pratique des xénogreffes. Ainsi, dans ce domaine, même si l'animal peut subir une atteinte volontaire à sa vie, dans la mesure où l'une des conditions premières de la réalisation de l'opération est le sacrifice de l'animal, celui-ci ne doit pas être exposé à des mauvais traitements, des actes de cruauté ou des sévices graves (12) . Des considérations de protection animale peuvent donc limiter la pratique des xénogreffes. Par exemple, au Royaume-Uni, le Nuffield Council on Bioethics - le Comité national d'éthique du Royaume-Uni - a rendu, en 1996, un rapport suggérant la poursuite des travaux dans le domaine des xénogreffes, sous réserve du respect de règles rigoureuses assurant le bien-être des animaux (13) . Le respect du bien-être animal est également prescrit par les conclusions et recommandations de la consultation sur les xénotransplantations tenue à Genève du 28 au 30 octobre 1997 (14) . L'éthique de l'expérimentation animale constitue aussi une limite à la pratique des xénogreffes qui nécessitera certainement une intensification du clonage des animaux ou, tout au moins, une modification génétique de ceux-ci. La modification génétique des animaux doit ainsi être justifiée sur le plan éthique et réalisée dans des conditions éthiquement acceptables, ce qui implique le devoir d'éviter ou de réduire la souffrance animale, l'animal ne devant pas être soumis à une souffrance injustifiée ou disproportionnée, ainsi que l'obligation de réduire et de remplacer, lorsque cela est possible, les expériences sur les animaux (15) .
7 - La « pluralité» actuelle du statut juridique de l'animal constitue donc à la fois une légitimation (animal-chose du Code civil) et une limite (animal, être vivant et sensible juridiquement protégé) à la pratique des xénogreffes. Cette pratique contribue à permettre l'existence d'êtres hybrides qui soulève la problématique de l'ambiguïté du statut juridique de ces êtres et du statut juridique de l'animal dans les xénogreffes.
8 - D'une part, suite à une xénogreffe, un être humain va vivre en ayant, dans son corps, un ou des organes animaux. Cet être peut, a priori, être qualifié de « chimère réelle», car il correspond à un homme doté d'organes provenant d'une autre espèce. Toutefois, son statut ne fait aucun doute : il est un homme, sujet de droits, doté de la personnalité juridique. La présence d'organes animaux dans son corps ne remet pas en cause son statut juridique. Déjà aujourd'hui, les individus sur lesquels sont implantés des tissus ou des produits d'origine animale ne voient pas leur statut d'êtres humains, de personnes juridiques, remis en cause sur ce fondement. Il en est de même lorsque l'individu reçoit un organe d'origine animale, qui intègre la personne juridique et perd ainsi sa nature première animale. L'organe devient un élément du corps humain qui suit le régime juridique de la personne et peut alors être considéré, du fait de l'incorporation dans le corps de l'homme, comme une « personne par incorporation» (16) .
9 - D'autre part, en amont de la xénogreffe, des animaux sont porteurs d'organes qui sont destinés à l'homme, destinés à devenir des organes humains. Là encore, la science utilise des êtres qui peuvent être qualifiés de « chimères réelles». Ces animaux seront, le plus souvent, modifiés génétiquement, de façon à limiter au maximum les risques de rejet de leurs organes par les receveurs humains. Ces êtres demeurent bien des animaux, même modifiés génétiquement. Cependant, leurs organes peuvent être appréciés comme des organes humains « par destination», puisque, organes animaux, ils sont destinés à devenir des organes de l'homme receveur. Le droit positif n'envisage pas particulièrement la situation juridique de ces animaux qui demeurent des choses. Mais la question de leur statut propre et de celui de leurs organes peut laisser subsister objectivement des zones d'incertitudes.
10 - En outre, un parallèle peut être établi avec les immeubles par destination. L'immeuble par destination a ou perd cette qualité selon qu'il est attaché ou non à l'immeuble par nature ; il est également nécessairement détachable, contrairement au meuble incorporé dans l'immeuble par nature. Or, l'organe animal est détachable de l'animal porteur. Mais, une fois incorporé dans le corps de l'homme receveur, cet organe ne sera plus détachable, sauf pour raison médicale. L'animal porteur de l'organe destiné à l'homme n'est pas une personne juridique. Et, alors que l'immobilisation par destination n'est effective que si le meuble et l'immeuble appartiennent au même propriétaire, l'homme n'est pas propriétaire de son corps, qui reçoit l'organe issu de l'animal. Les organes de l'animal porteur ne peuvent donc pas être considérés comme « personnes par destination», mais uniquement comme « organes humains par destination», ce qui ne correspond à aucun statut particulier, mais pourrait entraîner l'application des règles relatives aux organes humains, dans l'hypothèse des greffes (17) . Une fois que l'organe est prélevé et incorporé dans le corps de l'homme, il devient «personne par incorporation», comme envisagé précédemment.
11 - Enfin, la question de la brevetabilité du vivant peut également se poser, en ce qui concerne les animaux transgéniques et la xénotransplantation, qui a pour but la transplantation d'un organe animal chez un être humain. Le porc, dont les organes ont une taille et une physiologie qui les rendent très semblables à ceux des humains, est l'animal utilisé comme fournisseur des organes destinés à la xénotransplantation. Afin d'augmenter les chances de réussite de l'opération, c'est-à-dire dans le but de rendre le patrimoine génétique de l'animal davantage compatible avec celui de l'homme et d'écarter au maximum les possibilités de rejet ou d'infections, le patrimoine génétique du porc subit des modifications génétiques. Des brevets portant sur l'animal transgénique utilisé à des fins de xénotransplantation peuvent être sollicités. Les réponses juridiques données au problème de la brevetabilité de cet animal éclairent le débat sur le statut de l'animal dans les biotechnologies (18) . L'exemple du droit des brevets met en effet en exergue la réification continue de l'animal. La reconnaissance juridique de la brevetabilité du vivant entraîne une nouvelle considération de la vie, en raison du déplacement des critères, du vivant à l'activité de l'homme. Ainsi, le critère du vivant ne suffit pas à distinguer nettement l'animal des autres choses. L'animal, être vivant, est essentiellement appréhendé comme res, qui peut être l'objet de brevet. L'ensemble du débat tient alors au souci d'éviter l'appropriation du vivant, d'une espèce (19) . Il s'agit d'empêcher que tous les individus d'une même espèce deviennent la propriété d'une seule société, titulaire d'un brevet. L'animal utilisé dans les xénogreffes et modifié génétiquement à cette fin n'apparaît plus que comme un réservoir d'organes pour l'homme. Les xénogreffes ont des justifications éthiques, morales, médicales. Il n'en demeure pas moins vrai que l'animal est alors toujours rapproché de la chose et traité comme une simple chose, afin de permettre de telles opérations et d'en assurer une exploitation lucrative par l'obtention de brevets (20) .
Gazette du Palais, 30 décembre 2008 n° 365, P. 62 - Tous droits réservés
13:18 | Lien permanent | Commentaires (1)
14/03/2013
Pourquoi j'ai rompu avec la gauche
Jean-Claude Michéa: "Pourquoi j'ai rompu avec la gauche"
Mardi 12 Mars 2013 (MARIANNE)
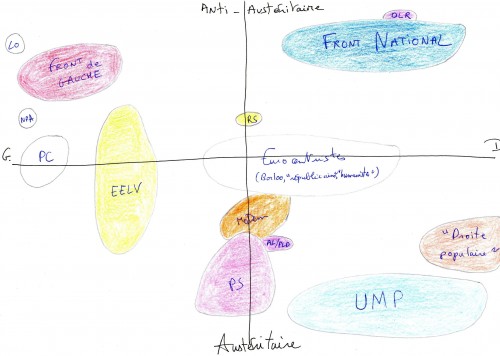 Toujours imprégné de libéralisme mitterrandien, le socialisme à la Hollande ne convainc pas le philosophe Jean-Claude Michéa. A l'occasion de son nouveau livre, "les Mystères de la gauche", il s'en explique en exclusivité pour "Marianne".
Toujours imprégné de libéralisme mitterrandien, le socialisme à la Hollande ne convainc pas le philosophe Jean-Claude Michéa. A l'occasion de son nouveau livre, "les Mystères de la gauche", il s'en explique en exclusivité pour "Marianne".
Au moins depuis la parution d'Impasse Adam Smith en 2002, un livre de Jean-Claude Michéa est toujours attendu. Avec jubilation. Ou avec un fusil, c'est selon. D'abord parce que la parole de ce philosophe, nourri à la pensée de George Orwell, de Guy Debord et du meilleur Marx, est extrêmement rare dans les médias. Ensuite parce qu'il appartient à cette espèce politiquement ambidextre, hélas si peu représentée et si mal comprise, capable de se montrer aussi cruel à l'égard d'une gauche libérale qui s'autocaricature en valorisant toutes les prétendues transgressions morales et culturelles, qu'il sait se montrer lucide à l'égard de l'incroyable cynisme des dirigeants de la droite actuelle (Sarkozy et Copé en tête), lorsqu'ils se posent en défenseurs des «petites gens», que vient en fait piétiner tout leur programme économique, voué à l'expansion illimitée des intérêts du CAC 40.
Disons-le d'emblée : les Mystères de la gauche (Climats) est le livre que l'on espérait depuis plusieurs années de la part de Michéa. Sur plusieurs points capitaux, celui-ci s'explique en effet. Notamment sur son refus définitif de se réclamer de «la gauche», pour penser le front de libération populaire qu'il appelle de ses vœux. «La gauche», un signifiant-maître trop longtemps prostitué, et qu'il juge désormais «inutilement diviseur, dès lors qu'il s'agit de rallier les classes populaires». Aussi parce que le philosophe répond au passage aux procès en droitisation qui lui sont régulièrement faits. Ainsi cet anticapitaliste conservateur admet-il ici que l'attachement aux «valeurs traditionnelles» peut produire des dérives inquiétantes, et que, «sur ce point, les mises en garde permanentes de la gauche conservent tout leur sens». Un grand millésime donc, pour l'orwellien de Montpellier. Percutant, souvent hilarant dans sa façon de moquer l'autocélébration de la gauche en «parti de demain» (Zola), Michéa dérange, éclaire, emporte presque toujours la conviction.
Marianne : Vous estimez urgent d'abandonner le nom de «gauche», de changer de signifiant pour désigner les forces politiques qui prendraient à nouveau en compte les intérêts de la classe ouvrière... Un nom ne peut-il pourtant ressusciter par-delà ses blessures historiques, ses échecs, ses encombrements passés ? Le problème est d'ailleurs exactement le même pour le mot «socialisme», qui après avoir qualifié l'entraide ouvrière chez un Pierre Leroux s'est mis, tout à fait a contrario, à désigner dans les années 80 les turlupinades d'un Jack Lang. Ne pourrait-on voir dans ce désir d'abolir un nom de l'histoire comme un écho déplaisant de cet esprit de la table rase que vous dénoncez sans relâche par ailleurs ?
Jean-Claude Michéa : Si j'en suis venu - à la suite, entre autres, de Cornelius Castoriadis et de Christopher Lasch - à remettre en question le fonctionnement, devenu aujourd'hui mystificateur, du vieux clivage gauche-droite, c'est simplement dans la mesure où le compromis historique forgé, au lendemain de l'affaire Dreyfus, entre le mouvement ouvrier socialiste et la gauche libérale et républicaine (ce «parti du mouvement» dont le parti radical et la franc-maçonnerie voltairienne constituaient, à l'époque, l'aile marchante) me semble désormais avoir épuisé toutes ses vertus positives. A l'origine, en effet, il s'agissait seulement de nouer une alliance défensive contre cet ennemi commun qu'incarnait alors la toute-puissante «réaction». Autrement dit, un ensemble hétéroclite de forces essentiellement précapitalistes qui espéraient encore pouvoir restaurer tout ou partie de l'Ancien Régime et, notamment, la domination sans partage de l'Eglise catholique sur les institutions et les âmes. Or cette droite réactionnaire, cléricale et monarchiste a été définitivement balayée en 1945 et ses derniers vestiges en Mai 68 (ce qu'on appelle de nos jours la «droite» ne désigne généralement plus, en effet, que les partisans du libéralisme économique de Friedrich Hayek et de Milton Friedman). Privé de son ennemi constitutif et des cibles précises qu'il incarnait (comme, la famille patriarcale ou l'«alliance du trône et de l'autel») le «parti du mouvement» se trouvait dès lors condamné, s'il voulait conserver son identité initiale, à prolonger indéfiniment son travail de «modernisation» intégrale du monde d'avant (ce qui explique que, de nos jours, «être de gauche» ne signifie plus que la seule aptitude à devancer fièrement tous les mouvements qui travaillent la société capitaliste moderne, qu'ils soient ou non conformes à l'intérêt du peuple, ou même au simple bon sens). Or, si les premiers socialistes partageaient bien avec cette gauche libérale et républicaine le refus de toutes les institutions oppressives et inégalitaires de l'Ancien Régime, ils n'entendaient nullement abolir l'ensemble des solidarités populaires traditionnelles ni donc s'attaquer aux fondements mêmes du «lien social» (car c'est bien ce qui doit inéluctablement arriver lorsqu'on prétend fonder une «société» moderne - dans l'ignorance de toutes les données de l'anthropologie et de la psychologie - sur la seule base de l'accord privé entre des individus supposés «indépendants par nature»). La critique socialiste des effets atomisants et humainement destructeurs de la croyance libérale selon laquelle le marché et le droit ab-strait pourraient constituer, selon les mots de Jean-Baptiste Say, un «ciment social» suffisant (Engels écrivait, dès 1843, que la conséquence ultime de cette logique serait, un jour, de «dissoudre la famille») devenait dès lors clairement incompatible avec ce culte du «mouvement» comme fin en soi, dont Eduard Bernstein avait formulé le principe dès la fin du XIXe siècle en proclamant que «le but final n'est rien» et que «le mouvement est tout». Pour liquider cette alliance désormais privée d'objet avec les partisans du socialisme et récupérer ainsi son indépendance originelle, il ne manquait donc plus à la «nouvelle» gauche que d'imposer médiatiquement l'idée que toute critique de l'économie de marché ou de l'idéologie des droits de l'homme (ce «pompeux catalogue des droits de l'homme» que Marx opposait, dans le Capital, à l'idée d'une modeste «Magna Carta» susceptible de protéger réellement les seules libertés individuelles et collectives fondamentales) devait nécessairement conduire au «goulag» et au «totalitarisme». Mission accomplie dès la fin des années 70 par cette «nouvelle philosophie» devenue, à présent, la théologie officielle de la société du spectacle. Dans ces conditions, je persiste à penser qu'il est devenu aujourd'hui politiquement inefficace, voire dangereux, de continuer à placer un programme de sortie progressive du capitalisme sous le signe exclusif d'un mouvement idéologique dont la mission émancipatrice a pris fin, pour l'essentiel, le jour où la droite réactionnaire, monarchiste et cléricale a définitivement disparu du paysage politique. Le socialisme est, par définition, incompatible avec l'exploitation capitaliste. La gauche, hélas, non. Et si tant de travailleurs - indépendants ou salariés - votent désormais à droite, ou surtout ne votent plus, c'est bien souvent parce qu'ils ont perçu intuitivement cette triste vérité.
Vous rappelez très bien dans les Mystères de la gauche les nombreux crimes commis par la gauche libérale contre le peuple, et notamment le fait que les deux répressions ouvrières les plus sanglantes du XIXe siècle sont à mettre à son compte. Mais aujourd'hui, tout de même, depuis que l'inventaire critique de la gauche culturelle mitterrandienne s'est banalisé, ne peut-on admettre que les socialistes ont changé ? Un certain nombre de prises de conscience importantes ont eu lieu. Celle, par exemple, du long abandon de la classe ouvrière est récente, mais elle est réelle. Sur les questions de sécurité également, on ne peut pas davantage dire qu'un Manuel Valls incarne une gauche permissive et angéliste. Or on a parfois l'impression à vous lire que la gauche, par principe, ne pourra jamais se réformer... Est-ce votre sentiment définitif ?
J.-C.M. : Ce qui me frappe plutôt, c'est que les choses se passent exactement comme je l'avais prévu. Dès lors, en effet, que la gauche et la droite s'accordent pour considérer l'économie capitaliste comme l'horizon indépassable de notre temps (ce n'est pas un hasard si Christine Lagarde a été nommée à la tête du FMI pour y poursuivre la même politique que DSK), il était inévitable que la gauche - une fois revenue au pouvoir dans le cadre soigneusement verrouillé de l'«alternative unique» - cherche à masquer électoralement cette complicité idéologique sous le rideau fumigène des seules questions «sociétales». De là le désolant spectacle actuel. Alors que le système capitaliste mondial se dirige tranquillement vers l'iceberg, nous assistons à une foire d'empoigne surréaliste entre ceux qui ont pour unique mission de défendre toutes les implications anthropologiques et culturelles de ce système et ceux qui doivent faire semblant de s'y opposer (le postulat philosophique commun à tous ces libéraux étant, bien entendu, le droit absolu pour chacun de faire ce qu'il veut de son corps et de son argent). Mais je n'ai là aucun mérite. C'est Guy Debord qui annonçait, il y a vingt ans déjà, que les développements à venir du capitalisme moderne trouveraient nécessairement leur alibi idéologique majeur dans la lutte contre «le racisme, l'antimodernisme et l'homophobie» (d'où, ajoutait-il, ce «néomoralisme indigné que simulent les actuels moutons de l'intelligentsia»). Quant aux postures martiales d'un Manuel Valls, elles ne constituent qu'un effet de communication. La véritable position de gauche sur ces questions reste bien évidemment celle de cette ancienne groupie de Bernard Tapie et d'Edouard Balladur qu'est Christiane Taubira.
Contrairement à d'autres, ce qui vous tient aujourd'hui encore éloigné de la «gauche de la gauche», des altermondialistes et autres mouvements d'indignés, ce n'est pas l'invocation d'un passé totalitaire dont ces lointains petits cousins des communistes seraient encore comptables... C'est au contraire le fond libéral de ces mouvements : l'individu isolé manifestant pour le droit à rester un individu isolé, c'est ainsi que vous les décrivez. N'y a-t-il cependant aucune de ces luttes, aucun de ces mouvements avec lequel vous vous soyez senti en affinité ces dernières années ?
J.-C.M. : Si l'on admet que le capitalisme est devenu un fait social total - inséparable, à ce titre, d'une culture et d'un mode de vie spécifiques -, il est clair que les critiques les plus lucides et les plus radicales de cette nouvelle civilisation sont à chercher du côté des partisans de la «décroissance». En entendant par là, naturellement, non pas une «croissance négative» ou une austérité généralisée (comme voudraient le faire croire, par exemple, Laurence Parisot ou Najat Vallaud-Belkacem), mais la nécessaire remise en question d'un mode de vie quotidien aliénant, fondé - disait Marx - sur l'unique nécessité de «produire pour produire et d'accumuler pour accumuler». Mode de vie forcément privé de tout sens humain réel, inégalitaire (puisque la logique de l'accumulation du capital conduit inévitablement à concentrer la richesse à un pôle de la société mondiale et l'austérité, voire la misère, à l'autre pôle) et, de toute façon, impossible à universaliser sans contradiction dans un monde dont les ressources naturelles sont, par définition, limitées (on sait, en effet, qu'il faudrait déjà plusieurs planètes pour étendre à l'humanité tout entière le niveau de vie actuel de l'Américain moyen). J'observe avec intérêt que ces idées de bon sens - bien que toujours présentées de façon mensongère et caricaturale par la propagande médiatique et ses économistes à gages - commencent à être comprises par un public toujours plus large. Souhaitons seulement qu'il ne soit pas déjà trop tard. Rien ne garantit, en effet, que l'effondrement, à terme inéluctable, du nouvel Empire romain mondialisé donnera naissance à une société décente plutôt qu'à un monde barbare, policier et mafieux.
Vous réaffirmez dans ce livre votre foi en l'idée que le peuple serait dépositaire d'une common decency [«décence ordinaire», l'expression est de George Orwell] avec lesquelles les «élites» libérales auraient toujours davantage rompu. Mais croyez-vous sincèrement que ce soit aujourd'hui l'attachement aux valeurs morales qui définisse «le petit peuple de droite», ainsi que vous l'écrivez ici ? Le désossage des structures sociales traditionnelles, ajouté à la déchristianisation et à l'impact des flux médiatiques dont vous décrivez ici les effets culturellement catastrophiques, a également touché de plein fouet ces classes-là. N'y a-t-il donc pas là quelque illusion - tout à fait noble, mais bel et bien inopérante - à les envisager ainsi comme le seul vivier possible d'un réarmement moral et politique ?
J.-C.M. : S'il n'y avait pas, parmi les classes populaires qui votent pour les partis de droite, un attachement encore massif à l'idée orwellienne qu'il y a «des choses qui ne se font pas», on ne comprendrait pas pourquoi les dirigeants de ces partis sont en permanence contraints de simuler, voire de surjouer de façon grotesque, leur propre adhésion sans faille aux valeurs de la décence ordinaire. Alors même qu'ils sont intimement convaincus, pour reprendre les propos récents de l'idéologue libéral Philippe Manière, que seul l'«appât du gain» peut soutenir «moralement» la dynamique du capital (sous ce rapport, il est certainement plus dur d'être un politicien de droite qu'un politicien de gauche). C'est d'ailleurs ce qui explique que le petit peuple de droite soit structurellement condamné au désespoir politique (d'où son penchant logique, à partir d'un certain seuil de désillusion, pour le vote d'«extrême droite»). Comme l'écrivait le critique radical américain Thomas Franck, ce petit peuple vote pour le candidat de droite en croyant que lui seul pourra remettre un peu d'ordre et de décence dans cette société sans âme et, au final, il se retrouve toujours avec la seule privatisation de l'électricité ! Cela dit, vous avez raison. La logique de l'individualisme libéral, en sapant continuellement toutes les formes de solidarité populaire encore existantes, détruit forcément du même coup l'ensemble des conditions morales qui rendent possible la révolte anticapitaliste. C'est ce qui explique que le temps joue de plus en plus, à présent, contre la liberté et le bonheur réels des individus et des peuples. Le contraire exact, en somme, de la thèse défendue par les fanatiques de la religion du progrès.
03:52 | Lien permanent | Commentaires (0)
13/03/2013
Une construction européenne kafkaïenne
 Comment expliquer qu'après avoir promis la croissance et le bien-être pour tous, l'Union européenne (UE) soit devenue cette union d'Etats dont les gouvernements désemparés s'avèrent incapables de faire face à la crise ? Comment est-on passé de Keynes à Kafka ?
Comment expliquer qu'après avoir promis la croissance et le bien-être pour tous, l'Union européenne (UE) soit devenue cette union d'Etats dont les gouvernements désemparés s'avèrent incapables de faire face à la crise ? Comment est-on passé de Keynes à Kafka ?
C'est là que vient à l'esprit une question qu'on ose à peine formuler : aussi habile, aussi nécessaire même qu'il ait pu paraître, la mise entre parenthèses du politique n'est-elle pas le ver dans le fruit qui a pourri la construction européenne ? Elle a soumis la communauté en formation à une loi sociologique qui veut que les structures bureaucratiques n'aient pour fin que leur propre expansion, à la fois en élargissant sans cesse leur sphère d'action et en accaparant toujours plus de pouvoir dans un nombre toujours plus grand de domaines de compétence.
La règle s'est ainsi imposée selon laquelle devait être considéré comme bon tout ce qui allait dans le sens de l'intégration et du consensus, mauvais tout ce qui allait en sens contraire. L'objectif est devenu d'éliminer à tout prix les conflits, en oubliant que la démocratie se nourrit des conflits. Il est vrai que dans ce système les gouvernements démocratiquement élus sont perçus comme des institutions démagogiques, pour ne pas dire des empêcheurs de tourner en rond. L'indépendance des banques centrales, et singulièrement de la Banque centrale européenne (BCE), est devenue le symbole de ce dessaisissement des Etats. Ce n'était qu'un premier pas. Une étrange constellation s'est constituée, composée d'innombrables institutions communautaires non élues et de gouvernements nationaux. Ces derniers n'ont pas été à proprement parler dépossédés de leur pouvoir, mais ils ne peuvent l'exercer qu'à condition de suivre les normes qui leur sont imposées de l'extérieur. Cet extérieur n'est pas un pouvoir central, ni même un quelconque autocrate, mais une entité aux visages multiples, sans nom et sans contours précis, qui ne tire sa puissance que du mouvement d'expansion qui, une fois impulsé, échappe à tout contrôle. En mettant en oeuvre une politique de relance communautaire, l'UE aurait pu contrecarrer le discrédit de la politique de la demande, qui à l'échelle nationale bute sur la contrainte extérieure. La plus grande partie des échanges des pays européens ont lieu, en effet, entre ces pays. De surcroît, une relance coordonnée de l'ensemble de la zone euro aurait entraîné une dépréciation de l'euro, favorable à sa balance commerciale avec le reste du monde. Au lieu de quoi, sous l'emprise de l'orthodoxie allemande et du libéralisme ambiant, les règles imposées aux Etats membres n'ont fait que renforcer leur impuissance, sans que la Communauté en prenne le relais. Les politiques budgétaires ont été enfermées dans un corset juridique. Dans une démocratie, les citoyens sont invités, au moment des élections, à se prononcer sur les résultats obtenus, notamment en matière économique. Dans l'UE, où seul le Parlement européen est élu, mais avec une audience et des pouvoirs encore relativement limités, c'est moins l'efficacité de la politique économique qui est reconnue ou sanctionnée par les citoyens que sa conformité aux règles de droit qui est jugée par des commissaires, des commissions ou des juges. La question est alors de savoir si les critères de Maastricht et d'autres sont respectés et non si la croissance est excessivement faible et si le chômage augmente. La règle d'or que MmeMerkel a imposée à ses partenaires renforce encore ce juridisme. Le comportement des dirigeants français illustre bien la perversion de la politique à laquelle peuvent conduire le mélange de règles rigides et l'obsession du consensus. En général, les hommes d'Etat définissent une stratégie faite d'avancées et de concessions en fonction des objectifs qu'ils se proposent. Nos dirigeants, mais ils ne sont pas les seuls, ont adopté la démarche inverse : ils sont prêts à sacrifier leurs promesses électorales pour se conformer aux normes qui leur sont imposées. Les concessions ne sont plus pour eux un moyen de parvenir à leurs fins. C'est de faire toutes les concessions nécessaires pour parvenir au consensus qui est devenu leur priorité, quelles qu'en soient les conséquences. Quand, à l'issue du Conseil européen des 7 et 8 février, François Hollande se félicite d'avoir obtenu un compromis, alors qu'il vient d'accepter une réduction du budget communautaire, c'est-à-dire d'avaliser que l'UE s'éloigne encore davantage de la perspective d'une politique de relance, il illustre parfaitement cette inversion des priorités. Dans tout système qui se veut consensuel, la langue de bois est de règle. Elle est un moyen privilégié pour juguler les velléités de contestation qui pourraient déboucher sur des conflits. Parler de croissance quand on met en oeuvre une politique dont on sait qu'elle va conduire à la stagnation est devenu habituel. De même, les références permanentes à la convergence sont censées effacer la divergence des économies européennes que l'on observe pourtant depuis des années. Enfin, quiconque critique le fonctionnement de l'UE est aussitôt accusé d'être un antieuropéen primaire. Dans ce contexte, les élections qui viennent de se dérouler en Italie sont symptomatiques du désarroi ambiant. Dans un système démocratique, et même dans une autocratie, le mécontentement populaire peut être dirigé sur une cible : une majorité que l'on peut espérer remplacer, un dictateur dont on attend qu'il soit renversé. Dans un système oligarchique comme celui qui prévaut au sein de l'UE, le pouvoir est suffisamment dilué pour être hors d'atteinte. Il ne reste pour témoigner de son mécontentement que le rejet et le ricanement. De la même façon, dans l'URSS, les anecdotes contre le régime étaient le principal moyen de contestation, un procédé passif et sans risque pour le pouvoir en place... jusqu'à son enlisement final. C'est ce dont viennent de témoigner les électeurs italiens, las de cet exécutant appliqué des exigences communautaires qu'a été Mario Monti. Beppe Grillo serait-il le triste avenir de l'Union européenne ?
André Grjebine (Le Monde, 6 mars 2013)
13:03 | Lien permanent | Commentaires (0)
06/03/2013
Notice analitique du prédicateur interne de l'URSS
Mis en ligne dans son orthographe originale.
Et tiré de:
«La Fin de l'Hisoire», «le Choc des Civilisations» & les perspectives réelles de l'humanité
 Un politologue américain Francis Fukuyama (né en 1952) publia en 1989 un article La Fin de l'Histoire? En 1992 il en développe les thèses dans un livre intitulé La Fin de l'Histoire et le Dernier Homme. En 1993 un autre politologue américain Samuel Huntington (1927-2008) lui repliqua par d'abord un article Le Choc des Civilisations et ensuite par un essai d'analyse politique intitulé en anglais The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order publié en version français en 1996 sous un titre Le Choc des Civilisations. Depuis, les deux termes "fin de l'histoire" et "choc des civilisations" font partie du vocabulaire international politique, malgré que la majorité de ceux, qui ont l'habitude de réfléchir suivant le tunnel de ces stratégies, n'aient souvent pas lu les ouvrages des ces deux auteurs.
Un politologue américain Francis Fukuyama (né en 1952) publia en 1989 un article La Fin de l'Histoire? En 1992 il en développe les thèses dans un livre intitulé La Fin de l'Histoire et le Dernier Homme. En 1993 un autre politologue américain Samuel Huntington (1927-2008) lui repliqua par d'abord un article Le Choc des Civilisations et ensuite par un essai d'analyse politique intitulé en anglais The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order publié en version français en 1996 sous un titre Le Choc des Civilisations. Depuis, les deux termes "fin de l'histoire" et "choc des civilisations" font partie du vocabulaire international politique, malgré que la majorité de ceux, qui ont l'habitude de réfléchir suivant le tunnel de ces stratégies, n'aient souvent pas lu les ouvrages des ces deux auteurs.
Si toutefois on se référait directement aux textes il serait évident qu'il n'y a pas de divergences fondamentales entre les stratégies; simplement chacun des auteurs veut attirer l'attention du lecteur sur l'un des deux aspects différents du même processus historique qui a lieu dans le monde. En politique d'action, les deux termes se sont transformés en slogans, qui exercent une influence sur la mentalité des politiciens de différents pays, pour les intégrer dans une même entité psychique autonome, égrégore, et favoriser à la fois une "fin de l'histoire" (c'est-à-dire le triomphe des idées libérales occidentales) et un choc des civilisations pouvant entraîner une vraie fin de la civilisation contemporaine. Alors on n'a que se demander sur la tendance qui pourrait l'emporter:
serait-ce vraiment une "fin de l'histoire" qui signifie le triomphe des idées libérales occidentales, ou
l'entêtement stupide de l'Occident dans le souhait de progresser dans ce sens, provoquerait un choc des civilisations capable de mettre fin à l'histoire mondiale contemporaine, ou bien
une tendance tierce viendrait se profiler pour faire éteindre les deux premières tendances.
Cependant, les auteurs n'arrivent pas à discerner une troisième tendance et, pour cette raison, ne l'étudient pas.
D'après Francis Fukuyama et Samuel Huntington, le point culminant d'organisation de la société humaine ne pouvant être atteint qu'à travers les idées libérales. Huntington cite Fukuyama: Selon Fukuyama "Nous avons atteint le terme de l'évolution idéologique de l'humanité et de l'universialisation de la démocratie libérale occidentale en tant que forme définitive de gouvernement. "A coup sûr, écrit-il, certains conflits auront lieu à l'avenir dans le Tiers-monde, mais c'en est fini des guerres mondiales, et pas seulement en Europe. "C'est précisément dans le monde non européen "que de grands changements se sont produits, en particulier en Chine et en Union Soviétique. La guerre des idées est achevée. On trouvera toujours des partisans du marxisme-léninisme " à Managua, à Pyongyang ou à Cambridge, Massachusetts", mais la démocratie libérale a vaincu. L'avenir ne sera pas fait de grands combats exaltés au nom d'idées; il sera plutôt consacré à la résolution de problèmes techniques et économiques concrets. Et Fukuyama de conclure, non sans une certaine tristesse, que ce sera assez ennuyeux".
Il est à noter que Fukuyama ne décrit pas un passé accompli, mais affirme que la guerre des idées avait été gagnée par le libéralisme occidental du moment où le "fascisme" et le "marxisme" font preuve de leur inconsistance traduite par la défaite en 1945 de l'Allemagne nazie, de l'Italie et du Japon impérialiste et, 40 ans après, par des reformes sociales entreprises en URSS et en Chine; au cours de ces réformes les idées libérales occidentales pénètrent dans la vie économique et social des deux pays. Total déaprès Fukuyama: tant que les masses de populations des pays non encore libéraux demeureront orientées, à défaut d'autres idées concurrentes, vers la consommation à l'occidentale, tous les pays, tôt ou tard, finiront par devenir universellement libéraux à l'occidentale sans plus de raisons d'entrer en conflit international. Cependant, Fukuyama n'étudie pas un scénario consacré à une libéralisation du monde.
Huntington, quant à lui, ne conteste pas l'assertion de Fukuyama relative à la supériorité de la démocratie libérale occidentale sur d'autres modes de vie des sociétés connues dans l'histoire, mais précise: "L'essence de la civilisation occidentale, c'est le droit, pas le Mac Do. Le fait que les non Occidentaux puissent opter pour le second n'implique pas qu'ils acceptent le premier".
En raison que le Mac Do (symbole de l'abondance occidentale) soie accepté et le libéralisme occidental (qui selon Huntington et Fukuyama, crée lui seul l'abondance de consommation dans les pays occidentaux) soie refusé dans certains régions de la planète, son expansion n'est point capable de le faire triompher à l'échelle mondiale mais, au contraire, pourrait provoquer une guerre mondiale. Cette guerre, même dans une version non nucléaire, pouvant provoquer un recul économique et culturel de l'humanité de beaucoup de décennies.
Par ailleurs, Huntington signale qu'à partir du début de XXe siècle la puissance de l'Occident commence à diminuer progressivement par rapport aux autres civilisations régionales. Cette situation ne fait que galvaniser le potentiel d'un conflit entre les civilisations. Pour lui donc, la mission de l'avenir historique immédiat doit consister moins en effort d'activer la libéralisation à l'occidentale des sociétés régionales qu'en effort d'éviter un choc des civilisations, et ce pour préserver l'Occident jusqu'à ce qu'il puisse se rendre compte d'existence d'un conflit interne et le vaincre. Huntington fait allusion au conflit mais ne s'enfonce pas dans l'examen de son essence, tout en se réduisant à donner des recommandations concernant l'avenir historique immédiat:
"Pour préserver la civilisation occidentale, en dépit du déclin de la puissance de l'Occident, il est de l'intérêt des Etats-Unis et des pays européens:
de mener à bien l'intégration politique, économique et militaire et de coordonner leurs politiques afin d'empêcher les Etats d'autres civilisations d'exploiter leurs différends;
d'intégrer à l'Union européen et à l'OTAN les Etats occidentaux de l'Europe centrale, c'est-à-dire les Etats du sommet de Visegrad, les Républiques baltes, la Slovénie et la Croatie;
d'encourager l' "occidentalisation" de l'Amérique latine, et, dans la mesure du possible, l'alignement de la puissance militaire, conventionnelle et non conventionnelle, des Etats de l'Islam et des pays de culture chinoise;
de réprimer le développement du potentiel militaire des pays islamiques et "sino-"1, qui touche à la fois aux armes conventionnelles et celles de destruction massive;
d'empêcher le Japon de s'écarter de l'Occident et de se rapprocher de la Chine;
de considérer la Russie comme l'Etat phare du monde orthodoxe et comme une puissance régionale essentielle, ayant de légitimes intérêts dans la sécurité de ses frontières sud;
de maintenir la supériorité technologique et militaire de l'Occident sur les autres civilisations;
et, enfin et surtout, d'admettre que toute intervention de l'Occident dans les affaires des autres civilisations est probablement la plus dangereuse cause d'instabilité et de conflit généralisé dans un monde aux civilisations multiples".
 En plus du fait que les différences entre les idéaux et les traditions des civilisations régionales soient historiquement évidentes, la majorité de ceux qui réfléchissent en termes de "la fin de l'histoire" et du "choc des civilisations" n'ont jamais lu les recommandations de Huntington. Cependant cette manière de réfléchir et de mener l'action politique est susceptible de contribuer à la concrétisation du scénario politique mondial qui fait l'objet de l'avertissement que Huntington s'efforce à adresser à ses lecteurs et aux politiciens occidentaux, en particulier.
En plus du fait que les différences entre les idéaux et les traditions des civilisations régionales soient historiquement évidentes, la majorité de ceux qui réfléchissent en termes de "la fin de l'histoire" et du "choc des civilisations" n'ont jamais lu les recommandations de Huntington. Cependant cette manière de réfléchir et de mener l'action politique est susceptible de contribuer à la concrétisation du scénario politique mondial qui fait l'objet de l'avertissement que Huntington s'efforce à adresser à ses lecteurs et aux politiciens occidentaux, en particulier.
Fukuyama estime que la culture occidentale est une culture de consommation ingénieuse, il considère le bien-être de cette consommation comme un fondement du libéralisme et la raison d'existence de l'homme:
"En considérant que la perception humaine du monde matériel est déterminée de la prise de conscience du monde qui a lieu dans l'histoire, le monde matériel est alors tout à fait capable d'influer sur la capacité vitale de l'état concret de conscience. Il paraît notamment que l'abondance matérielle des pays aux économies libérales développées et, sur cette base, la diversité infinie dans la culture de consommation, nourrissent et soutiennent le libéralisme dans le domaine politique. Je tiens ici à éviter le déterminisme matérialiste selon lequel l'économie libérale produit inévitablement une politique libérale car je crois qu'aussi bien l'économie que la politique présuppose un état de conscience préalable qui les rend possibles l'une et l'autre. L'état de conscience qui favorise le libéralisme, ne se stabilise à la fin de l'histoire que s'il est pourvu de cette abondance. Je pourrais dire en résumé qu'un pays humain c'est une démocratie libérale dans le domaine politique accompagnée de vente libre de vidéo et stéréo dans le domaine de l'économie".
Et Fukuyama de décrire dans le dernier paragraphe de son article:
"La fin de l'histoire est ennuyeuse: la lutte pour la reconnaissance, le penchant à risquer sa vie pour un but purement abstrait, la lutte idéologique qui exige à la fois de la bravoure, de l'imagination et de l'idéalisme ne sont plus. Au lieu de tout cela: un calcul économique, des problèmes techniques innombrables, des soucis écologiques et la satisfaction des besoins ingénieux du consommateur. Il n'y a dans la période post-historique ni l'art, ni la philosophie, seul un musée bien gardé de l'histoire humaine".
Huntington, comme d'ailleurs les autres auteurs occidentaux, qui écrivent sur les perspectives de la mondialisation et de la politique en faisant de la sorte progresser l'expansion du libéralisme, ne lui répliquent pas. Le cap de la civilisation sur la consommation prostituée, considérée comme une norme de vie, exprime l'inaptitude des partisans du libéralisme de comprendre l'essence humaine et religieuse.
Huntington l'exprime de façon très claire dans sa définition de la civilisation en tant que phénomène propre aux humains:
"Une civilisation est ainsi le mode le plus élevé de regroupement et le niveau le plus haut d'identité culturelle dont les humains ont besoin pour se distinguer des autres espèces. Elle se définit à la fois par des éléments objectifs, comme la langue, l'histoire, la religion, les coutumes, les institutions, et par des éléments subjectifs d'auto identification"1.
Cette confrontation des humains avec et les espèces biologiques est très importante. Il en découle que si les animaux sauvages ne consomment que ce qu'ils trouvent dans la nature, la civilisation nous offre non seulement des matières premières mais aussi tout ce que l'homme peut d'en produire. Néanmoins, tout ce que d'après Huntington distingue l'homme des espèces biologiques, n'exprime pas l'essence réelle de l'humain; or elle est le résultat d'une distinction plus nuancée. Au terme des recherches effectuées par des zoologistes occidentaux, la culture n'est pas présente que chez les hommes elle existe également chez certaines espèces biologiques assez évoluées2. Autrement dit, la présence d'une culture ou d'une civilisation ne distinguent pas obligatoirement les humains.
L'homme se distingue des espèces biologiques qui peuplent la biosphère terrestre par sa mentalité dont la structure informationnelle et algorithmique n'est pas génétiquement programmée de façon irréversible; cette structure résulte de l'évolution individuelle qui se produit à la fois sous l'influence des circonstances extérieures et du travail de l'intelligence.
Si l'on partait à la fois des connaissances élémentaires de la biologie et du regard que chacun peut porter sur sa propre mentalité, on pourrait affirmer que la base informationnelle et algorithmique du comportement humain comprend: 1- Une composante innée, des instincts et des réflexes inconditionnels (au niveau intracellulaire et cellulaire ainsi qu’au niveau des tissus, des organes, des systèmes et de l’organisme entier), et leurs expressions façonnées par la culture. 2- Des traditions culturelles qui sont elles-mêmes supérieures aux instincts. 3- La raison personnelle limitée par les sentiments et la mémoire. 4- “L’intuition en général” – ce qu'émerge des niveaux mentaux inconscients de l’individu, lui vient de la mentalité collective, lui est inspiré par des illusions du dehors et par une obsession au sens inquisiteur du mot; et ce que l'individu n'est en mesure ni expliquer ni comprendre à la suite de connexion causale. 5- Un gouvernement divin qui s'accomplit dans le lit de la Providence, se réalise sur la base de ce qui précède, à l’exception des illusions et d’une obsession qui font des irruptions dans la mentalité de l'individu contrairement à lui.
Il y a une place potentielle ou réelle pour tout cela dans la mentalité de tout individu. En fonction des priorités, chacun est en mesure d'accéder à l’âge adulte à l'un des quatre types d’organisation mentale:
L’organisation mentale du type animal impose un comportement influencé par des instincts nourris de toutes les capacités de l'individu et de tout son potentiel de création;
L’organisation mentale du type zombie (robot) impose au libre arbitre des programmes sociaux de comportement qui s'implantent dans la mentalité de l'individu le long de sa vie, celui-ci n'arrive pas à s'en débarrasser de son propre chef;
L’organisation mentale du type démon caractérise celui qui suit le principe "je fous ce que je veux" et rejette involontairement ou exprès la Providence divine;
L’organisation mentale du type humain c'est la liberté (littéralement, libre arbitre), l'autocratie de la conscience morale basée sur la foi à Dieu, et non pas en Dieu. 
L'organisation mentale des types démon et humain est impossible à atteindre sans avoir la volonté, c'est-à-dire sans pouvoir de soumettre soi-même et le cours d'événements à une utilité perçue.
L'organisation mentale qui serait dominante dans les circonstances de la vie est conditionnée par l'éducation. Si, vers le début de l'adolescence l'individu n'arrive pas à avoir l'organisation mentale du type humain, cela signifie qu'il aura subit dans une période initiale un arrêt dans le développement ou un développement pervers de sa mentalité. Les cultures dans lesquelles des minorités d'individus statistiquement insignifiantes arrivent en age avancé à avoir l'organisation mentale du type humaine, sont des cultures défectueuses. Telles sont les cultures de toutes les civilisations régionales: occidentale, russe, musulman, védique etc.
Le problème de l'Occident réside dans le fait que le libéralisme n'implique pas une liberté individuelle, ni une société d'individus libres (c'est-à-dire aux libres arbitres), mais une culture malhonnête où tout est permis1. Et ceci puisque l'Occident est en réalité une civilisation d'esclaves, une civilisation qui fut créée de façon artificielle à la suite de réalisation du projet biblique d'asservissement des hommes et des femmes au nom de Dieu. C'est ça la raison pour laquelle le libéralisme occidental est repoussé par des partisans d'idées des autres civilisations régionales. Les petits bourgeois de l'Occidents ne le comprennent pas, quoique Huntington leur rappelle que:
"Ce n'était pas pour la supériorité d'idées (c'est le seul point de divergence entre Huntington et Fukuyama), de valeurs ou de la religion (en fait on n'a convertis que peu de représentants d'autres civilisations) que l'Occident conquérait le monde; au contraire, il excellait en violence organisée. La population de l'Occident oublie souvent ce fait, la population de non Occident ne l'oubliera jamais."
Tant que le libéralisme occidental, indépendamment des vices qui surchargent les autres civilisations, n'arrivera pas à comprendre que la liberté implique une autocratie de la conscience morale basée sur la foi à Dieu, en dehors de l'Eglise et des livres sacrés2, il perpétuera la crise: Dieu ne reste pas indifférent à ce qui se passe sur Terre.
Si l'on considérait l'histoire de l'humanité comme une histoire d'une culture multinationale d'individus à l'organisation mentale du type humain, alors l'histoire de l'humanité n'aurait pas encore commencé. Nous assistons donc à la fin d'une préhistoire, lorsque les enfants de différents peuples cherchent le chemin vers l'humanité, vers une civilisation unique d'individus ayant la mentalité humaine, vers une culture multinationale dans laquelle chacun au début de sa jeunesse (sans presque aucune exception) serait en mesure de parvenir à l'humanité. Il serait honteux dans cette culture de ne pas se réaliser en tant que vrai humain.
16:48 | Lien permanent | Commentaires (0)


















