14/08/2006
Ils dorment et nous veillons
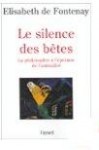 Élisabeth de Fontenay, Le Silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris, Fayard, 1999.
Élisabeth de Fontenay, Le Silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris, Fayard, 1999.
Note de lecture par Benoît Goetz
Le Silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité. Comment faut-il entendre ce titre ? Les animaux sont pourtant bien bruyants, criaillants et parfois même chanteurs. Oui, mais leur langage ne nous parle pas. Et notre langage ne leur parle pas, même si nous savons les habituer à obéir à nos signaux domesticateurs. Que nous dit alors l’animal dans ce silence où il se tient ? Que nous dit ce silence même ? Car il n’y a rien de plus signifiant qu’un silence pour le parlêtre (comme disait Lacan). Il nous faut nous souvenir de tout ce que nous avons fait dire à ce silence. Car nous lui avons fait dire un nombre incroyable de choses. Et pas seulement en le mettant en scène dans nos fables. En l’interprétant et en le théorisant – comme on n’a pas arrêté de le faire depuis vingt-cinq siècles.
Élisabeth de Fontenay vient de nous livrer avec ce Silence des bêtes l’achèvement provisoire d’une longue méditation sur la manière dont les animaux ont été traités par notre tradition philosophique et religieuse. Il s’agit d’un livre de philosophie sur la philosophie, sur le philosophème de l’animal, mais aussi sur l’énigme de l’animal lui-même, de l’animal en chair et en os, celui que la philosophie a tant de mal à prendre en considération, car la plupart du temps il ne lui a servi que de symbole ou d’allégorie, et surtout de repoussoir permettant par différence et opposition de définir un " propre de l’homme ". Faire parler le silence de l’animal a été nécessaire à l’homme depuis qu’il s’est mis en tête de définir son humanité, non tant par souci de connaissance que par volonté de promouvoir sa dignité. Les adversaires de l’homme triomphant et de son incorrigible vanité – et il y en a toujours eu, heureusement, quoique plus rares, bien entendu, que les " anthropomanes " (les fous du " propre de l’homme ") – n’ont pas manqué de donner aussi la parole aux silences des bêtes. Une grue prend ainsi la parole chez Platon pour annoncer qu’à son sens il y a deux sortes d’êtres : les vivants de l’espèce-grue d’une part, et tous les autres d’autre part... ! La philosophie toute entière, pour des raisons trop humaines, est ainsi une immense et variée prosopopée du silence des bêtes.
Élisabeth de Fontenay parcourt, du point de vue de l’animal, " le texte énigmatique et non encore déchiffré qu’est aux Européens d’aujourd’hui leur propre histoire " (Nietzsche). Or ce point de vue lui permet de gagner une perspective hétérodoxe sur la tradition " orthodoxe " du " propre de l’homme " : l’homme est l’animal orthogonal qui se tient debout pour contempler le ciel, c’est l’animal à mains, l’animal politique et l’animal qui parle, l’animal qui travaille et l’animal qui crée, l’animal qui pense et l’animal qui prie, celui qui sait qu’il va mourir et qui enterre ses morts, celui qui ne se contente pas de vivre mais qui existe, etc. Quand le discours philosophique est revisité du point de vue de celui qui ne parle pas mais qui est pourtant bien vivant et criaillant, il donne à entendre ce que son logos a tant de mal à comprendre : un être-là tout bête mais prodigieusement présent – un être-bête qu’on concevra difficilement comme radicalement étranger à l’homme, à moins d’exclure de l’humanité des vrais hommes ceux qui parlent bêtement, qui parlent autrement ou qui même ne parlent pas du tout.
Quel est le droit de celui qui ne parle pas – littéralement de l’infans – à être-là dans le monde, au même titre et dans le même monde que celui qui raisonne à haute voix dans la langue claire et nette de l’esprit ? Quel est le droit de celui qui ne peut s’engager à aucun devoir ? C’est à de telles questions étranges, insistantes, dérangeantes que mène la lecture du travail d’Élisabeth de Fontenay. Et comme le précise le début du livre, il était temps d’entreprendre ce travail car la présence de l’animal, pour l’occidental urbanisé, devient très problématique. Il devenait urgent d’entreprendre une remémoration de ce que l’animal a été pour nous pendant si longtemps, avant qu’il ne soit plus même possible de tenter seulement une telle anamnèse. En effet, si l’animal ne disparaît pas de notre monde (malgré la catastrophe accélérée de la disparition d’espèces toutes entières), il faut bien reconnaître qu’il s’éloigne de nous au point que jamais sans doute il n’avait été à ce point délaissé, abandonné dans une indifférence totale, relégué dans des lieux qu’on ose même plus dire d’élevage. Surtout nous savons bien que l’animal est appelé à se transformer radicalement quand il passera totalement du statut de créature qu’il avait en commun avec nous (cela on s’en souvient encore, il est encore temps de s’en souvenir, même si c’est avec peine) à celui de pur et simple produit de notre industrie. Le travail de remémoration d’Élisabeth de Fontenay peut donc être considéré comme un travail de " sauvetage " au sens de Walter Benjamin (d’où cet art de la citation commun à ces deux auteurs : " j’ai multiplié les longues citations parce qu’elles nous reconstituent ce que l’exposition des doctrines nous dérobent ", écrit Élisabeth de Fontenay). Ce que la tradition recèle n’importe pas seulement au savoir et à la mémoire, ce sont des possibilités de vie et d’existence qu’il faut ranimer pour faire échec à la barbarie du présent. Qui se souvient en son cœur de " la douceur grecque " et de la " bénignité " d’un Montaigne ? " Nous vivons et eux et nous sous même tect (toit) et humons mesme air : il y a, sauf le plus et le moins, entre nous une perpétuelle ressemblence " (cité in Le Silence des bêtes, p. 349). Il y a bien des manières d’être-au-monde oubliées. " Il y a encore bien des lunes mortes ou pâles, ou obscures, au firmament de la raison ", comme disait Marcel Mauss. Elles ne sont cependant pas perdues à jamais si, comme Élisabeth de Fontenay nous y encourage, nous entreprenons de nous éveiller, et de veiller autant que faire se peut – au sens de prendre garde – au merveilleux concert que donne " la bigarrure muette de la vie animale " (p. 610).
" Ils dorment et nous veillons ", tel est le leitmotiv de la recherche patiente d’Élisabeth de Fontenay. Cette perspective n’est pas moralisatrice, elle est politique au sens le plus élevé de ce mot. Il faut pour finir faire l’hypothèse que c’est aussi dans les rapports que nous instaurerons avec les animaux dans la grande cité mondiale, que se décidera le mode de relation des hommes entre eux. L’humanisme du " propre de l’homme " n’a guère su montrer ses capacités de résistance à l’horreur. Ce n’est pas en tentant vainement de le rétablir – après les terribles secousses qui l’ont ébranlé durant ce siècle – que le salut viendra. Élisabeth de Fontenay fait partie de ces philosophes et penseurs qui, fidèles à la tradition et aux possibilités non encore explorées qui dorment dans le passé, consacrent cependant tout leur temps et leur courage pour contravenir à la répétition fatale de l’identique. Nous avons la chance d’avoir encore de grands professeurs. Mais qu’est-ce qu’un " grand professeur " ? C’est quelqu’un qui échappe à la maladie mortelle du " dernier homme " que Nietzsche avait vu venir il y un siècle, et qui n’est autre que l’impuissance à admirer.
Benoît Goetz, "Élisabeth de Fontenay, Le Silence des bêtes. La philosophie à l’épreuve de l’animalité, Paris, Fayard, 1999.", Le Portique, Numéro 4 - 1999 - Eduquer : un métier impossible ? , [En ligne], mis en ligne le 11 mars 2005. URL :
http://leportique.revues.org/document287.html.
Consulté le 14 août 2006.
10:00 | Lien permanent | Commentaires (0)



















Les commentaires sont fermés.